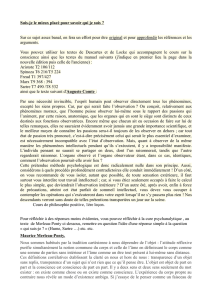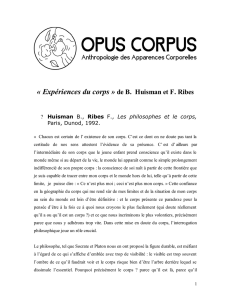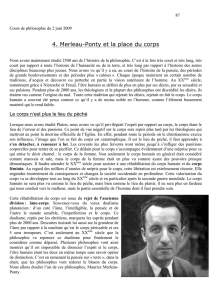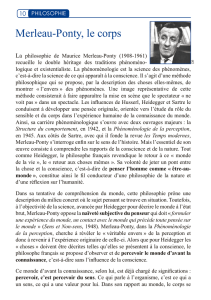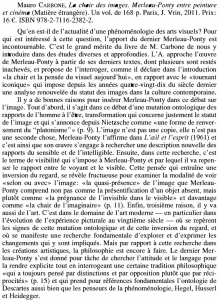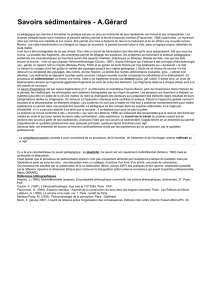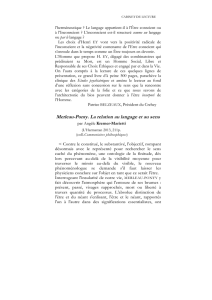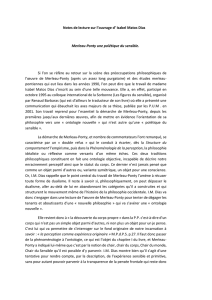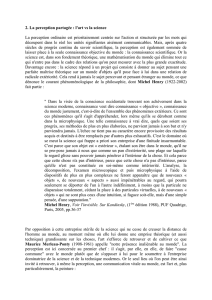Le post-humain, la chair et le renversement du

1
Mauro Carbone
LE POST-HUMAIN, LA CHAIR ET LE RENVERSEMENT DU PLATONISME :
Penser avec Merleau-Ponty (l’)aujourd’hui
Je suis convaincu que la réflexion du dernier Merleau-Ponty et en particulier la notion
de « chair » qui est au centre de celle-ci, fournissent une contribution d’une grande pertinence
à l’effort pour penser philosophiquement quelques uns des phénomènes culturels les plus
caractéristiques d’aujourd’hui. Tous ces phénomènes me semblent évoquer, et en même temps
invoquer, une forme de renversement du « platonisme » qui – en développant les prémisses
affirmées par la philosophie de Nietzsche et relancées notamment par celle de Gilles Deleuze1
– sache élaborer une pensée à la hauteur de notre époque, où une version simplifiée de la
philosophie de Platon reste pourtant la manière dominante de penser.
Parmi ces phénomènes culturels, il y a sans aucun doute celui que l’on désigne par le
terme « post-humain ». Forgé par le galeriste et critique d’art new-yorkais Jeffrey Deitch afin
de baptiser l’exposition qu’il a organisé à Lausanne en 1992, ensuite ce terme est parvenu en
effet à indiquer une tendance de pensée qui met en discussion la conception traditionnelle de
l’essence humaine dans sa pureté et sa stabilité, et ceci avant tout en montrant comment, à
l’époque actuelle, notre corps devient le lieu privilégié de la production d’identités
changeantes, via l’implantation de prothèses, la transplantation d’organes ou autres
hybridations.
Pour mieux comprendre ce phénomène, c’est la notion même de prothèse qu’il faut tout
d’abord interroger.
Qu’est-ce qu’une prothèse ?
En vertu du terme grec de próthesis, qui indique littéralement un élément mis devant ou
au lieu d’un autre, dans le domaine médical – qui constitue ici le point de départ de notre
réflexion – on a l’habitude de qualifier de « prothèse » n’importe quel dispositif servant à
remplacer, complètement ou partiellement, un organe corporel dont le fonctionnement est de
quelque façon compromis. Toutefois, une telle définition devient restrictive, et donc
problématique, en particulier quand le passage des sociétés occidentales de la phase
industrielle à une phase dite postindustrielle2 se conjugue avec un saut technologique très fort
même du point de vue qualitatif, qui ne peut que concerner directement notre expérience
corporelle elle-même. En prenant un sens élargi par rapport à son étymologie, le terme de
« prothèse » est alors utilisé pour désigner des dispositifs susceptibles non seulement de
1 Cf. G. Deleuze, « Renverser le platonisme », Revue de Métaphysique et de Morale, n. 4, 1967, réédité ensuite
sous le titre « Platon et le simulacre », dans Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 292-307.
2 Cf. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit,1979.

2
rétablir, mais aussi de développer de manière artificielle les possibilités humaines de
percevoir, de connaître et d’agir. En effet, l’innovation scientifique commence à intervenir sur
le corps humain non seulement à travers des artefacts généralement électromécaniques ou
chimiques, comme cela se passait auparavant, mais aussi à travers des technologies
numériques ou miniaturisées dont la finalité consiste de plus en plus à accroître les
potentialités biologiques humaines. Cette nouveauté amène, déjà en 1960, les médecins
américains Manfred E. Clynes et Nathan S. Kline à proposer le terme de cyborg (l’acronyme
de cybernetic organism) pour définir des organismes hybridés par des dispositifs pareils.
A ce sujet, [0]on a remarqué que de telles greffes peuvent avoir des effets rétroactifs sur
les capacités humaines, effets que le terme « prothèse » n’est pas propre à exprimer. Pour ma
part, je pense que l’acception élargie de « prothèse », désignant l’accroissement artificiel
plutôt que le rétablissement des potentialités humaines, par le fait même de trahir
l’étymologie du mot, contribue justement à mettre en question la conception de l’essence
humaine comme pure et stable, dont les prothèses étaient censées rétablir les capacités.
En effet, l’acception que la notion de prothèse a prise aujourd’hui contribue à désavouer
non seulement l’idée du corps humain en tant que modèle à imiter de la part des élaborations
technoscientifiques, mais, de manière encore plus radicale, elle contribue à désavouer aussi
l’idée même d’un modèle à imiter : une idée qui, dans la pensée occidentale, s’identifie
précisément avec la tradition du platonisme.
On peut donc affirmer que la prothèse en arrive à montrer une relation entre l’organique
et l’inorganique qui n’obéit plus à l’impératif de l’imitation du corps. C’est pourquoi elle
semble nous demander – comme cela a été souligné par l’esthéticien italien Pietro Montani –
« un profond changement de vocabulaire, marqué par le passage d’une conception liée à l’idée
de “corps” à une conception liée à l’idée de “chair” […], par voie de principe ouverte et
hybridée ».3
C’est justement Merleau-Ponty, on le sait, qui, au XXe siècle, a le premier revendiqué
explicitement la valeur philosophique de la notion de « chair », en l’utilisant pour indiquer un
type d’être qui – explique-t-il – « n’a de nom dans aucune philosophie »4, en tant qu’il n’est ni
matière ni esprit ni substance5, mais plutôt le tissu commun dans lequel chaque corps et
chaque chose ne se donnent qu’en tant que différence par rapport à d’autres corps et à
d’autres choses. Merleau-Ponty pense donc l’identité corporelle à partir du rapport de parenté
charnelle que le corps, en tant que sensible, entretient avec le monde à son tour sensible, en
même temps en se différenciant de celui-ci puisque le corps est aussi sentant.6
3 P. Montani, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione , Roma, Carocci, 2007, p.
14-15.
4 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, texte établi par C. Lefort, Paris, Gallimard,1964, p. 193.
5 Cf. ibidem, p. 184, 191 et 193.
6 C’est ce que Renaud Barbaras ne semble pas apercevoir lorsqu’il formule le jugement suivant : « Comme
Husserl, Merleau-Ponty cherche à construire la relation à partir d’un sujet dont la bipolarité
(empirique/transcendantal) n’est pas profondément questionnée, au lieu d’interroger le sujet à partir de la

3
Or, bien qu’elle fasse souvent usage du terme de « chair », la réflexion sur le post-
humain s’est jusqu’à présent référée de manière superficielle à la pensée développée par
Merleau-Ponty. Pour ma part, je soutiens au contraire qu’en approfondissant justement cette
pensée, la référence que la littérature sur le post-humain fait au terme de « chair » pourra
trouver son sens philosophique le plus pertinent et le plus fécond. Comme je viens de
l’expliquer, le dernier Merleau-Ponty pense en effet l’expérience corporelle comme se
constituant à partir de l’horizon relationnel de la chair, se situant de ce fait sur la même
longueur d’onde que la réflexion sur le post-humain, dans la mesure où ce dernier tend à
abandonner l’humain – et par conséquent le corps humain lui-même – en tant que modèle à
imiter.
Dans cette perspective, la chair se manifeste alors comme un tissu de différences
enveloppant et traversant même les écarts produits par la technique, qui ne peuvent être
considérés comme extérieurs ou étrangers à ce tissu, puisque l’expérience humaine est par
essence entremêlée à la technique elle-même. Plutôt que l’imitation du corps, c’est donc
l’horizon de la chair qui fournit la condition de possibilité de la prothèse en apparentant
l’organique à l’inorganique.
Il me semble que la fécondité de cette approche merleau-pontienne transparaît
notamment dans une lignée de réflexions qui s’est déployée en Italie précisément à partir de
l’interprétation de la chair comme tissu de différences, telle que je l’ai définie auparavant.
Cette direction de pensée a été développée ensuite par Roberto Esposito, dont le livre
le plus significatif à cet égard, intitulé Bios,7 a été traduit en anglais, mais pas encore en
français. Esposito a précisé d’une manière à mon avis particulièrement éclairante ses propres
développements de la direction de pensée dont on est en train de parler lors d’un « dialogue
sur la philosophie à venir » avec Jean-Luc Nancy.8 Malgré ce qu’on avait pu lire, dans le livre
intitulé Corpus, concernant les critiques de celui-ci à l’égard de la notion phénoménologique
de « corps propre » 9, au cours de ce dialogue Nancy affirme sa préférence pour une pensée du
corps plutôt que de la chair, qu’il qualifie de « mot d’épaisseur, tandis que corps est un mot
léger »10. Face à ces raisons, Esposito oppose des réflexions qu’il me paraît utile de citer, du
moins dans leur articulations principales :
relation perceptive : le seul pas franchi vis-à-vis de Husserl consiste à partir d’un sujet incarné plutôt que d’un
pur sujet transcendantal » (R. Barbaras, Vie et intentionnalité. Recherches phénoménologiques, Paris, Vrin,
2003, p. 156).
7 R. Esposito, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 2004.
8 Cf. R. Esposito et J.-L. Nancy, Dialogo sulla filosofia a venire, introduction à l’édition italienne de J.-L.
Nancy, Être singulier pluriel, Paris, Galilée, 1996, trad. it. de D. Tarizzo, Essere singolare plurale, Torino,
Einaudi, 2001, pp. VII-XXIX.
9 J.-L. Nancy, Corpus, Paris, Éd. Métailié, 1992, 20002, p. 66.
10 R. Esposito et J.-L. Nancy, Dialogo sulla filosofia a venire , introduction à J.-L. Nancy, Essere singolare
plurale,, op. cit., p. XXVIII.

4
Par contre, il me semble que le principe de l’altération et de la contamination réclame la sémantique de
la ‘chair’ , entendue précisément en tant qu’ouverture du corps, son expropriation, son être ‘commun’. […] La
chair renvoie au dehors tout comme le corps au dedans : elle est le point et la marge où le corps n’est plus
seulement un corps, mais aussi son envers et son fond défoncé, comme Merleau-Ponty l’avait pressenti à sa
manière. […] Je crois que la tâche première de la philosophie à venir est, tout d’abord, de remplacer les termes
de ‘terre’, ‘corps’, et ‘immunité’ par ceux de ‘monde’, ‘chair’ et ‘communauté’.11
La pensée du visuel aujourd’hui
À son tour, Pietro Montani a repris cette ligne de pensée – cette sémantique de la
‘chair’ – en la développant de manière originale dans le domaine de l’esthétique et en
soulignant qu’elle comporte « d’importantes répercussions sur le plan de l’image »12 qui,
évidemment, se conjuguent aussi aux mutations technologiques à l’œuvre sur ce plan.
Dans cette perspective, il n’est dès lors guère surprenant que la sémantique de la chair
merleau-pontienne inspire aussi un volume dont l’auteur, Roberto Diodato, y explique qu’il «
s’intitule Esthétique du virtuel parce qu’il traite de corps qui sont des images et des
interactions entre notre corps, appesanti et en même temps allégé par des prothèses non
organiques, et ces images ».13 En effet, Diodato souligne que la notion de « chair du monde »
est, à son sens, « une bonne description du champ virtuel »14, dans la mesure où celui-ci, «
dont les objets sont une modalité de relation, est lui-même une structure de corrélation ou
trame relationnelle de corps entendus comme événements de réversibilité ».15
La réflexion du dernier Merleau-Ponty, en plaçant justement la notion de chair à son
centre, parvient en effet à concevoir la vision, l’imaginaire et l’image elle-même de telle
façon qu’elle se révèle aujourd’hui très utile pour caractériser ce qu’il est convenu d’appeler
« le champ virtuel », ainsi que pour nommer les mutations qui sont aujourd’hui à l’œuvre dans
le statut des images.
On sait bien, en effet, que le développement continu des technologies optiques et
médiatiques ne cesse d’ouvrir nos corps à des formes inédites de visualisation et d’expérience
visuelle, en donnant aux images une centralité nouvelle, non seulement au niveau pratique et
professionnel, mais aussi au niveau théorique. C’est sur cette base qu’à partir des années
quatre-vingt-dix du siècle dernier on a commencé à évoquer, dans notre culture, un « tournant
iconique » imposant une analyse renouvelée du statut contemporain des images.
Or, ces mutations aussi semblent évoquer, et en même temps invoquer, une forme de
renversement de ce qu’on a convenu d’appeler le « platonisme ».
11 Ibidem, p. XXVI-XXVII.
12 P. Montani, Bioestetica. op. cit., p. 15.
13 R. Diodato, Estetica del virtuale, Milano, Bruno Mondadori, 2005, p. 2.
14 Ibidem, p. 112.
15 Ibidem.

5
C’est au platonisme ainsi entendu que Merleau-Ponty fait allusion dans un passage de
L’œil et l’esprit, son dernier essai sur la philosophie de la peinture, où il écrit :
Le mot d’image est mal famé parce qu’on a cru étourdiment qu’un dessin était un décalque, une copie,
une seconde chose. 16
Il est bien certain qu’aujourd’hui, à l’époque des images numériques, il est assez facile
de partager l’affirmation de Merleau-Ponty. Toutefois, nous venons à peine de commencer à
penser selon ses implications et ses conséquences. En effet, si l’image n’est pas « une
seconde chose », alors elle ne peut plus être qualifiée, tout simplement, de figure de renvoi,
parce que la nature de ce renvoi se complique et sa structure se multiplie et s’enchevêtre
d’une manière telle que « la première chose » vers laquelle ce renvoi est censé faire signe –
l’absent qu’il est censé présentifier – s’avère introuvable.
Le pendant d’un tel statut de l’image est celui du voir, selon la définition que Merleau-
Ponty en donne dans la « Préface » de Signes, contemporaine des écrits mentionnés jusqu’ici :
voir, c’est par principe voir plus qu’on ne voit, c’est accéder à un être de latence. L’invisible est le relief
et la profondeur du visible, et pas plus que lui le visible ne comporte de positivité pure.17
En effet, si l’image n’est pas « une seconde chose », c’est précisément parce que la
« voir, c’est par principe voir plus » que la présentification de l’absent comme tel. Merleau-
Ponty en arrive à nommer « voyance » ce « voir plus », en expliquant que cette « voyance » «
nous rend présent ce qui est absent »18, et en évoquant à ce sujet l’expérience de l’ubiquité de
notre voir :
Je suis à Saint Petersburg dans mon lit : à Paris, mes yeux voient le soleil 19.
Il est bien significatif que Roberto Diodato commente cette phrase du peintre Robert
Delaunay citée par M. Merleau-Ponty dans la manière suivante : « elle me semble
simplement vraie et d’une grande ouverture. Maintenant, si je devais synthétiser ce travail [à
savoir son livre mentionné plus haut], les mondes virtuels ont quelque chose à voir avec cette
vérité. » 20
16 M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit [daté 1960, 19611], Paris, Gallimard, 1964,, p. 23.
17 M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 29.
18 M. Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit op. cit.,, p. 41.
19 Robert Delaunay cité dans ibidem, p. 83-84.
20 R. Diodato, Estetica del virtuale, cit., p. 3.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%