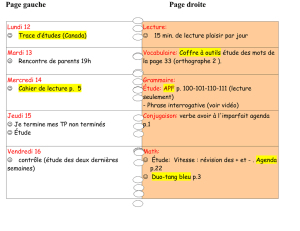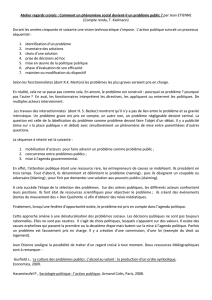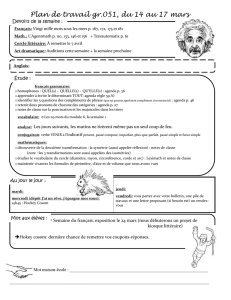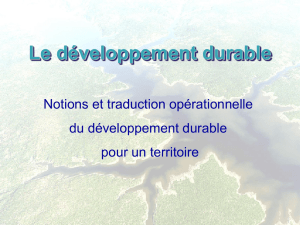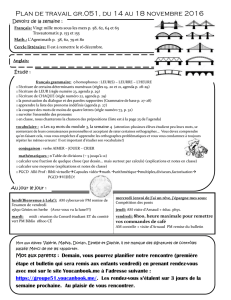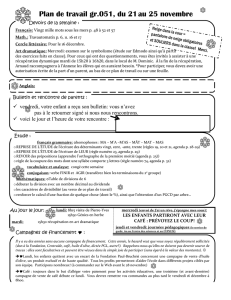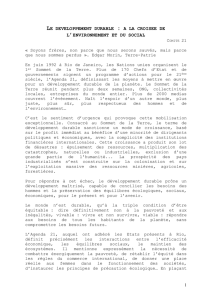Première partie : Contexte. Développement durable

23
Première partie : Contexte. Développement durable, Collectivités,
Action collective et Territoire
I. LES COLLECTIVITES LOCALES AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
1. Des compétences multiples qui répondent aux enjeux du développement durable
Les collectivités locales sont des acteurs incontournables du développement durable, en raison de la
diversité et de l’importance de leurs compétences.
Le chapitre 28 de l’Agenda 21 rappelle que –
« Les problèmes abordés dans Action 21 qui procèdent des activités locales sont si nombreux
que la participation et la coopération des collectivités à ce niveau seront un facteur
déterminant pour atteindre les objectifs du programme.
En effet, ce sont les collectivités locales qui construisent, exploitent et entretiennent les
infrastructures économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les processus de
planification, qui fixent les orientations et la réglementation locales en matière
d’environnement et qui apportent leur concours à l’application des politiques de
l’environnement adoptées à l’échelon national ou infranational.
Elles jouent, au niveau administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans
l’éducation, la mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d’un
développement durable » (CNUED, 1992)
7
.
L’Agenda 21 de Rio comporte quarante chapitres, dont 17 renvoient à des domaines où
interviennent ou peuvent intervenir les collectivités locales. Les collectivités sont compétentes et
peuvent contribuer à la résolution des problèmes en ce qui concerne chacune des 4 sections de
l’Agenda 21 de Rio, qui abordent : les dimensions sociales et économiques, la conservation et la
gestion des ressources, le renforcement du rôle des grands groupes d’acteurs, les moyens
d’exécution.
L’étendue des problèmes auxquels renvoie le développement durable autant que la variété des
compétences des collectivités locales, appellent une contribution de ces dernières vis-à-vis des
enjeux locaux et globaux dans ces différents domaines. En 1994, la Charte d’Aalborg affirmait ainsi
qu’« une vie humaine durable ne peut exister sur cette terre sans collectivités durables »
8
.
Les champs d’action et les compétences évoquées ci-dessus se distribuent de manière variable, selon
les pays, entre l’Etat et les différents niveaux d’organisation territoriale infranationaux.
L’envergure des compétences des collectivités fait notamment d’elles des agents économiques au
poids très important. La commande publique représente aux alentours de 130 milliards d’euros par
an, c’est à dire environ 10% du PIB. La commande publique peut donc être utilisée comme un
important levier du développement durable
9
. Ceci passe par les choix stratégiques qu’adoptent les
collectivités et par les exigences qu’elles introduisent dans les cahiers des charges.
7
CNUED, 1992, « Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement » (ou Agenda 21), Rio de
Janeiro, Chapitre 28 « Initiatives des collectivités locales à l’appui d’action 21 », § 1.
8
La Charte d’Aalborg ou Charte des villes européennes pour la durabilité, a été adoptée par les participants à la
conférence européenne sur les villes durables qui s’est tenue à Aalborg, Danemark, le 27 mai 1994.
9
Il impossible de connaître les montants exacts de la commande publique (les administrations évoluent sans aucun
repère au niveau de leurs dépenses). Un observatoire de la commande publique a été mis en place en 2005, qui devrait
publier des données plus précises fin 2007. Mais quelques chiffres reviennent fréquemment : le montant global de la

24
2. Un cadre privilégié de proximité avec les parties intéressées
Les collectivités locales constituent, par définition, un cadre d’action de proximité avec les acteurs
de leur territoire. Circonscriptions administratives et juridiques infranationales, elles sont de facto à
différentes échelles – au gré de leurs compétences et des échelles territoriales auxquelles s’expriment
les nécessités de l’action collective – un cadre privilégié d’expression des acteurs dans le champ du
politique et de la prise de décision.
Proximité et prise en compte des acteurs, ouverture aux parties intéressées
Experts et scientifiques, citoyens, organisations de la société civile (associations, ONG), entreprises,
Etat déconcentré, acteurs faibles et générations futures : le développement durable implique que
l’ensemble des parties intéressées prennent part aux décisions et aux choix qui affectent une
collectivité d’individus.
L’attention portée par les citoyens à la prévention des risques a développé une forte demande
sociale pour une réelle participation aux décisions d’aménagement et d’environnement. Longtemps
restée l’apanage de quelques précurseurs ou experts, la protection de l’environnement est
aujourd’hui devenue une préoccupation partagée par un grand nombre d’acteurs, témoins de la
montée des risques et des incertitudes auxquelles sont confrontés les sociétés.
Le développement durable « introduit la notion de « grands groupes », les organisations qui ont un
rôle essentiel à jouer pour le développement durable : femmes, jeunes, populations autochtones,
entreprises, agriculteurs, syndicats, ONG, scientifiques et collectivités locales. Ces acteurs, supposés
représenter la société mondiale, sont conviés à participer comme observateurs aux réunions
internationales. Au niveau local les collectivités sont invitées à décliner ces engagements
internationaux » (BRODHAG, 2002)
10
.
Les associations positionnées sur sa prise en compte au niveau local, revendiquent le fait que
développement durable « introduit la nécessité d’une concertation avec les grands groupes sociaux
concernés, avant toute prise de décision engageant les populations et leur devenir. Les démarches
de concertation conduisent à une nouvelle pratique de l’exercice du pouvoir. Les citoyens
deviennent acteurs d’une démocratie participative, animée par l’autorité locale » (COMITE 21,
2001)
11
.
Les étapes clés d’une démocratie participative sont, selon le discours de ces acteurs, d’« adopter la
transparence et la lisibilité des actions
12
, décloisonner les savoirs, organiser les échanges et le débat
public, construire des outils de concertation, de suivi et d’évaluation », et constituent souvent « une
véritable révolution culturelle, tant nos habitudes sont ancrées dans la relation frontale entre
décideurs et citoyens. C’est cette démocratie renouvelée qui fonde l’adhésion des citoyens à un
projet de développement. Cette évolution des modes de décision, intégrant les pratiques de
commande publique est compris entre 120 et 150 milliards d’euros, soit environ 10% du PIB (MarchesPublicsPme.com,
www.marchespublicspme.com, consulté le 16/11/07).
10
BRODHAG C., 2002, « Développement durable et partenariat », www.agora21.org
11
Comité 21, 2001, « Territoires et Développement Durable - Guide des collectivités territoriales pour la mise en œuvre d’un développement
durable - Tome 1 », Comité 21/EDF/Caisse des Dépôts et Consignations/AMF/DATAR, 52pp (p12).
12
Un diagnostic des pratiques actuelles, mené par différentes équipes du CRIDEAU à travers l’Europe, est à cet égard
assez sévère: « Les rapports nationaux ont mis en évidence l’état affligeant de l’information relative à l’impact réel de
certaines activités sur l’environnement. Malgré les pétitions de principe sur le droit à l’information, la protection de
l’environnement souffre d’une véritable culture du secret qui confine parfois à la stratégie d’opacification ». ORTIZ L.,
GOUGUET J-J (Dir), 2002, « La territorialisation des politiques environnementales », CRIDEAU/CNRS-INRA, PULIM.

25
concertation, une information transparente sur les enjeux et les moyens, une responsabilité vis-à-vis
des impacts des projets, peut être résumée par le terme de gouvernance
13
» (COMITE 21, op. cit.).
L’idée s’est ainsi imposée parmi certains scientifiques, que face à la complexité des problèmes visés
et aux controverses qui révèlent l’ampleur des incertitudes, « l’action autoritaire de type
réglementaire, d’essence régalienne, s’appuyant sur une segmentation administrative des problèmes
et une séquentialité des processus de décision, n’est plus adaptée » (AGGERI, 2000)
14
.
Les problématiques environnementales sont emblématiques de l’évolution du rôle du local dans la
prise de décision. L’intervention publique prend dorénavant place dans des « univers controversés »
(HOURCADE et Al., 1992)
15
à la base desquels on trouve une grande confusion « à propos de la
nature et de l’étendue de la pollution, de l’identité des pollueurs, de la validité des connaissances
scientifiques et des solutions appropriées ». Les solutions à ces controverses ne pourraient ainsi être
envisagées sans la coopération d’une variété d’acteurs (experts, entreprises, société civile…), et sans
importants efforts d’innovation. CALLON et RIP (1991)
16
montrent qu’en situation de grande
confusion dans les faits et d’un grand nombre de valeurs divergentes (vache folle, trou dans la
couche d’ozone), « le meilleur moyen de résoudre les controverses [est] d’impliquer le plus grand
nombre possible d’acteurs dans des ‘‘forums hybrides’’ afin d’établir des normes sociales et
techniques » (AGGERI, 1999)
17
.
Décloisonner le débat entre administrations, communauté scientifique, entreprises et milieux
associatifs et syndicaux, doit donc permettre de mieux cerner les risques et les effets des décisions,
et d’acquérir une meilleure capacité d’anticipation stratégique, tout en assurant la prise en compte
des aspirations des parties intéressées. Une participation publique active doit donc assurer la
sensibilisation des citoyens aux enjeux du développement durable et leur donner la capacité de
participer à la prise en charge des enjeux collectifs. Ces approches partenariales « permettent de
tisser les liens les plus fins de solidarité et de citoyenneté sur le territoire » (BRODHAG, 2002, op.
cit.). Elles sont la condition d’une patrimonialisation des enjeux par les acteurs, et de leur
responsabilisation.
La participation devant intervenir à travers les différentes phases de conception, de réalisation et
d’évaluation des projets, la notion de subsidiarité est centrale dans la mise en œuvre locale du
développement durable. Selon le principe de subsidiarité, la responsabilité d’une tâche incombe au
plus bas niveau de décision compétent pour l’entreprendre. La subsidiarité concerne non seulement
les échelons de gestion mais s’applique jusqu’au niveau du citoyen, en raison de la légitimité de
l’intervention de ce dernier ainsi que de ses impacts en tant qu’acteur – les actions individuelles et
leur somme engageant l’ensemble de la collectivité et son devenir (à travers notamment, les modes
de vie, de production et de consommation, de transport, etc.).
L’échelon local constitue donc un cadre privilégié pour la rencontre entre les acteurs et leurs
ajustements autour d’un projet, favorable aux conventions et aux contrats multi-acteurs. Les
conventions multi-acteurs engagent des acteurs multiples autour d’objectifs communs,
13
Nous aurons l’occasion d’apporter d’autres éclairages sur le sens, l’origine et les implications du terme polysémique de
gouvernance, qui quel que soit le contexte, renvoie toutefois à des règles nouvelles et à l’intervention d’acteurs nouveaux et
multiples en ce qui concerne la prise de décision.
14
AGGERI F., 2000, « Les politiques d’environnement comme politiques de l’innovation », Gérer et Comprendre, juin 2000.
15
HOURCADE et Al., 1992, « Ecological economics and scientifical controversies: lessons from some recent policy making in the EEC
», Ecological Economics 6, pp211–233.
16
CALLON M, RIP A, 1991, « Forums hybrides et négociations des normes socio-techniques dans le domaine de l’environnement »,
Environnement, Science et Politique, Cahiers du GERMES, 13, pp227–238.
17
AGGERI F., 1999, « Environmental policies and innovation: A knowledge-based perspective on cooperative approaches », in
Research Policy 28, pp699–717.

26
particulièrement au terme de processus de concertation, et leur mise en œuvre peut par exemple
trouver un support dans le montage d’associations ad hoc (NAPOLEONE et Al., 1995)
18
.
Les objectifs du développement durable sont dans ce sens issus d’une négociation entre acteurs
fortement déterminée par les spécificités et les enjeux locaux, ce qui permet d’affirmer que
« l’acception du concept de développement durable est en partie socialement construite »
(FADEEVA, 2003)
19
. Cette réalité est bien illustrée par les locutions de projet de territoire et de territoire
de projet.
Aurélien BOUTAUD (2004)
20
a montré que le développement durable était une notion issue d’une
négociation coopérative au niveau international. Il émerge de la volonté d’acteurs aux intérêts
divergents de concilier environnement et développement, au travers de cette valeur nouvelle basée
sur la recherche de stratégies gagnant-gagnant. Cependant, au niveau local, les stratégies
d’appropriation compétitive prédominent, chaque acteur cherchant dans la négociation à faire
prévaloir ses intérêts propres sans construire des alternatives gagnantes/gagnantes.
Le développement durable introduit une spécificité fondamentale dans cette ouverture des modes
de décision aux acteurs concernés. Le terme d’acteurs renvoie à des individus ou des groupes actifs
ou potentiellement actifs dans cette participation aux décisions. L’ouverture des processus
décisionnels ne répondrait que partiellement aux exigences du développement durable si elle
recouvrait uniquement la prise en compte des attentes des acteurs qui se trouvent de facto en capacité
de faire entendre ou valoir leurs intérêts. Le développement durable implique ainsi que les décisions
prennent également en compte les attentes des intérêts de l’ensemble des parties intéressées, dont le
cercle déborde celui des acteurs et des parties prenantes. On entend par parties intéressées l’ensemble
des individus ou groupes pouvant impacter ou être impactés par une décision ou un projet : les
parties intéressées incluent les acteurs faibles ou absents, qui ne sont pas en capacité de faire valoir
leurs intérêts. Il s’agit notamment des individus ou groupes sociaux exclus ou faibles, des habitants
des pays en voie de développement, et des générations futures (par définition incapables de faire
valoir leurs attentes…) (BRODHAG, 2002, op. cit.).
Proximité et construction des enjeux
L’Agenda 21 enjoint les collectivités à mettre en œuvre des Agendas 21 locaux, stratégies locales qui
déclinent ses préoccupations globales. Il ne contient pas de prescription sur le contenu des Agendas
21 locaux, le principe étant de permettre aux partenaires d’identifier leurs propres priorités. Ces
dernières doivent toutefois être cohérentes avec le diagnostic de la CNUED et les préoccupations
globales présentes dans les différents chapitres de l’Agenda 21.
On peut remarquer avec Régis Debray que « toute communauté durable se construit en contre. Le
pour s’en déduit »
21
. En partie, on peut penser que le local s’approprie le développement durable en
réaction à des problèmes spécifiques et unificateurs d’une communauté d’acteurs.
Des démarches locales de développement durable se sont par exemple développées de manière
précoce dans la région du Nord-Pas-de-Calais, soumise à de graves problèmes environnementaux,
18
Les conventions multi-acteurs engagent des acteurs multiples autour d’objectifs communs, particulièrement au terme
de processus de concertation, et leur mise en œuvre peut par exemple trouver un support dans le montage
d’associations ad hoc (NAPOLEONE et Al., 1995, « Aménagement communal participatif à Montpezat ou l’élaboration, avec les
habitants, d’un schéma directeur cohérent », Le Courrier de l’environnement de l’INRA n°24, avril 1995, www.inra.fr).
19
FADEEVA Z., 2003, « Exploring Cross-Sectoral Collaboration for Sustainable Development - A Case of Tourism », Doctoral
Dissertation, The International Institute for Industrial Environmental Economics.
20
BOUTAUD A., 2004, « Le développement durable : penser le changement ou changer le pansement ? Bilan et analyse des outils
d’évaluation des politiques publiques locales en matière de développement durable en France : de l’émergence d’un changement dans les modes
de faire au défi d’un changement dans les modes de penser », thèse de doctorat (ENMSE, Centre SITE), 416pp (p143).
21
Comme le remarquait Régis Debray à propos de la construction européenne, dans Le Figaro des samedi 14 et
dimanche 15 février 2004.

27
sociaux et économiques de reconversion industrielle. Sustainable development est le maître mot de
nombreuses collectivités locales australiennes, situées sur un littoral fragile et faisant face à une
évolution démographique et à une pression touristique sans précédent. Maints exemples témoignent
de la diversité des facteurs qui poussent des collectivités à la recherche d’un développement durable.
La diversité des formes que prennent les démarches des collectivités ainsi que leur inégalité
d’avancement, s’explique en partie par le fait qu’elles sont le reflet de préoccupations et de contextes
spécifiques.
Pour autant, le développement durable se caractérise par la mise en exergue de la portée globale des
enjeux environnementaux, économiques et sociaux contemporains. Le concept de développement
durable correspond à la reconnaissance des interrelations systémiques à l’échelle planétaire, entre
l’homme, ses activités, son bien-être et la biosphère. C’est cette nouvelle façon d’envisager les liens
entre développement et environnement qui constitue l’apport majeur des constats dressés en 1987
par le rapport BRUNTDLAND.
Situations d’incertitude, controverses socio-techniques et forums hybrides
Parallèlement, des situations combinant incertitude scientifique et stratégies divergentes d’acteurs
concernés se sont multipliées ces dernières années (gestion des risques, déchets nucléaires, sang
contaminé, ESB, OGM...), créant des situations de controverse, problématiques et difficilement
gouvernables, que CALLON et Al. appellent « controverses socio-techniques ». Les auteurs
réfléchissent à partir de ces situations, à la légitimité des phénomènes de gouvernance, et plus
particulièrement, d’immixtion des citoyens dans les processus de décision technique et
scientifique. Ces controverses, en effet, dépassent largement les seules questions techniques. Un
de leurs enjeux est « d’établir une frontière nette et largement acceptée entre ce qui est considéré
comme indiscutablement technique et ce qui est reconnu comme indiscutablement social. [...]
Reconnaître sa dimension sociale, c’est redonner une chance [à un dossier] d’être discuté dans des
arènes politiques » (CALLON et Al., 200l)
22
.
Ces situations se multiplient dans un contexte d’incertitudes, et la question du monopole des
scientifiques sur la « vérité » et sur la pertinence de choix techniques et leurs implications sociales,
est posée. L’activité scientifique est un processus social, et la science ne peut être soustraite aux
enjeux de pouvoir. Les auteurs rappellent que l’on peut toujours mettre en question les
conditions épistémologiques de sa neutralité.
Aussi CALLON et al. légitiment-ils la possibilité pour les « profanes » (riverains, d’élus, acteurs
associatifs, scientifiques issus de disciplines non prises en compte dans un projet technique...) de
participer aux côtés des « experts », aux prises de décision socio-techniques.
Des acteurs d’origines diverses et aux intérêts et points de vue divergents se mobilisent ainsi
autour de projets entourés d’incertitudes afin que soient pris en compte leurs points de vue, et
que la décision ne soit pas confisquée par les scientifiques et les experts. Les espaces ouverts où des
groupes peuvent se mobiliser pour débattre des choix techniques qui engagent le collectif sont
désignés par le terme de « forums hybrides » par les auteurs : ces espaces rassemblent en effet des
acteurs hétérogènes, préoccupés par des questions à la fois techniques et sociétales. Ce phénomène
offre un enrichissement, un contrepoids et une alternative, sur des sujets précis, à la prise de
décision issue de la seule démocratie élective informée par le scientifique. Les débats ainsi permis,
débouchent par ailleurs sur l’élaboration progressive de références collectives communes aux
acteurs, susceptibles d’informer et de compléter des décisions unilatérales, remettant par là en
cause le monopole du savoir des scientifiques et des politiques.
22
CALLON et Al., 2001, « Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique », Le Seuil, Paris, 358pp (p45).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%