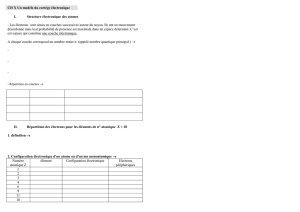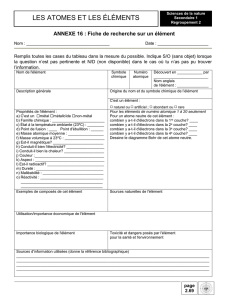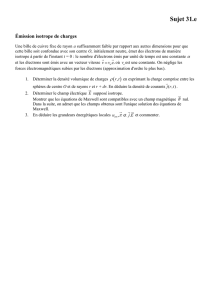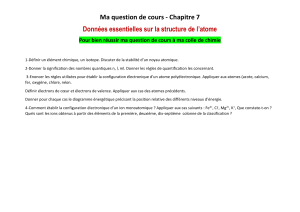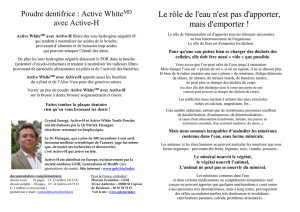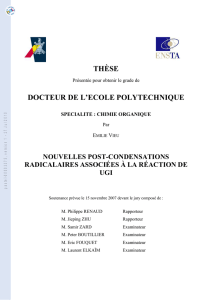16 Chapitre 5 : Aperçu des réaction organiques. 5.1. Différents types

Chapitre 5
Geoffroy Kaisin Résumé de chimie organique 16
Chapitre 5 : Aperçu des réaction organiques.
5.1. Différents types de réactions organiques 112-113
Réactions d’addition : 2 réactifs s’assemble afin de ne former plus qu’un seul
produit
Réaction d’élimination : Un réactif est séparer en 2 produits.
Réaction de substitution : 2 réactifs échange des morceaux pour former 2 produits.
Réaction de réarrangement : Un réactifs réorganise ses liaisons et ses atomes afin
de former un isomère.
5.2. Mécanisme des réactions 114
a. Rupture d’une liaison simple covalente
Rupture homolytique :
ABA + B
Rupture hétérolytique :
ABA + B
b. Formation d’une liaison simple covalente
Formation homogénique :
AB
A + B
Formation hétérogénique :
AB
A + B
Rupture homolytique + formation homogénique = réaction radicalaire.
Rupture hétérolytique + formation hétérogénique = réaction polaire ou péricyclique.
Radical : espèce contenant un nombre impair d’électrons de valence et, donc, possédant
un électrons non apparié dans une de ses orbitale.
5.3. Réactions radicalaires 115
Les radicaux libres sont des espèces extrêmement réactionnelles.
Il y a 2 types de réactions radicalaires : les substitution et les addition.
5.4. Exemple de réaction radicalaire 116
Une réaction radicalaire de fait toujours en 3 étapes.
1. L’initiation : quelques radicaux vont être produits.
2. La propagation : une fois que assez de radicaux ont été produit, la réaction
proprement dite va se mettre en place. Ces réactions vont produire notamment des autres

Chapitre 5
Geoffroy Kaisin Résumé de chimie organique 17
radicaux et la réaction va s’auto entretenir jusqu’au moment ou la production de radicale
sera insuffisante et la réaction va donc s’arrêter.
3. La terminaison.
5.5. Réactions polaires 117-119
La polarisabilité mesure, grosso modo, la capacité qu’ont les électrons périnucléaires
(localisés autour du noyau) à répondre aux effet d’un solvant ou d’autres réactifs polaires.
Plus un atome est « gros », plus sa polarisabilité sera importante.
N.B. Il ne faut pas confondre la polarité et la polarisabilité. En effet, une liaison C—I
n’est pas polaire mais l’iode est néanmoins polarisable.
Il y aura réaction polaire si les sites riches en électrons des groupes fonctionnels d’une
molécule réagissent avec les sites pauvres en électrons des groupes fonctionnels d’une autre
molécule.
ATTENTION : La flèche indique un mouvement d’électron DU site riche AU site pauvre
et non un déplacement d’atomes.
Les nucléophiles possèdent des sites riches en électrons et peuvent former des liaisons en
donnant une paire d’électrons à un site pauvre en électrons.
Les électrophiles possèdent des sites pauvres en électrons et peuvent former des liaisons
en acceptant une paire d’électrons provenant d’un nucléophile.
N.B. Les termes électrophiles et nucléophiles sont utilisés uniquement quand des
liaisons avec le carbone sont concernées.
5.6. Exemple de réaction polaire 120-121
5.7. Description des réactions : vitesse et équilibre 122
5.8. Description des réactions : Energie de dissociation 123-124
Energie de liaison : énergie nécessaire pour rompre une liaison donnée d’une molécule,
en phase gazeuse à 25°C, en 2 fragments radicalaires.
5.9. Description des réactions : Diagramme d’E et états de transition 125-127
∆Gŧ elevée réaction lente
∆Gŧ faible réaction rapide
5.10. Description des réactions : les intermédiaires 128-131
1
/
2
100%