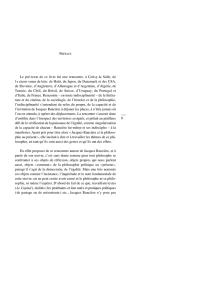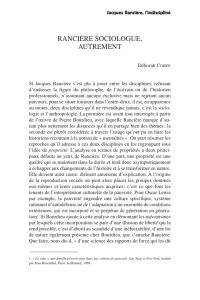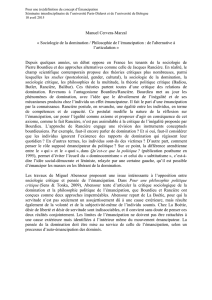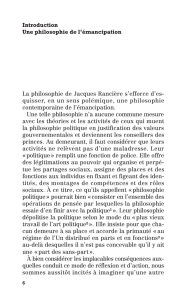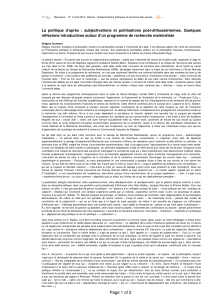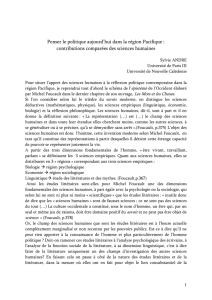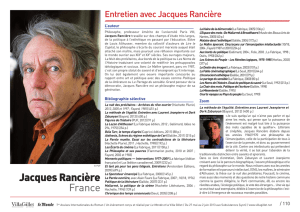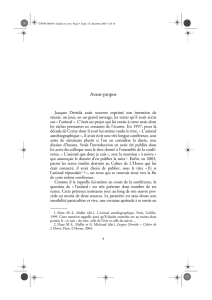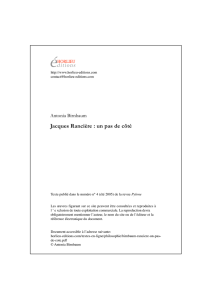La pensée littéraire et la preuve, ou l`épreuve, du partage

La pensée littéraire et la preuve, ou l’épreuve, du partage
Elodie Laügt
« Il y a des malentendus qui ne font que confirmer une
suprême entente. »
F. Schlegel à Novalis
« Le romantisme ne nous mène à rien qu’il y ait lieu d’imiter
ou dont il y ait à ‘s’inspirer’, et cela parce que – on le verra –
il nous ‘mène’ d’abord à nous-mêmes
i
. »
LA NOTION DE « PENSÉE LITTÉRAIRE » soulève à la fois la question de ce que la
littérature pense et celle de la manière dont elle est pensée. C’est la question qui est posée à la
littérature et celle que cette dernière se pose et nous pose. Cette double question est en jeu, pourrait-
on dire, dans tout texte, que ce soit de manière explicite ou non, dans la mesure où la question de la
littérature, c’est-à-dire celle de sa définition en même temps que de ses enjeux et de son rôle ou de
ses usages sociaux, occupe et travaille tout texte. Cependant, elle ne l’occupe pas de la même
manière ni depuis le même lieu. Aussi, penser la littérature, c’est-à-dire la singularité de la
littérature ou encore un Absolu de la littérature, ne cesse-t-il d’apparaître à la fois nécessaire et
problématique. Si l’existence du « premier romantisme » comme l’appellent Philippe Lacoue-
Labarthe et Jean-Luc Nancy ne fut que très brève, entre 1797 et 1800, ses répercussions n’auront
cessé de se faire sentir bien au-delà de la dissolution du petit groupe d’Iéna. Ainsi, les auteurs de
L’Absolu littéraire ne manquent pas de souligner que le mouvement par lequel la littérature prend
en charge ses propres questions ouvre la voie à la pensée blanchotienne du désœuvrement. De fait,
pour Maurice Blanchot, comme le rappelle Michael Holland, l’essence de la littérature est de

2
n’avoir pas d’essence
ii
. La question de la littérature telle que Blanchot la conçoit est celle de sa
possibilité. Si cette perspective implique que la littérature se soustrait à son objectivation comme à
la définition de ses contours, c’est que la littérature est alors tout entière tournée vers sa propre
question, en tant qu’elle est elle-même limite, comme on dit d’une expérience qu’elle est « limite »
ou « extrême ». La littérature ne cesse de se risquer pour dessiner et redessiner la forme et les
contours d’une certaine expérience, d’un rapport au monde et à l’autre. La question de la limite se
pose alors doublement : c’est la question du possible, comme exploration des conditions de
possibilité de la littérature ; et c’est la question du pouvoir, que Blanchot pose en termes
d’impouvoir.
Cependant, à cette première lecture du romantisme fait pendant une autre entreprise
définitoire de la littérature, plus récente sans doute, mais qui elle aussi s’appuie, et revient sans
cesse, sur la lecture des travaux du groupe d’Iéna et sur l’absolutisation de la littérature. Ainsi,
Jacques Rancière identifie ce moment de prise en charge par la littérature des questions qui lui sont
adressées – et tout particulièrement par la philosophie – comme le moment fondateur de la
littérature au sens moderne, lorsque « le romantisme d’Iéna se caractérise comme la question
critique de la littérature » (Lacoue-Labarthe et Nancy 14). De fait, Rancière conçoit ce moment de
l’histoire littéraire et philosophique comme le départ du régime poétique de la mimésis, vers ce
qu’il nomme « régime esthétique ». Le régime poétique est caractérisé par quatre principes
auxquels doit obéir toute œuvre selon la conception héritée d’Aristote : « [p]rimat de la fiction ;
généricité de la représentation, définie et hiérarchisée selon le sujet représenté ; convenance des
moyens de la représentation ; idéal de la parole en acte »
iii
. Avec l’absolutisation de l’Art, dont les
représentants parmi les plus notables en Angleterre et en France sont Wordsworth et Flaubert, la
notion de littérature change :
On n’entendra donc ici par la « littérature » ni l’idée vague du répertoire des œuvres de
l’écriture ni l’idée d’une essence particulière valant à ces œuvres la qualité « littéraire ». On

3
entendra désormais sous ce terme le mode historique de visibilité des œuvres de l’art
d’écrire qui produit cet art et produit en conséquence les discours qui théorisent cet art :
ceux qui sacralisent l’essence incomparable de la création littéraire, mais aussi ceux qui la
désacralisent pour la renvoyer soit à l’arbitraire des jugements soit à des critères positifs de
classification. (Rancière, La parole 8)
Non seulement cela, mais cette littérature dont le romantisme est l’acte de naissance est frappée de
ce que Rancière nomme « littérarité », c’est-à-dire le principe de bouleversement au moyen duquel
l’écriture réalise son principe démocratique. La réalisation de ce principe démocratique s’ancre à la
fois dans une sorte d’indifférence, d’errance et d’orphelinat de l’écriture.
iv
Indifférence car tous les
sujets peuvent être représentés de toutes les manières ; errance, parce que le texte écrit est
potentiellement accessible à tous et s’adresse à tous de la même manière ; orphelinat, car l’écriture
est détachée de l’énonciateur du poème et ignore l’ordre social, de sorte qu’une forme d’anonymat
lie auteur et lecteur quand c’est le texte lui-même maintenant, plutôt que son auteur, qui s’adresse
aux lecteurs anonymes.
La conséquence de ceci est que l’écriture n’étant plus dans un rapport mimétique aux choses
et au monde, le poème ou le roman (la littérature) ne sont plus concevables comme la surface
visible et donc lisible du monde, peau, enveloppe ou filtre, ce derrière quoi se tiendrait le monde
dont ils seraient l’expression ou le reflet. Le poème lui-même fait et est corps. Il ne s’agit plus de
chercher derrière ou sous lui une réalité dont il serait (à) l’image. Le poème ou les mots sont
« chair »
v
. C’est sans doute là l’aspect le plus saillant du régime esthétique de la littérature.
Pourtant, le passage du régime poétique au régime esthétique n’est ni total ni définitif : la
littérature reste habitée ou hantée à la fois par la rupture avec la mimésis et par le rêve rimbaldien
d’un « verbe poétique, un jour où l’autre, accessible à tous les sens »
vi
. Elle reste travaillée en son
cœur par cette tension, en quoi consiste sa contradiction ou son paradoxe, et que Rancière formule
ainsi :

4
Mais c’est alors le concept de l’écriture qui se dédouble : celle-ci peut être la parole
orpheline de tout corps qui la conduise et l’atteste ; et peut être, à l’inverse, le hiéroglyphe
qui porte son idée sur son corps. Et la contradiction de la littérature pourrait bien être la
tension de ces deux écritures. (Rancière, La parole 14)
L’hypothèse qui est la nôtre est alors la suivante : si le passage qu’identifie Rancière de la
poétique à l’esthétique participe de la politique de la littérature comme répartition ou partage du
sensible, sans rapport avec une quelconque politique de l’auteur à l’instar de l’engagement sartrien,
il constitue du même coup le passage d’une certaine légitimation vers une autre, en ce sens que
l’œuvre n’a a priori plus à chercher en dehors d’elle-même les preuves de sa légitimité, lorsque la
langue est à elle-même son propre horizon et que, pour Flaubert, par exemple, le style est tout.
Ainsi, ce dans quoi la littérature s’éprouve et est éprouvée, c’est le mouvement (sans cesse
renouvelé) par lequel elle pose sa propre question et nous la pose. Son épreuve est son paradoxe, la
tension entre la définition des Belles-Lettres et celle que suggère l’approche de Blanchot qui –
comme le note Rancière – « se garde bien, pour son compte, de [la] ‘définir’ » (Rancière 7).
Traduire l’analyse ranciérienne de la littérature en terme de légitimation de l’écriture permet
d’envisager la notion de régime esthétique comme partage du sensible, par rapport à la nécessité de
questionner la légitimité de tout discours telle qu’elle se fait entendre à partir du romantisme
allemand et dans son sillage. Le partage, qu’il conviendra de préciser, apparaîtra alors comme la
condition de possibilité de la littérature davantage que comme ce à quoi elle se prête. A partir de la
notion de fragment si chère aux frères Schlegel et à leur groupe, et à partir de l’aphorisme plus
particulièrement, nous essaierons de comprendre comment la nécessité de questionner la légitimité
de tout discours, loin d’enfermer la littérature dans la réflexion de ses impasses et ses silences,
l’ouvre bien au contraire à la question de la responsabilité de ceux qui la pratiquent.

5
Si le genre par excellence du « premier romantisme » est le fragment, bien que celui-ci ne
soit pas le seul comme le rappellent Lacoue-Labarthe et Nancy, c’est que le fragment est tout
particulièrement apte à rendre visible la prise en charge par l’écriture de la question de sa légitimité,
et au travers elle, le questionnement de la légitimité de tout discours, c’est-à-dire du même coup,
celui de sa possibilité. Les questions de sa légitimité et de sa possibilité sont les fils entrecroisés du
tissu, pour reprendre une image derridienne, qu’est le produit de l’écriture. À suivre l’un de ces fils,
on suit nécessairement l’autre. Si le premier est celui que nous fait suivre Rancière à travers son
analyse du passage d’un régime de l’art à un autre, le second, on s’en souvient, est déroulé (même
si peut-être un tel fil ne peut-il justement jamais faire l’objet d’un « déroulement » qu’à la condition
d’être toujours enroulé dans le même mouvement) par Blanchot quand en 1942 il demande
« Comment la littérature est-elle possible ? ». Ceci ne revient pas à dire que Blanchot ne pose pas la
question de la légitimité de la littérature ou que Rancière est indifférent à la question de sa
possibilité. C’est plutôt tout le contraire. Chacune de ces questions travaille en profondeur leurs
pensées. Mais c’est sans doute dans la manière dont l’une et l’autre questions se trouvent davantage
appuyées chez ces auteurs, que leurs versions respectives du romantisme se distinguent. Non
seulement cela, mais la perspective qu’adoptent l’un et l’autre sur le fragment est opposée. Ainsi,
quand Blanchot y voit le lieu de l’expérience de la littérature comme limite, Rancière aborde le
fragment non plus comme « ruine » (expression et moyen du désœuvrement), mais comme
« germe » (Rancière, La parole 59). Pour Rancière, c’est dans le fragment que se trouvent
conjuguées l’expression du monde et de la société d’une part, et la littérarité ou « l’art pour l’art »
d’autre part. Or ces deux versants dont Rancière souligne qu’ils appartiennent à un même mode
historique de la littérature, se fondent sur cette autre ligne de partage : l’opposition entre « poésie
immanente du monde » et « poésie tirée de la subjectivité » (Rancière, La parole 55). Ce que
Rancière formule ainsi : « […] c’est peut-être cette téléologie de la continuité retrouvée entre une
poésie immanente du monde et une poésie tirée de la subjectivité qu’exprime le concept schlégélien
du fragment » (Rancière, La parole 59). Si le fragment soulève la question de la légitimité de la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%