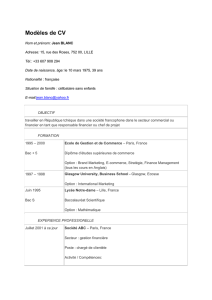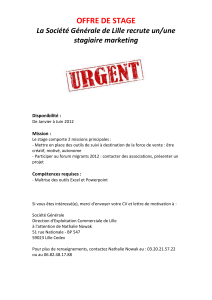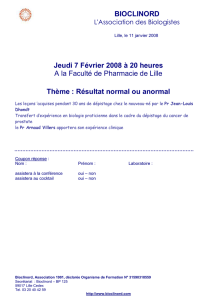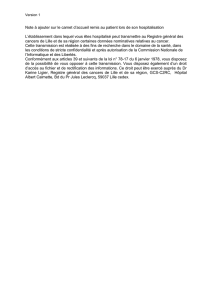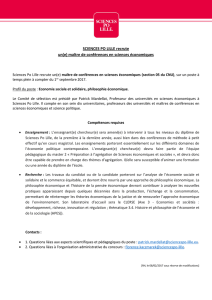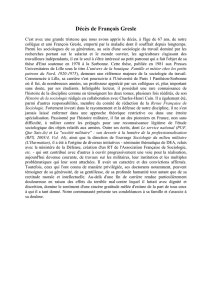De l`état actuel de l`Université - Espace Culture

4
LNA#57 / cycle université
Temps social, avec une séquence de quarante ans, qui
correspond à son existence séparée de l’Université de
Lille (telle que créée en 1896), sous les effets de la loi Edgar
Faure qui en fit, en 1970, l’une des trois nouvelles Universités
publiques lilloises : ce changement statutaire s’accompa-
gnait de l’accueil, inédit dans une Université de sciences
exactes, et très original en France, de trois disciplines,
chacune préoccupée, dans la foulée de Mai 68, de s’éman-
ciper de leurs tutelles respectives, et bien davantage pour
des raisons politiques et idéologiques que pour des raisons
scientifiques (même si celles-ci ont pu, dans le discours,
être invoquées) : la géographie s’émancipant de l’histoire,
l’économie s’émancipant du droit et des sciences politiques
(abandonnant à Lille 2 le droit, la médecine et la pharmacie,
dans une sorte d’entre-soi des professions libérales), et la
sociologie de la philosophie 1.
Espace social, avec son basculement sur ce campus de péri-
phérie, né, dans les années 1960, de l’« ex-urbanisation » de
la Faculté des Sciences de Lille, alors invitée à quitter le
centre de la ville pour les terres arables d’Annapes, dans
un contexte de forte croissance des effectifs étudiants 2, et
en lien à un plan d’urbanisation nouvelle, dit de Lille Est,
conforme aux visions de l’époque (aménagement du territoire,
« grandes métropoles d’équilibre », grands espaces définis par
leur fonction, bâtiments modernes), qui commença donc
par une nouvelle Faculté des Sciences, ouvrant ses portes en
1967, et s’acheva par l’édification d’une « ville nouvelle »,
Villeneuve d’Ascq 3.
1 Arrêtés ministériels du 18 décembre 1969, créant les universités lilloises, et du
20 janvier 1970, approuvant les statuts de l’Université des Sciences et Techniques
de Lille, dite Lille 1. La sociologie est la seule de ces trois disciplines qui n’est pas
encore accueillie officiellement dans la constitution de Lille 1 par l’arrêté du
18 décembre ; inversement, la psychologie, qui y figure, rejoindra de fait Lille 3.
2 En cinq ans, entre 1954 et 1959, les effectifs de la seule Faculté des Sciences
plus que doublent, de 1600 étudiants à 3381. Les étudiants de sciences seront
5476 en 1964 : ils n’étaient que 436 en 1947.
3 Lille-Annapes n’est pas exactement le cas de Nanterre-La Folie, où le projet
de nouveau campus parisien trouve son point de chute dans « un petit terrain
militaire à l’ouest de Paris » dont dispose le Ministre des Armées de l’époque,
Pierre Messmer, et qu’il refile à son collègue de l’Éducation nationale, Chris-
tian Fouchet, sans que le campus ne soit inscrit dans une planification urbaine
d’ensemble : « On ne parle pas d’intégration du campus dans un plan de dévelop-
pement régional, du milieu urbain, des moyens de transport » (L’explosion de mai.
[1] Relation aux études et sociabilités étudiantes : collision
des espaces-temps
Soient deux anciens étudiants des années 60 (celles d’avant
Mai 68) – l’un en philosophie, l’autre en physique – dans
le « quartier latin laïc » de Lille, ce quartier, aujourd’hui
vidé de ses fonctions universitaires et de ses étudiants, que,
quand la jeune Troisième République réorganisait l’Uni-
versité française, la municipalité de Lille, sous la conduite
des républicains (sous le mandat de Géry Legrand), puis
des socialistes (sous le mandat de Gustave Delory), créa de
toutes pièces, pour concurrencer la toute naissante Faculté
catholique (1877) et son « quartier latin chrétien », de sorte
à attirer dans la capitale des Flandres les Facultés de
l’Université de Douai (dont les origines remontent à une
fondation, en 1562, par Philippe II d’Espagne, et ne deve-
nant française qu’en 1712) 4.
Dans le quartier latin chrétien Vauban, architecture et
symbolique néo-gothiques à tous les étages, emblèmes des
milieux catholiques en lutte contre la laïcisation de l’ensei-
gnement menée par les autorités municipales et gouverne-
mentales. Chez son rival, le quartier latin laïc de la place
Histoire complète des événements, Lucien Rioux et René Backmann, éd. Robert
Laffont, 1968). Toutefois, les « annapiens », comme on les nomme à l’époque
(les premiers « annapiens », les « annapiens » de l’Annapes des bâtiments provi-
soires, ont été les étudiants des années de propédeutique et des premières années
d’économie, années dont les effectifs étaient les plus nombreux) commenceront
par venir en bottes à l’Université, et les usagers de la Cité Scientifique devront
attendre le printemps 1984 pour disposer, avec le métro VAL, d’un mode de
transport fonctionnel et rapide, en lieu et place des bus qui les brinqueballent
de la place des Buisses à la Cité Scientifique, en passant par Fives, Hellemmes et
« par tous les villages ».
4 En 1854, quand ré-ouvre l’Université de Douai qui a été fermée par le gouver-
nement de la Restauration, Lille n’a qu’une seule Faculté, la Faculté des Sciences,
créée la même année par décret impérial, et dont Louis Pasteur fut le premier
doyen. Les Facultés de Médecine, Droit et Lettres sont à Douai. La Faculté des
Lettres est transférée de Douai à Lille par un décret de 1887. La Faculté de Droit
et de Lettres de la rue Angellier est achevée en 1892. L’ensemble nouveau de la
Faculté des Sciences, place Philippe Lebon, est achevé en 1886 (à sa création, en
1854, la Faculté des Sciences était établie dans un ancien couvent, sur le site de
l’ancien Lycée Faidherbe, aujourd’hui disparu). Le déménagement complet de la
Faculté des Sciences du centre de Lille à la Cité Scientifique ne sera effectif qu’au
début de l’année 1968 « quand le recteur Debeyre fit couper l’eau et l’électricité
dans les bâtiments de la place Philippe Lebon ». Les Lettres et le Droit ne rejoi-
gnirent le campus du Pont de Bois qu’en 1970, avec l’application de la loi Faure
et le découpage de l’Université de Lille en trois Universités publiques.
De l’état actuel de l’Université [1]
Maître de conférences - agrégé de sciences sociales
Institut de sociologie et d’anthropologie, Université Lille 1
Par Jacques LEMIÈRE *
Soit le début d’une chronique sur l’état actuel de l’Université en général, qui, on le sait, n’est pas bon du tout. Et com-
mençons par y saisir une Université particulière, l’Université Lille 1, dans ses origines comme dans certains éléments
de son temps social et de son espace social.

4
cycle université / LNA#57
5
LNA#57 / cycle université
Philippe Lebon, architecture et symbolique néo-classiques,
large convocation de la mythologie grecque et, sommet
d’une laïcité triomphante, accueil et abri républicain des
religions minoritaires, sous les traits de la synagogue (rue
Angellier, 1881) et du temple protestant (place du Temple),
non loin d’une majestueuse bibliothèque de l’Université qui
prend, elle, les figures solennelles d’un autre temple, celui de
la Raison et de la Science. Dans ces lieux, les murs parlent :
les idéologies et les politiques du quart de siècle qui précéda
la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905 se lisent,
à l’époque tout comme aujourd’hui, dans les géométries de
l’espace et dans les dessins des façades.
Le premier de nos anciens étudiants, à partir de 1962, eut
comme enseignants le philosophe Éric Weil (qui réfléchit
Hegel, dans le sillage d’Alexandre Kojève et de son séminaire
de l’École Pratique des Hautes Études sur la Phénoménologie
de l’esprit, renouvelant la lecture de Hegel en France ;
co-fondateur, en 1946, de la revue Critique avec Georges
Bataille), Weil qui dirigeait, à la Faculté des Lettres de la rue
Angellier, les études de philosophie ; mais, aussi, le jeune
sociologue Pierre Bourdieu, que Weil a fait venir à Lille en
1961 (de la Sorbonne où il était, à son retour d’Alger en
1960, assistant de Raymond Aron 5). Et notre étudiant fut
5 - Weil (1904-1977, qui a enseigné la philosophie à Lille de 1956 à 1968) : « Je
veux imposer la sociologie à Lille, il me faut un normalien ». - Aron, alors à la Sor-
bonne : « Je ne veux pas m’opposer à la carrière de Pierre Bourdieu ». (Témoignage,
en novembre 2010, de Jean-René Tréanton, alors maître-assistant en charge de
l’enseignement de la sociologie dans le cadre de la licence de philosophie, à tra-
vers un certificat de « morale et sociologie » – il n’y a pas encore de licence de
sociologie – associé à la recherche de ce « normalien ». En octobre 1977,
neuf mois après la mort d’Éric Weil, Jean-René Tréanton lui dédie, en tant que
« Philosophus inter pares, Amicus sociologiae et Liliensis corde », un numéro de la
Revue française de sociologie entièrement composé d’articles de sociologues lillois,
dont Claude Dubar, François Gresle, Jean-Paul Tricard et Jean-Pierre Lavaud).
Pierre Bourdieu enseigna à la Faculté des Lettres de Lille de la rentrée univer-
sitaire de 1961 jusqu’à sa nomination à l’École Pratique des Hautes Études en
1964. Les Héritiers. Les étudiants et la culture, l’ouvrage cosigné avec Jean-Claude
Passeron, paru en 1964, doit beaucoup à sa fréquentation et à son dialogue avec
les étudiants lillois (qu’il constitue aussi, pour ce livre, en GTU « Groupes de
travail universitaire » sur « l’interconnaissance chez les étudiants » et « une tenta-
tive d’intégration »), mais aussi avec ses collègues de Lille. Un groupe de travail,
qui avait réuni les sociologues BOUrdieu, PAsseron, REYnaud et TREanton,
avait contribué en mai-juin 1964 à un numéro de la revue Esprit sur l’Univer-
sité (Faire l’Université. Dossier pour la réforme de l’enseignement supérieur), sous
le pseudonyme collectif d’Émile Boupareytre (« L’universitaire et son Université »),
avant que, au lendemain de la parution des Héritiers, les deux premiers ne
s’éloignent des deux autres.
À Lille, en philosophie, enseigne également Suzanne Bachelard, mais qui a peu
étudié les travaux d’épistémologie de son père, de sorte que c’est Bourdieu, qui
prépare aussi Le métier de sociologue (1968), qui est le premier à parler de Bache-
lard et de Canguilhem aux étudiants de Lille ; Bourdieu qui est également très
un de ces nombreux transfuges qui lâchèrent Éric Weil,
« partant de la philosophie dans la valise de Pierre Bourdieu
pour faire de la sociologie ». Il était, dans cette période de
forte politisation du monde étudiant sous les effets de
la guerre d’Algérie, contre les partis et les gouvernements
qui ont engagé le pays dans cette guerre, responsable du
cercle de philosophie des étudiants communistes, qui ne
tarderaient pas à être touchés par la scission, à la veille de
mai 68, précisément dans les années 1966 et 1967, entre
orthodoxes prosoviétiques (PCF et Comité Vietnam national)
et jeunes marxistes-léninistes (UJCML 6 et Comités
Vietnam de Base).
Le second de nos anciens étudiants, de 1960 à 1965, eut
comme professeurs, à la Faculté des Sciences de la place
Philippe Lebon, le mathématicien Michel Parreau et
le physicien Jacques Tillieu, qui furent, successivement et
respectivement, les doyens créant les collèges scientifiques
universitaires étendant la Faculté des Sciences de Lille dans
la région (Calais, Valenciennes, Amiens et Saint-Quentin),
puis réalisant le déménagement de cette faculté du centre
de Lille à Annapes. Il incarne, lui, l’engagement politique
dans la dimension du syndicalisme étudiant de l’époque,
puisqu’il fut un responsable de l’UNEF (une UNEF dans
toute sa force, avant qu’elle ne connaisse, elle aussi, le pro-
cessus de la scission entre communistes et trotskistes) et de
l’AGEL (Association Générale des Étudiants de Lille, extrê-
mement organisée et très intervenante).
Soient deux groupes d’étudiants d’aujourd’hui, étudiants
en sciences humaines à la Cité Scientifique de « Lille 1
- Sciences et Technologies » : un groupe d’étudiants en socio-
logie de niveau Mastère première année, un groupe d’étu-
diants en ethnologie de niveau Licence troisième année.
Bacheliers 2007 ou 2008, donc. Faisons-les rencontrer nos
bacheliers du début des années soixante, l’ancien étudiant en
philosophie – en décembre 2010, pour les étudiants de M1
sociologie –, et l’ancien étudiant en physique – en février
2011, pour les étudiants de L3 ethnologie – dans une salle
d’un bâtiment de physique attribuée aux sociologues et eth-
nologues (c’est Lille 1).
proche, à Lille, des grands hellénistes que sont Jean Bollack, Mayotte Bollack
et Heinz Wismann. En psychologie sociale viendra aussi Robert Castel ; et en
sociologie, plus tard, Christian Baudelot.
6 Union des Jeunesses Communistes Marxistes - Léninistes.
Bibliothèque Universitaire,
Cité Scientifique, Université Lille 1

6
LNA#57 / cycle université
Alors, dans une véritable collision des espaces-temps, les
étudiants entendent des choses pour eux stupéfiantes, dans
les récits par lesquels ces prédécesseurs, décidément bien
lointains et exotiques, redonnent vie à ce qu’étaient leur
relation aux études et la sociabilité étudiante à l’œuvre dans
cette séquence 1961-1968, dans ce lieu urbain qu’était le
quartier Philippe Lebon.
Ils y entendent que « les frontières disciplinaires n’y avaient
pas grand sens entre étudiants de sciences, étudiants de lettres,
étudiants de l’école d’ingénieurs (l’Institut industriel du
Nord) ou des Arts et Métiers » ; que les cafés du quartier, qui
se faisaient face, aux angles de la rue Nicolas Leblanc avec la
place Philippe Lebon (« La Source », l’actuel « Matignon »
et le café des sœurs Crinquette, aujourd’hui disparu) sont
alors des lieux de rencontre in-disciplinaires, littéraires et
scientifiques confondus, et que « la conception d’un campus
cloisonné en disciplines, d’une logique disciplinaire de l’espace
n’adviendra qu’avec la conception architecturale et urbanistique
de la Cité Scientifique » ; que « les éléments majeurs de clivage
étaient politiques (les prises de position sur la guerre d’Algérie
qui, vers sa fin, jouait un rôle énorme, puis, après 1962, sur
la guerre du Vietnam », mais aussi « cinéphiliques, les goûts
en matière de cinéma étant facteur de regroupement, dans une
atmosphère de cinéphilie exacerbée où, à cette époque, le ciné-
ma avait remplacé le roman, comme Badiou le fait justement
remarquer dans des commentaires délivrés en marge de son
livre Cinéma 7, où le cinéma, passion centrale, « voisinait
avec des lectures qui n’étaient que des lectures théoriques » ;
que la vie sociale et politique étudiante, outre les cafés (« on
travaillait beaucoup au bistrot »), avait un centre névralgique
situé au début de la rue de Valmy 8, l’ « U1 » (« le vrai cœur
de la vie étudiante de l’époque, c’était l’U1 »), avec son res-
taurant (en convention avec le CROUS, mais entièrement
géré par l’AGEL), son bar, son imprimerie, où, outre des
polycopiés de cours et une infinitude de tracts, s’imprimait le
« Lille-Université » (ou « Lille-U »), avec ses soirées cultu-
relles et musicales, entièrement organisées par les étudiants
(« la culture était gérée par les étudiants eux-mêmes » : le théâtre,
le ciné-club, les concerts de jazz), avec ses fabrications et
ses distributions de tracts sur les sujets qui fâchent, avec
7 Nova éditions, Paris, 2010, recueil des articles publiés, sur le cinéma, par Alain
Badiou entre 1957 et 2010.
8 « L’U1 » traversa les années 1970 dans une atmosphère de scissions syndicales,
puis fut détruit, c’est-à-dire rasé par le Maire de Lille, Pierre Mauroy, bien que
n’appartenant pas à la Ville.
aussi ses « gardes de l’U », gardes « militaires » contre les
coups de l’extrême-droite et les plasticages de l’OAS 9, avec
les manifestations qui partent de l’U1 ou qui se terminent
à l’U1 ; que, dans tout un cursus d’études de philosophie
et de sociologie, « on ne pouvait avoir, finalement, étudié
pratiquement qu’une seule question, rapportée au débat entre
marxisme et structuralisme, entre Marx et Lévi-Strauss » ;
qu’on pouvait croiser un doyen vous faisant remarquer ma-
licieusement « vous avez toujours un livre sous le bras mais ce
livre, à coup sûr, n’est pas au programme » ; que la préoccu-
pation de l’emploi, après les études, était absente du temps
des études ; qu’on « avait une vie intellectuelle très décon-
nectée des programmes de fac », qu’ il « ne fallait pas payer le
diplôme plus cher que nécessaire », mais qu’on considérait que
« dès lors qu’on lisait, on bossait », d’où que « la vénérable »
Bibliothèque, « sa salle de lecture extraordinaire, dont on
respectait le silence, alors que le moindre bruit s’y entendait »
était « un lieu plus important que la Fac » ; que la librairie
Meura était « ce lieu, extrêmement sympathique, où on trou-
vait des livres rares, où le libraire faisait des recherches, où on
allait préparer des devoirs, carnet en main », « la seule librairie
qu’on ne volait pas » ; qu’on pouvait aller suivre les cours de
marxisme que Michel Simon, un des fondateurs de l’Insti-
tut de sociologie 10 donnait le soir au local de l’UEC 11, rue du
Barbier Maes ; que Bourdieu, qui ne restait généralement
pas sur Lille, pouvait offrir à un étudiant le billet aller
et retour Lille-Paris pour poursuivre avec lui une conver-
sation qui durerait donc les deux heures et demie du train
de l’époque (« tout ce que vous lui donniez revenant trois
semaines plus tard transformé en du Bourdieu, plus rien ne
vous appartenant plus ») ; et que le même Bourdieu refusait
toute question des étudiants à l’issue de ses cours, n’acceptant
des questions écrites qu’après que ses étudiants les aient
médités pendant la semaine suivante 12 ; que les militants, à
coup sûr, n’étaient pas en mesure de passer leurs examens
en juillet, et qu’une quarantaine d’étudiants, tous maîtres
d’internat ou surveillants d’externat, ne pouvant être prêts
9 Organisation Armée Secrète.
10 À la Cité Scientifique de Lille 1, en 1970, avec Jean-René Tréanton, sociologue,
et Jacques Lombard, ethnologue.
11 Union des Étudiants Communistes.
12 De quoi rendre Bourdieu méconnaissable à ceux qui, ne connaissant son
œuvre que par la vulgate qui en est issue, se méprennent sur le sens de sa pensée
de l’éducation et du système éducatif.

6
cycle université / LNA#57
7
LNA#57 / cycle université
pour les examens de juillet, passaient tout l’été, en groupe,
préparant leurs examens de septembre, restant travailler à la
Bibliothèque universitaire qui fermait à peine, un restau-U
restant également ouvert pendant l’été, « avec un plaisir fou
de vivre la ville vide », ce qui, de fait, distinguait les étu-
diants entre « juilletistes » et « septembristes » ; qu’alors on
ne distribuait pas des journaux gratuits à la porte de l’U1 ou
à la gare, mais qu’on y vendait « Le Monde » (« et qu’un étu-
diant pouvait gagner 10 centimes par numéro – le journal en
coûtant 30 à l’époque – s’il en était un vendeur ») ; et que ce
sévère quotidien était lu par les étudiants, et pas seulement
vendu par certains d’entre eux, qu’il était donc « le journal
des étudiants » puisqu’un étudiant de sociologie, à qui Bour-
dieu faisait chercher des statistiques sur la présence habi-
tante des étudiants dans tel quartier, avait découvert que le
chiffre des ventes du « Monde » dans ce quartier « pouvait
en être un bon indicateur, petit indicateur bricolé, dès lors que
les autres lecteurs, qui étaient les profs, y étaient abonnés »…
D’où une fascination non exempte de trouble, chez les étu-
diants actuels, devant ces prédécesseurs qui « se sentaient
plus soustraits à la société que les étudiants d’aujourd’hui ne
le sont » et qui, s’adressant à ces derniers, ont alors eu « plus
l’impression de parler d’un moment que d’un lieu, un mo-
ment pris entre la guerre d’Algérie et Mai 68, un moment très
politique ». (À suivre)
* Jacques.Lemiere@univ-lille1.fr
Merci, pour leurs témoignages, à Jean-René Tréanton, Gérard Engrand
et Bernard Maitte ; et, pour avoir reçu ces deux derniers, aux étudiant(e)s
des promotions 2010-2011 des cours de « Outils et pratiques audiovisuels »
(M1, sociologie) et « éories, auteurs et méthodes » (L3, ethnologie).
Ancienne Bibliothèque Universitaire,
devenue Maison de l'Éducation Permanente, Lille
1
/
4
100%