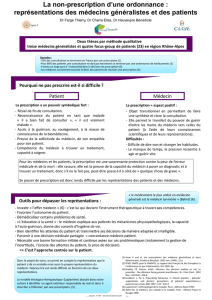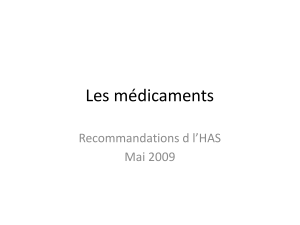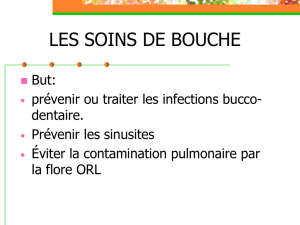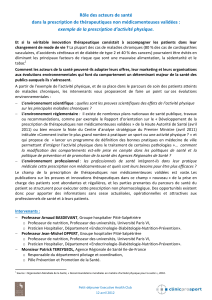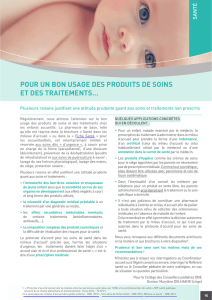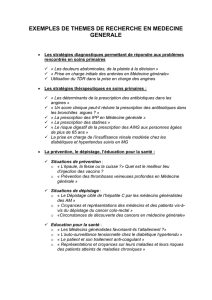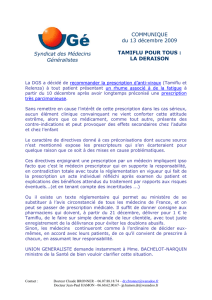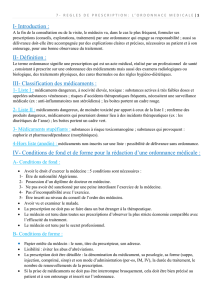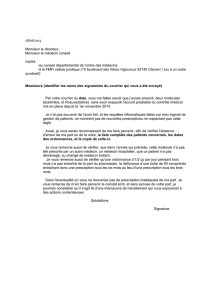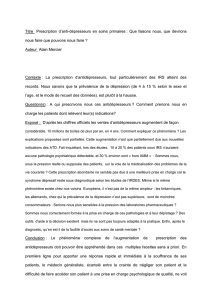ce qu`en disent les médecins généralistes - chu

Sciences Sociales et Santé, Vol. 31, n° 3, septembre 2013
Polyprescription médicamenteuse
et polypathologies chroniques:
ce qu’en disent
les médecins généralistes
Pascal Clerc*, Julien Le Breton**
Résumé. Dans un contexte de dépenses de santé croissantes, de scanda-
les pharmaceutiques, d’émergence de patients polypathologiques chro-
niques, la prescription des médecins généralistes est régulièrement remise
en cause. Mais la gestion au quotidien du patient polypathologique par
ces praticiens est mal connue. Nous avons donc réunis 60 médecins géné-
ralistes, pendant une journée, pour, d’une part, réfléchir sur leur pratique
et, d’autre part, discuter en groupes de pairs autour de diagnostics et de
prescriptions réelles de patients polypathologiques chroniques. Les résul-
tats présentés ici montrent le réseau complexe qui se noue en arrière fond
de la relation médecin-malade dans ce contexte. La conclusion est qu’il
doi: 10.1684/sss.2013.0305
* Pascal Clerc, médecin généraliste, 32, rue Aristide-Briand, 78130 Les Mureaux,
France ; [email protected]
** Julien Le Breton, médecin généraliste, Centre Municipal de Santé, 12-14 rue du
Général De Gaulle, 94400 Vitry-sur-Seine, France ; [email protected]
Remerciements : Karine Chevreul pour les conseils méthodologiques, Pascal Arnould,
François Raineri et Gilles Hebbrecht pour l’animation des groupes et les 60 médecins
généralistes participants.
Financement : CNAM-TS, Haute Autorité de Santé.

72 PASCAL CLERC, JULIEN LE BRETON
ne sera pas possible d’améliorer la prise en charge de ces patients en
ambulatoire sans une réorganisation majeure du système de soins et un
changement culturel dans la coopération entre professionnels de santé.
Mots-clés : polypathologies chroniques, polyprescription, médecine
générale.
Contexte
«Les médecins généralistes prescrivent trop»! Qu’est-ce à dire?
Pour l’Assurance maladie, il s’agit du volume global des prescriptions
médicamenteuses comparé aux pays européens et d’Amérique du Nord
(Nguyen-Kim, 2005). Mais derrière le «trop prescrire» se cachent des
allusions «au mal prescrire»: service médical rendu insuffisant, médica-
ments inutiles, surprescriptions, iatrogénie. Or, s’il existe des analyses sur
la prescription médicamenteuse, elles reposent sur des données agrégées
de l’ensemble des prescripteurs quelle que soit leur spécialité (Donohoe,
1998). Elles comparent en général des pratiques réelles à des référentiels
de bonne pratique centrés sur une seule pathologie. Si l’on sait que certai-
nes prescriptions médicales peuvent être améliorées (Clerc et al., 2009),
on s’intéresse peu aux difficultés auxquelles se disent confrontés les
médecins conduits à gérer des polyprescriptions, le non-respect des réfé-
rentiels n’en étant qu’un des symptômes (Cogneau et al., 2007). Une
dimension reste particulièrement méconnue : la prise en charge des
malades polypathologiques chroniques qui nécessite une polyprescription
répétée.
La polyprescription est impossible à éviter et représente un enjeu
important de santé publique, particulièrement chez les personnes âgées
(Ankri, 2002; HCSP, 2002; Queneau, 1998). Elle a cinq conséquences
majeures : l’augmentation du nombre de traitements inappropriés, l’aug-
mentation du risque d’interactions médicamenteuses potentiellement dan-
gereuses, l’augmentation du risque de contre-indications liées à plusieurs
pathologies concomitantes, la diminution de l’observance des traitements
par les patients, l’augmentation du coût de la prise en charge (Fialova et
al., 2005; Spinewine et al., 2007). Ce qui est inédit pour les médecins
généralistes aujourd’hui, c’est qu’en situation de polyprescription, ils doi-
vent gérer une nouvelle dimension de leur exercice : la prévention du

POLYPATHOLOGIES CHRONIQUES ET PRESCRIPTION 73
risque iatrogène immédiat et dans la durée (1), pour des médicaments de
plus en plus efficaces mais potentiellement dangereux.
Par ailleurs, nous vivons une situation de transition épidémiolo-
gique: la population est vieillissante et la médecine ambulatoire prend en
charge de plus en plus de patients atteints de maladies chroniques, ce qui
représente actuellement la moitié de leur activité. Cette transition a au
moins un double impact pour les médecins généralistes: d’une part, ils
doivent gérer des patients polypathologiques, alors que leur formation
médicale initiale est centrée sur l’étude des organes et des pathologies
considérées une à une et, d’autre part, l’organisation du cabinet médical
est orientée vers la prise en charge de pathologies aiguës, c’est-à-dire des
consultations courtes, non programmées et payées à l’acte (Gouyon,
2006).
La présence de la polypathologie et de la polymédication est relati-
vement bien documentée en population générale (Allonier et al., 2006).
Ainsi, les personnes déclarent en moyenne 2,9 troubles de santé un jour
donné et le nombre de maladies associées déclarées augmente avec l’âge:
4 pour les 40-64 ans, 5 pour les 65-79 ans et 6 pour les personnes de
80 ans et plus (Knottnerus et al., 1992). En revanche, en l’absence de don-
nées permanentes et exhaustives permettant de connaître l’ensemble des
motifs de recours auprès du médecin généraliste (2), il n’est pas évident
de se faire une idée précise de la fréquence et de la nature de la polypa-
thologie et de la polymédication en médecine générale, en France. Les
données de consommation médicamenteuse disponibles concernent essen-
tiellement les personnes âgées de plus de 65 ans qui consommaient, fin
2003, 35 % des médicaments utilisés en France (Sermet, 2002).
L’hospitalisation pour cause iatrogène représenterait 5 à 10 % des hospi-
talisations des plus de 65 ans et 20 % des plus de 80 ans. Parmi les plus
de 69 ans, 10 % consomment 19 % des dépenses de médicaments et 43 %
des dépenses ambulatoires (Sermet, 1999). Cependant, ces approches des-
criptives ne nous informent pas sur les «panachages» de pathologies et
de médicaments auxquels sont confrontés régulièrement les médecins
généralistes et, de plus, ces situations ne se retrouvent pas uniquement
chez les personnes âgées (Lechevallier-Michel et al., 2005 ; Sermet,
2002).
(1) Un effet indésirable peut se révéler plusieurs mois après la prescription d’un pro-
duit pharmaceutique.
(2) Il est possible de connaître la nature de l’ALD (affection de longue durée) pour les
patients consultant pour la ou les pathologies donnant lieu à exonération, mais pas
leurs comorbidités associées (données CNAM-TS).

74 PASCAL CLERC, JULIEN LE BRETON
Les informations disponibles sont en définitive peu opérationnelles
pour comprendre ces prises en charge complexes et leurs déterminants, et
ce d’autant plus que les médecins généralistes les effectuent dans un
contexte «ouvert» qui présente les caractéristiques suivantes : le méde-
cin généraliste n’intervient pas seul, il doit ajuster les traitements qu’il
prescrit avec ceux d’autres prescripteurs hospitaliers et/ou spécialités de
ville; il doit, au cours d’une même consultation, négocier avec le patient
le fait de continuer à prendre ses traitements chroniques et, souvent, trai-
ter des problèmes aigus intercurrents (parfois médico-sociaux); il est éga-
lement confronté aux difficultés de faire adopter une approche
hygiéno-diététique et comportementale des facteurs de risques, en parti-
culier cardiovasculaires (éducation thérapeutique et approche centrée sur
le patient); il peut certes de plus en plus s’appuyer sur des recommanda-
tions de bonne pratique, mais celles-ci sont encore principalement cen-
trées sur une approche mono-problématique, même si une évolution
s’amorce avec la prise en compte de populations plus spécifiques de la
médecine de premier recours; il est confronté à une innovation médica-
menteuse rapide et à une pression de l’industrie pharmaceutique qui peu-
vent remettre en cause des schémas thérapeutiques éprouvés avec des
molécules plus anciennes (Bras et al., 2007); enfin, les outils informati-
sés d’aide à la prescription (quand ils sont utilisés) mettent à la disposition
des médecins des informations certes utiles, mais qui ne donnent pas de
règles de décision dans nombre de cas complexes. Du côté de la demande,
les rapports entre patients et médecins, comme leur rôle dans le système
de soins, connaissent des transformations importantes. Ces patients, plus
critiques, disposent de meilleures connaissances et souvent de plus d’in-
formations. Ils sont en capacité de mieux formuler leurs attentes vis-à-vis
du système de santé et des professionnels, aidés en cela par le développe-
ment de l’expertise associative (CISS, 2011; Lascoumes, 2002). La loi de
2002 permet aux patients et à leur entourage d’intervenir dans la décision
médicosociale, notamment lors du maintien au domicile et de la fin de vie
(3). Par ailleurs, le rôle de la famille, en partie discrédité du fait de l’ins-
titutionnalisation de la médecine scientifique (Orfali, 2002), est appelé à
reprendre sa place avec les soins à domicile dans le cadre d’une réaffir-
mation des soins primaires et d’une rationalisation des soins hospitaliers.
La majorité des travaux en sciences sociales portant sur la médecine géné-
rale s’attachent essentiellement à étudier les modes de pratique et d’orga-
nisation des médecins généralistes (Bloy, 2010; Bungener, 2002). Nous
proposons d’explorer ici la complexité de l’objet «polypathologie chro-
nique» qui constitue de plus en plus la matière sur laquelle travaillent
(3) Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

POLYPATHOLOGIES CHRONIQUES ET PRESCRIPTION 75
aujourd’hui les médecins généralistes. Si la décision médicale a fait l’ob-
jet de publications techniques (Grenier, 1990) et sociologiques (Dodier,
1993; Véga, 2009), le traitement par les médecins de la polypathologie
chronique et ses déterminants demeurent peu connus, alors qu’est déplo-
rée l’existence d’une polyprescription inadaptée. Il s’agit donc, dans cet
article, d’ouvrir cette boîte noire et de chercher à mieux appréhender les
processus de décisions médicales en matière de polyprescription des
patients polypathologiques chroniques, à partir des éléments de réflexion
proposés par les médecins généralistes eux-mêmes.
Données et méthodes
L’analyse qualitative, proposée ici, s’inscrit dans l’étude
Polychrome qui, lors de sa première phase, a élaboré une typologie des
séances consacrées aux patients polypathologiques chroniques, sur la base
des données 2002/2004 de l’Observatoire de la médecine générale (OMG)
(4) de la Société française de médecine générale (SFMG) (5). Cette typo-
logie se présente comme un indicateur de la complexité et de la charge de
travail potentielle du médecin (Clerc et al., 2008).
Pour réaliser la phase de l’étude dont les résultats sont présentés ici,
nous avons choisi deux méthodes. Dans un premier temps, nous avons uti-
lisé la méthode des focus groups, groupes de discussion animés par des
modérateurs dont le but était d’obtenir des informations relatives aux opi-
nions et attitudes des médecins sur le thème de l’optimisation de la poly-
prescription de leurs patients chroniques, avec les questions suivantes
pour initier, puis animer cette séance: « Qu’est-ce qu’une polyprescrip-
tion non optimale pour vous ? Pensez-vous que certaines de vos poly-
prescriptions ne sont pas optimales ? Si oui, pourquoi? Avec des exemples
de patients qui vous viennent à l’esprit. Pourquoi pensez-vous que certai-
nes ne peuvent pas être optimisées ? Comment les gérez-vous ? Avec des
exemples de patients qui vous viennent à l’esprit». Le nombre de méde-
cins était de 6 par groupe et la durée du focus group était de 1 h 30.
(4) http://omg.sfmg.org/
(5) http://www.sfmg.org/accueil/
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%