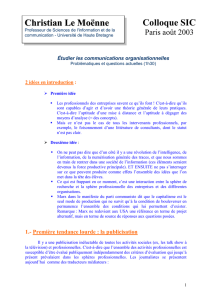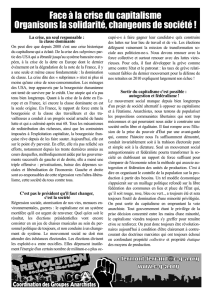Capitalisme consommation, information. Une combinaison

CAPITALISME,
CONSOMMATION,
INFORMATION,
UNE COMBINAISON
FATALE ?
Alain Tihon,
chercheur-associé à Etopia
Novembre 2009

222222 Page 2 sur 11

333333 Page 3 sur 11
Avant -propos
Nous avons dépassé les limites physiques de notre planète. Tous les indicateurs sont au rouge.
Or il semblerait que, devant l’urgence de l’action, nous restions saisis d’une étrange torpeur.
Comment l’expliquer, si ce n’est que le nom de Dieu est « Consommation » et que nous soyons
condamnés à ne vivre que pour elle ? Nous nous sommes soumis à l'État-providence, nous nous
soumettons à l'idéologie1 du marché parce qu'ils changent les pierres en pains et que nous ne
pouvons cesser de nous en rassasier. Angoissés par le cancer qui ronge notre Terre, coupables
aussi, car il est notre œuvre, nous nous trouvons impuissants face à nos désirs contradictoires.
Il nous faut changer... sans renoncer au pain. La démesure financière a catalysé les crises,
économique, culturelle, sociale, environnementale. Nos sociétés sont malades et nous ne
pouvons plus nous le cacher.
Nous nous proposons dans ce texte d’explorer le lien qui s’est créé entre l’économie de
marché, l’information et le conditionnement. Notre soumission et l’angoisse qui
l’accompagne, sont liées à la « machine informationnelle » qui s’est progressivement
constituée depuis la révolution néo-libérale de la fin des années 70. C’est une machine à
conditionner, indissociable de l’« économie de marché » qui sert de paravent commode au
capitalisme. Sans la machine, la consommation de masse serait impossible.
L’attraction qu’elle exerce, aussi puissante soit elle, n’est cependant pas fatale. Nous devons
nous dé-conditionner, imaginer d’autres modèles que celui d’un développement dominé par la
consommation de masse, avatar sans issue du capitalisme. Pour ce faire nous proposons de
raisonner en termes de « production sociétale globale » que nous définissons comme la
combinaison de la production de quatre sphères interactives regroupant les activités humaines
ce qui a l’avantage de restaurer l'importance du jeu démocratique fortement obéré par le
conditionnement.
Le m anagement « ho ku s, po kus ! » des ba nqu es
Nous introduisons notre réflexion sur la machine informationnelle par un détour du côté des
banques. Leur exemple est intéressant à plus d’un titre. De par leur métier et la place qu’ils
occupent dans l’économie, les banquiers sont supposés décider et se comporter
rationnellement. Ils sont en outre de très gros consommateurs d’information qu’ils sont censés
analyser objectivement. Telle est d’ailleurs l’image d’eux mêmes qu’ils se sont plus – et se
plaisent encore – à projeter. Or la récente crise financière vient de nous exposer le tableau
d’un monde financier frappé de folie entraînant tous les acteurs dans sa dérive. Mais jugeons-
en plutôt.
Il était une fois un comité de direction dans une très grande banque qui écoutait, dans un
silence studieux, l'exposé sur les merveilles des produits financiers que donnait le plus jeune
et le plus brillant de ses membres. « Je n'ai pas tout compris », avoua l'un d'eux à un collègue
après la réunion. « Moi non plus », rétorqua l’autre « mais son résumé est en tous points
remarquable: hokus, pokus, turluru et le risque a disparu ! ». « Une très belle synthèse en
vérité », opina le premier.
Or le risque est inhérent au métier du banquier. En effet, la banque est un intermédiaire entre
les investisseurs et épargnants qui souhaitent investir leur argent et les entrepreneurs,
porteurs de projets, qui recherchent les moyens financiers nécessaires pour les réaliser et les
développer. Les banques font circuler l'argent en avançant des fonds au moyen d'opérations de
crédit, en prêtant leur signature en garantie des opérations nouées par les parties, en aidant
les entrepreneurs à couvrir les risques dus aux incertitudes de la vie des affaires et en
conseillant les déposants dans leurs placements. Elles remplissent ainsi des fonctions
essentielles à la vie économique.
En exerçant son métier, la banque court des risques. D'une part, les bénéficiaires économiques
de ses avances et garanties peuvent faillir à l'exécution de leurs obligations et, d'autre part,
elle peut se tromper dans les conseils qu'elle donne à ses clients. Les banques se protègent en
s'entourant de multiples précautions. Elles sont aussi tenues de respecter toute une batterie
de coefficients entre, pour faire simple, les volumes et les durées de leurs créances et de
leurs engagements. Le banquier est donc un spécialiste du risque économique2. Cette
spécialisation est à la base de la confiance que lui accordent ses clients. Même s'il se fait aider
1 Dans ce texte, « idéologie » est pris au sens d’un système d’interprétation définitive du monde qui
s’émancipe de la réalité en poursuivant la logique d’une idée.

444444 Page 4 sur 11
par divers outils de modélisation des risques, il ne peut échapper au devoir impérieux d'un
examen critique et personnel de sa clientèle pour forger son intime conviction et estimer les
risques qu'il est prêt à assumer. Les opinions d'autrui, aussi fondées et pertinentes soient-elles,
ne servent qu'à l'éclairer mais ne peuvent se substituer à son propre jugement.
Avec la révolutions néo-libérale de ces 30 dernières années et la dérégulation du monde
financier3 dont elle fut le moteur, les banquiers ont jeté aux orties les fondements de leur
métier. Nous avons assisté à une financiarisation mondialisée de l'économie entraînant le
gonflement sans frein d'une économie financière qui s’est totalement déconnectée du service
à l'économie réelle. L'avidité fut poussée à l'extrême. On a exigé des entreprises des taux de
rentabilité incompatibles avec un exercice normal de l'activité. La seule perspective est
devenue le profit immédiat des financiers, des actionnaires et des dirigeants alors qu’investir,
c’est penser à moyen et long terme.
Les quelques chiffres qui suivent sont éloquents quant à l'ampleur du gouffre qui a fini par
séparer l'économie financière de l'économie réelle. Cette dernière, mesurée par le PIB
mondial, représentait en 2006, 48.400 milliards de dollars (48,4 téradollars) face à une
économie financière dans laquelle, en 2007, l'ensemble des transactions sur le marché des
changes était de 3,2 téradollars par jour et les transactions en produits dérivés de 2,1
téradollars par jour. Une dizaine de jours suffisent donc pour que le volume des transactions
financières dépasse le PIB mondial. Le volume des produits dérivés de crédit (Credit Default
Swaps ou CDS) atteignait en 2006 quelques 62.000 milliards de dollars.
Les institutions financières ont gagné des sommes pharamineuses en construisant un pareil
« casino » financier qui repose sur une ingénierie financière dont le trait marquant fut de faire
disparaître le risque en le noyant dans une chaîne inextricable d'interdépendances complexes
entre produits et acteurs4. Les banquiers voulurent s’émanciper du service direct à l’économie
et oublier que le risque est une réalité dure et opiniâtre. Perdus dans leurs mirages financiers,
au bord des précipices béants sous leurs pas, ils poursuivirent leur course vers l’abîme. Le
simple bon sens eût pourtant exigé qu'ils ne prêtent pas d'argent à des clients qui, dés le
départ, étaient incapables de rembourser. Alors, lorsque cette incapacité s’est avérée, la
vessie financière a bel et bien crevé. Et comme elle avait englouti l'économie réelle, celle-ci
s'est également effondrée. Tétanisées, les banques ont cessé de faire circuler l'argent,
paralysant ainsi l'économie.
Il ne s'agit aucunement de faire ici, à posteriori, une analyse facile mais de souligner d'abord
la forfaiture de l'industrie financière et ensuite le fait que les garde-fous existaient, que les
dangers étaient connus et documentés, l'information présente en abondance avec les analystes
capables d'en saisir la portée. Les avertissements n'ont pas manqué avec la survenance durant
ce dernier quart de siècle de crises prémonitoires5, sans compter toutes les leçons tirées du
krach de 1929, dont les mânes furent chaque fois invoqués6, mais en vain semble-t-il, pour
conjurer les nouvelles et futures crises. Alors comment comprendre un tel aveuglement face
au désastre?
2 Son domaine de compétence ne concerne pas les dangers du vent qui emporte les tuiles d'un toit,
l'inondation, l'incendie ou les autres aléas de la vie.
3 La dérégulation s’est traduite par l’affaiblissement puis l'effacement des autorités responsables du
contrôle des marchés financiers.
4 Sur le thème de la crise financière déclenchée par les subprimes, lire dans le New York Times « A
Catastrophe Foretold » de Paul Krugman , NYT, 26 octobre 2007, de même que l'analyse de Edmund L.
Andrews « Fed Shrugged as Subprime Crisis Spread », NYT, 18 décembre 2007. Lire également « Quand la
finance prend le monde en otage » et « Comment protéger l’économie réelle? » de Frédéric Lordon, Le
Monde diplomatique, septembre 2007 et « Comprendre la crise du crédit struturé » de Michel Aglietta dans
La lettre du CEPII, N° 275 février 2008. Lire du même auteur « La crise », Éditions Michalon Paris, 2008.
5 1987, krach des marchés d’actions ; 1990, krach des junk bonds (obligations pourries) et crise des Savings
& Loans (caisses d’épargne américaines) ; 1994, krach obligataire américain ; 1997, première tranche de
crise financière internationale (Thaïlande, Corée, Hongkong) ; 1998, deuxième tranche (Russie, Brésil) ;
2001-2003, éclatement de la bulle Internet, Enron , puis finalement la crise des subprimes.
6 Pour l’analyse du krach de 29, qui présente bien des similitudes avec la crise financière actuelle, voir « La
crise économique de 1929 » de J.K. Galbraith, Petite bibliothèque Payot, Paris 2008.

555555 Page 5 sur 11
Capi talisme e t mac hi ne in formati on nelle
La démesure (l’hubris) des banquiers, se nourrissant de l’excès de leurs libertés7, trompés par
leurs propres discours, en s’y installant, les confortant et les amplifiant, explique en partie le
phénomène. Elle a accru l’impact de facteurs plus techniques8. Mais il y a autre chose. Tous
les acteurs, quels qu'ils soient, se sont enfouis la tête dans le sable face à l’exubérance de la
financiarisation car elle leur convenait. En oubliant les risques sous-jacents, l’abondance de
crédit a financé la prodigalité clinquante de la course à la consommation. celle-ci, jointe à la
perspective de gains fabuleux, à l'exaltation de l'hédonisme couplée à un individualisme dont
l’égoïsme n’est pas absent, ont constitué autant de tentations auxquelles il était facile de
succomber. Elles s’inscrivent d’ailleurs dans la logique du système.
La réalité est que nous vivons dans une économie capitaliste qui se cache derrière les termes
commodes et aseptisés d’« économie de marché », nom donné à la théorie économique
dominante, d'inspiration néo-classique ou néo-libérale, dont l’usage s’est imposé avec la
révolution néo-libérale. Voici ce qu'en disait J.K. Galbraith9: « De toute évidence, le
capitalisme, ça ne marchait pas. Sous ce nom là, il [le système économique] était
inacceptable. On se mit donc ardemment en quête d’une dénomination plus douce. […] C’est
ainsi qu’est apparue, dans la langue un peu savante, la formule ‘’économie de marché’’. Elle
n’avait aucun passif historique, et d’ailleurs pas d’histoire du tout. Il eût été difficile, en
fait, de trouver un nom plus vide de sens, et ce fut l’une des raisons de ce choix. » Nous
verrons plus loin l’importance que revêt l’utilisation de ce terme.
Très schématiquement, cette théorie enseigne que les agents10, parfaitement rationnels et
disposant d'une information parfaite, guidés par la « main invisible » du marché (elle réalise
l'équilibre entre l'offre et la demande), en cherchant à satisfaire leurs besoins personnels, les
font converger automatiquement vers la satisfaction de l'intérêt commun, traduit dans
l'utilisation optimale des ressources disponibles. Nombre d'économistes en font l’égale d’une
religion révélée11, d’autres, par exemple J.K. Galbraith, J.E. Stiglitz, P. Krugman..., trouvent
cependant peu pertinente cette vision mécaniste de l’économie et la questionnent à juste
titre.
Il faut néanmoins reconnaître que, poussé au départ par la recherche de l’intérêt et du profit
ainsi que par les possibilités offertes par la révolution industrielle, le capitalisme s’est montré
efficient pour offrir des biens et services à un coût raisonnable et répondre ainsi à une foule
de besoins. Ce faisant, il a inscrit la relation entre l’offre et la demande sur une spirale
croissante dans laquelle progrès, prospérité et croissance se sont progressivement
interpénétrés en se confondant12. Elle est d’autant plus forte que la technologie et le
processus d’innovation – la destruction créatrice – poussent à augmenter l’offre pour toujours
plus de demande.
Soulignons également que le rôle des banquiers est capital dans ce processus. Ils en sont les
serviteurs honorés et efficients car, par leur travail d’intermédiation, ils l’alimentent en lui
fournissant les moyens financiers nécessaires.
Le maelström d'information dans lequel nous baignons nous pousse d'ailleurs sans relâche dans
la dynamique de cette spirale de croissance.
Le volume de la production d'information est effarant. Les chercheurs de l'université de
Californie à Berkeley estiment que chaque année, 800 mégabytes d'information (tous supports
confondus) sont produits dans le monde par habitant de la planète. Cela fait pratiquement 4,8
exabytes d'information par an, l'équivalent de quelques 480.000 bibliothèques du Congrès des
États-Unis13-14. Un nombre limité de très grosses entreprises se partagent le gâteau. AOL, Time
7 Dans tous les domaines : rémunérations, formation de « monstres financiers » regroupant des activités
dissemblables, exigences de taux rentabilité irréalistes vis-à-vis de leurs clients, vision à court terme,
obstination à échapper aux règles et contrôles, …
8 Voir note 4 ci dessus.
9 « Les mensonges de l'économie », J.K. Galbraith, Essai, Grasset, 2004.
10 Personnes physiques, morales et associations de fait.
11 J.E. Stiglitz parle à ce propos du « fanatisme du marché ».
12 Voir « Prosperity without growth », Tim Jackson, Earthscan, London, 2009.
13 Un mégabyte = un million de bytes (106), un gigabyte = un milliard de bytes (109), un terabyte = mille
milliards de bytes (1012), un exabyte = un milliard de milliards de bytes (1018). Un byte = un caractère. La
bibliothèque du Congrès représente 19 millions de livres et 56 millions de manuscrits, soit 10 terabytes
d'information.
14 In « World drowning in ocean of data » BBC News, October 31st 2003.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%