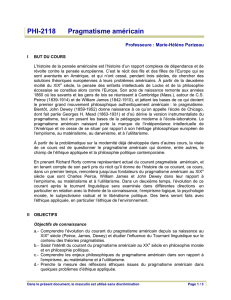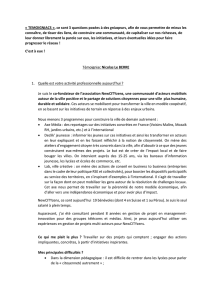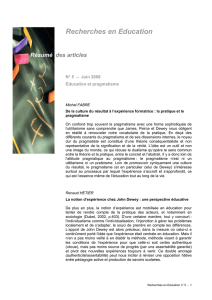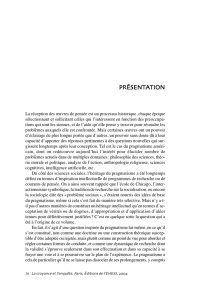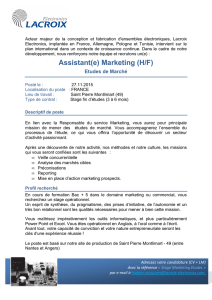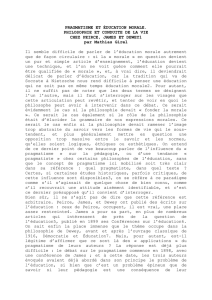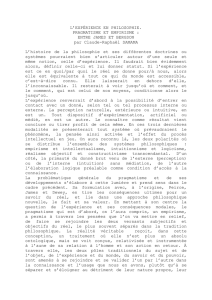Pragmatisme(s) et sciences cognitives : considérations

Intellectica, 2013/2, 60, pp
7-47
© 2013 Association pour la Recherche Cognitive.
Pragmatisme(s) et sciences cognitives :
considérations liminaires
Pierre STEINER
I
NTRODUCTION
La présente livraison d’Intellectica est consacrée aux rapports entre
pragmatismes et sciences cognitives. « Pragmatisme(s) » et « sciences
cognitives » englobent ici des entreprises intellectuelles variées qui peuvent
être actuelles, mais aussi passées et en devenir. D’un côté vers l’autre, ou
mutuellement, ces rapports sont-ils des rapports de fondation, d’orientation,
d’enrichissement, de complémentarité, de critique ou encore d’exclusion ? Les
articles que j’ai eu le plaisir de colliger dans ce volume pourront aider le
lecteur à approcher cette question et à prendre connaissance de quelques voies
de réponse, pas nécessairement convergentes, que l’on peut y apporter.
Les auteurs des textes originaux ici rassemblés peuvent être des praticiens,
dans certains domaines ou dans certaines disciplines, du pragmatisme, ou des
spécialistes de l’histoire du pragmatisme ou de certaines thèses pragmatistes.
Ils sont souvent les deux à la fois. Ce volume constitue aussi bien un
instantané de recherches actuelles qui travaillent ou ont des implications pour
la question des relations entre pragmatisme et sciences cognitives que le
témoignage modeste d’un moment de l’histoire du pragmatisme, où l’identité
de ce dernier est, depuis quelques années maintenant, questionnée et définie à
partir de ses usages effectifs ou possibles en sciences cognitives
1
. C’est de ce
double point de vue que ce numéro vise à contribuer à la redécouverte
francophone récente du pragmatisme et de quelques-unes de ses conséquences
2
.
Ce texte introductif procèdera par différentes étapes. Après avoir
brièvement présenté le motif général qui a présidé à la réalisation de ce projet
de publication (I), je tenterai de proposer – à l’adresse du lecteur novice sur ces
questions – une caractérisation générale du pragmatisme (II), qui nécessite de
revenir historiquement aux travaux de Peirce (III) et qui doit également être
précisée au moyen de thèses auxiliaires (IV), sans pour autant passer – faute de
Université de Technologie de Compiègne – Costech. Pierre.Steiner<at>utc.fr.
1
J’en profite ici pour remercier l’ensemble des lecteurs qui ont pris le temps d’évaluer ces textes, et
souvent de contribuer à leur amélioration, formelle et/ou substantielle.
2
Parmi les publications francophones récentes, on citera notamment Tracés, n°15, 2008,
« Pragmatismes » ; Revue internationale de philosophie, n° 245, 3, 2008, « John Dewey » ; Revue
internationale de philosophie, n° 260, 2, 2012, « William James » ; L’art du comprendre- n° 16, Juin
2007, « W. James, C.S. Peirce, J. Dewey... - Tradition et vocation du pragmatisme » ; Critique, N° 787,
décembre 2012, « Retour à Dewey » ; J.-P. Cometti (2010) ; plusieurs volumes (10, 13, 15) de la
collection Raisons Pratiques (EHESS) ; ainsi que de nombreuses traductions des travaux de Peirce, de
James, de Dewey, de Mead, de Rorty, de Putnam, de Shusterman et de Brandom (voir références dans
la bibliographie). On citera enfin la création récente de l’European Journal of Pragmatism and
American Philosophy (http://www.journalofpragmatism.eu/).

8 Pierre STEINER
place, bien entendu – par une présentation des œuvres singulières des
principaux philosophes pragmatistes
3
. Je rappellerai plutôt quelques grandes
caractéristiques des prises (ou des revirements) de position de certains auteurs
pragmatistes contemporains par rapport à l’entreprise des sciences cognitives
(V), avant de conclure par une présentation des textes qui composent ce
numéro (VI).
I – P
RAGMATISMES ET SCIENCES COGNITIVES
:
QUELQUES QUESTIONS
Dès les années 1960, le programme de recherche computo-
représentationnel (ou cognitiviste) a pu se développer en relation positive
(fondation, orientation, élucidation critique) avec certains des meilleurs travaux
de la philosophie analytique de l’époque, comme ceux de Jerry Fodor et
d’Hilary Putnam (dont nous reparlerons plus loin) et, un peu plus tard, de Ned
Block, de Daniel Dennett, de Fred Dretske, de Gilbert Harman ou de John
Searle. Il aura cependant fallu passer par la critique effectuée en 1951 par
W.V.O. Quine des dits « dogmes de l’empirisme » (et plus spécifiquement de
l’empirisme logique), dont on a d’ailleurs souvent souligné le ton pragmatiste
(cf. infra), pour que la philosophie analytique emprunte peu à peu la voie
naturaliste qui l’amena à contribuer positivement au projet d’une science
naturelle de l’esprit, souvent en confortant ou en explicitant les présupposés de
sa version computo-représentationnelle (représentationnalisme symbolique,
réductionnisme formaliste, internalisme individualiste, physicalisme fonction-
naliste).
Dès les travaux séminaux d’Hubert Dreyfus
4
au début des années soixante-
dix, une critique d’inspiration phénoménologique (et plus spécifiquement
heideggerienne) des présupposés et des limites de l’approche computo-
représentationnelle de la pensée a néanmoins été proposée. La radicalité de
cette critique, le fait qu’on ait pu la réduire à une critique de l’intelligence
artificielle cognitiviste, et le (faux) débat, au milieu des années quatre-vingt
entre les versions sub-symboliques (connexionnistes) et les versions
symboliques de l’approche computo-représentationnelle, peuvent expliquer
l’occultation, pendant toutes ces années, de la voie critique ouverte par
Dreyfus
5
. Il faudra attendre le début des années quatre-vingt-dix pour assister
au développement spectaculaire de nouvelles approches critiques du
programme cognitiviste, parfois philosophiquement proches de Dreyfus, mais
prenant aussi la forme d’alternatives constructives à ce programme
cognitiviste, à des degrés de radicalité différents : rejet du représentation-
nalisme symbolique voire rejet du représentationnalisme tout court,
introduction de l’embodiement comme explanans ou comme explanandum,
situation ou extension/distribution de la cognition dans l’environnement,
surenchère ou déflationnisme concernant la supposée irréductibilité
fondamentale de la conscience phénoménale, fondation de la cognition dans le
3
Sur ce point, on consultera avec profit le Companion to Pragmatism édité par John Shook et Joseph
Margolis (2006). Au niveau des thématiques travaillées par le pragmatisme, on pourra également lire le
Continuum Companion to Pragmatism édité par Sami Pihlström (2011).
4
Dreyfus (1972).
5
Voir toutefois l’ouvrage de Flores & Winograd (1986), postérieur à celui de Dreyfus, et situé dans sa
lignée critique et théorique.

Pragmatisme(s) et sciences cognitives 9
vivant mais aussi biologisation de la computation par l’intermédiaire des
neurosciences, culturalisation de la cognition par des voies sémiotiques et
herméneutiques ou « cogniticisation » des sciences de la culture… la liste des
alternatives post-cognitivistes est longue.
À lire certains ouvrages et essais récents
6
, on pourrait facilement se
convaincre de l’existence, aujourd’hui, d’une opportunité pour les sciences
cognitives d’emprunter une voie, voire un tournant, pragmatiste. Ce constat
peut être justifié en prenant par exemple connaissance des nombreux travaux
7
qui insistent sur les proximités frappantes qui semblent exister entre, d’une
part, les approches contemporaines post-cognitivistes et post-connexionnistes,
externalistes (incarnées, distribuées, situées, étendues), dynamiques, et/ou
énactives
8
des activités et des processus cognitifs et, d’autre part, les idées de
pragmatistes classiques comme Peirce, James, Dewey et Mead. De manière
relativement plus surprenante, on peut également constater que, pour certains
défenseurs d’une approche classique de la cognition, le « pragmatisme »
désigne désormais la principale menace et alternative théorique existante
9
. On
notera, enfin, la mise en circulation récente sur le marché des projets et
méthodes en sciences cognitives du concept de « neuropragmatisme »
10
,
désignant une nouveau type d’approche, naturaliste et située, de la conscience,
ou de conceptions « pragmatistes » de l’intentionnalité, visant à éviter les
impasses du représentationnalisme classique, et liées aux développements
récents des neurosciences de l’action
11
.
La pertinence et la justesse de ces opérations actuelles de rapprochement et
d’alliance possible entre « le » pragmatisme et les ambitions réformistes, voire
révolutionnaires, de nouvelles approches de la cognition sont à préciser et à
évaluer à partir d’un certain recul, historique, théorique et disciplinaire. Quels
sont précisément les éléments qui permettraient en effet de parler d’un éventuel
tournant pragmatiste actuel en sciences cognitives et de définir les contours des
recherches cognitives qui prendraient place à l’issue de ce tournant ?
Historiquement, philosophiquement et stratégiquement, peut-on limiter l’intérêt du
pragmatisme pour les sciences cognitives contemporaines à sa proximité
apparente avec les références théoriques – parfois incantatoires – d’aujourd’hui
aux dimensions incarnées, situées, énactées, pragmatiques, etc. de la
cognition ? N’y aurait-il pas là un risque de simplification du cadre théorique
6
On citera notamment, sans prétendre à l’exhaustivité : Johnson (2006 ; 2010), Jung (2010), Rockwell
(2005), Schukin (2004).
7
On citera notamment, en plus des références de la note précédente : Gallagher (2008), Skagestad
(2004), Tiercelin (1993b, chap. 4 ; 1995), Menary (2011), Steiner (2013a).
8
On peut parler d’approche énactive de la cognition, mais aussi d’énactivisme pour désigner des
théories spécifiques de la perception (Alva Noë), ou des théories générales de la cognition (comme
celle de Dan Hutto & Erik Myin). Enfin, dans un sens plus fort et ambitieux, on peut aussi parler de
paradigme énactif en sciences cognitives (Stewart, Gapenne & Di Paolo, 2010), centralement basé sur
les travaux antérieurs de Francisco Varela et d’Humberto Maturana.
9
Fodor (2008).
10
Solymosi (2011).
11
Roy (2010), Gallagher & Miyahara (2012), Miyahara (2011). Signalons aussi les rapprochements
récents entre la théorie de l’acte de Mead et les travaux autour des « neurones-miroirs » (Rizzolatti &
Sinigaglia, 2008).

10 Pierre STEINER
général qui pourrait éventuellement être dégagé des travaux des pragmatistes
classiques sur l’esprit (naturalisme culturaliste et émergentiste, conception non-
mentaliste et sociale de l’esprit, critique du représentationnalisme, empirisme
radical, pensée-signe peircienne…), en se privant ainsi de certaines de ses
ressources les plus originales et peut-être les plus exigeantes pour penser la
cognition et les conditions de son étude ? Mais comment définir ces ressources
d’une manière rendant possible leur mise en œuvre effective dans le cadre des
recherches cognitives actuelles ?
Il ne faut pas non plus sous-estimer combien les pragmatistes classiques ont
participé aux développements des sciences de l’esprit qui leur étaient
contemporaines. À la différence de la phénoménologie et de la philosophie
analytique naissantes, les pragmatismes de Peirce, James, Dewey et Mead ont
d’emblée prêté attention et même très souvent centralement contribué aux
avancées de la psychologie de leur temps (bien avant l’avènement du
programme de recherche des sciences cognitives), en associant systé-
matiquement ces contributions à leurs propres philo-sophies de l’expérience et
de la connaissance. Le geste baptismal de l’attitude et de la méthode
pragmatiste, que l’on doit à Peirce, emprunte beaucoup, on le verra, à une
psychologie naturaliste et fonctionnaliste de la croyance, et à l’attitude
expérimentale pratiquée dans les laboratoires de sciences naturelles. Très tôt
intéressé par les expérimentations menées par Wundt à Leipzig, James a fondé
l’un des premiers laboratoires de psychologie expérimentale au monde en
1875. On lui doit aussi les monumentaux Principles of Psychology, parus en
1890, ouvrage unique pour bien des raisons dans l’histoire de la psychologie et
de la philosophie
12
. Dewey a proposé en 1896 l’une des premières formes de
psychologie fonctionnaliste, et a dès le départ
13
et pendant longtemps élaboré sa
philosophie de la connaissance et de l’expérience en relation directe avec des
entreprises pédagogiques bien concrètes, aux États-Unis et à l’étranger. La
philosophie sociale de Mead, composante fondamentale du développement de
l’École de Chicago au début du XX
e
siècle, a également donné lieu à un
héritage important en sciences sociales (interactionnisme symbolique) et en
psychologie sociale (école de l’Iowa). Les premières formes de phénomé-
nologie (chez Husserl) et de philosophie analytique (chez Frege) se sont
constituées à partir d’un arrière-plan anti-psychologiste très clair. Le
pragmatisme exemplifie lui la possibilité d’une philosophie positivement
inspirée par et articulée avec des théories psychologiques qui lui sont
contemporaines, sans néanmoins verser dans le psychologisme naïf, dans le
scientisme ou dans le réductionnisme.
En allant trop rapidement du pragmatisme vers les sciences cognitives, ne
présuppose-t-on pas l’existence d’un pragmatisme ? Des sciences cognitives
vers le(s) pragmatisme(s), ne pourrait-on pas simultanément envisager une
redéfinition ou un affinement de la pluralité des projets et des théories
pragmatistes à la lumière de leurs rencontres avec les dimensions théoriques,
expérimentales, pratiques et techniques des sciences cognitives (dans la
diversité de leurs disciplines et de leurs courants), et obtenir par-là
12
Voir Girel (2008).
13
Voir Mayhew & Edwards (1936).

Pragmatisme(s) et sciences cognitives 11
éventuellement plus de clarté sur les différences qui existent entre des
approches pragmatiques (Engel, 2010, 2013) et des approches pragmatistes de
la cognition ? Ces questions concernent le pragmatisme dit classique, mais
aussi les pragmatismes contemporains d’auteurs comme R. Rorty, H. Putnam,
ou R. Brandom qui ont, chacun à leur manière, proposé des réflexions et des
critiques originales sur le naturalisme, le fonctionnalisme computationnel, le
langage, la perception, ou les relations corps/esprit, et dont les effets
gagneraient à être mis en relation avec les recherches et théories cognitives
contemporaines.
Le fait que les sciences sociales aient pu récemment, dans une certaine
mesure elles aussi, connaître l’opportunité d’emprunter une voie ou un tournant
pragmatiste peut également servir de repère pour aborder ces questions, mais
aussi éventuellement de contrainte lorsqu’il s’agit de repenser les rapports
entre les sciences cognitives et ces mêmes sciences sociales.
II – U
NITÉ ET PLURALITÉ DU PRAGMATISME
14
Qu’est-ce que le pragmatisme ? Le pragmatisme est avant tout une tradition
de pensée, dont le développement et les premiers méandres sont inséparables
de l’histoire des États-Unis (Menand, 2001 ; Cometti, 2010), et des
développements de la philosophie américaine (Deledalle, 1993 ; Cometti &
Tiercelin, 2003), qu’elle soit dite classique
15
ou peu à peu transformée à la suite
de l’arrivée des premiers empiristes logiques dès 1931
16
. En tant que tradition
de pensée, le pragmatisme est d’abord composé de personnalités et de
générations, moins rassemblées par une éventuelle adhésion commune à un
corps d’idées que par des contacts, des lieux de rencontre, des relations de
14
Certaines des idées ou des propositions que j’avance ici doivent beaucoup à celles et ceux auprès de
qui j’ai pu récemment les présenter ou les débattre sous différentes formes, en particulier lors de
séminaires, de colloques, ou de journées d’étude. Je remercie particulièrement Jean-Pierre Cometti,
Claudine Tiercelin et l’équipe de la Chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance du
Collège de France (en particulier Jean-Marie Chevalier et Benoit Gaultier), Roberto Frega et Albert
Ogien, Mathias Girel, Stéphane Madelrieux, l’équipe du Knowledge and Action Lab (ENS Lyon –
ECNU Shangaï) - en particulier Jean-Michel Roy, Yu Zhenhua et Emmanuel Renault, Gilles
Dieumegard, Claudio Viale et le Centro de Estudios Dewey (Cordoba, Argentine), et les organisateurs
du 13
th
International Meeting on Pragmatism (Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Brésil).
15
La période s’étalant de la fin de la guerre de Sécession au début de la Seconde guerre mondiale peut
être dite « classique », si l’on considère qu’elle est marquée par la production de textes canoniques,
qu’elle a pu avoir une influence durable, et qu’elle exprime les tendances générales d’une culture
intellectuelle. Voir l’ouvrage classique de Fisch (1951). En plus des pragmatistes, on inclut
généralement les œuvres de Royce, Santayana, Whitehead, et C.I. Lewis dans cette période classique.
Comme Fisch l’a bien souligné, tous ces auteurs souscrivaient à un pragmatisme très global (rejet du
cartésianisme, naturalisation de la pensée, pensée du processus, valorisation de l’avenir, importance
d’une théorie des signes, conception coopérative du travail scientifique,…).
16
Le positivisme logique débarque aux États-Unis dans les années 30 : Feigl arrive en 1931, Carnap en
1935, Hempel en 1937 et devient l’assistant de Carnap à l’Université de Chicago, Reichenbach arrive en
1938 de Berlin. Ce positivisme logique émigré prend réellement son essor institutionnel à la fin des
années 1940. Dewey prend sa retraite de Columbia en 1929, mais reste encore intellectuellement actif
pendant une vingtaine d’années. Le pragmatisme était cependant très loin d’être la philosophie
dominante dans les départements de philosophie aux États-Unis dans les années 1920.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%