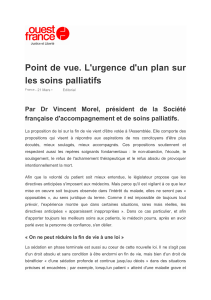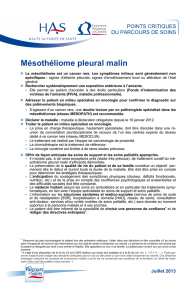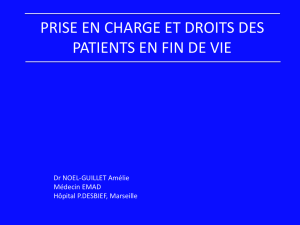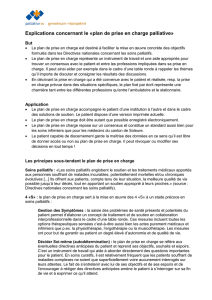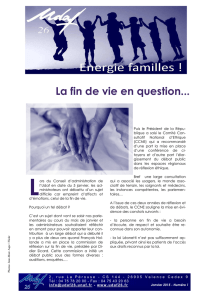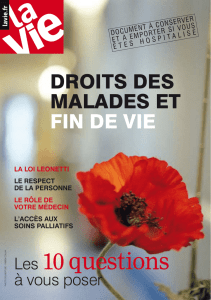Urgences et situations particulières en Soins Palliatifs

1
ASPER Accompagnement et Soins Palliatifs En Réseau
Centre Alsace
47 rue de Morat, 68000 COLMAR
Tél : 03 89 80 41 50 – Fax : 03 89 80 41 49 – asper68@wanadoo.fr
URGENCES ET SITUATIONS PARTICULIERES
EN SOINS PALLIATIFS
(Hormis détresses respiratoires et neuropsychiques)
Dr SCHWALD,
Formation ASPER, 2007
Ce document comporte le texte de la formation
«Les urgences en soins palliatifs et la fin de vie à domicile
Prise en charge pluridisciplinaire »

2
SOMMAIRE
1. REFLEXIONS SUR LES URGENCES EN SOINS PALLIATIFS....................................................................3
1.1. LE SENS DE L’URGENCE...................................................................................................................................3
1.2. L’ANTICIPATION :............................................................................................................................................3
1.2.1. Le principe:.....................................................................................................................................................3
1.2.2. Les prescriptions anticipées personnalisées:......................................................................................3
1.2.3. Les directives anticipées :........................................................................................................................5
1.2.4. La personne de confiance :.......................................................................................................................6
1.2.5. Signalement de patient remarquable.....................................................................................................7
1.3. LES URGENCES EN SOINS PALLIATIFS : RECONNAÎTRE ET ÉVALUER....................................8
1.4. TRAITER EN URGENCE:...................................................................................................................................8
2. QUELQUES SITUATIONS D’URGENCES..........................................................................................................9
2.1. HÉMORRAGIES....................................................................................................................................................9
2.1.1. Introduction : anticipation et sédation.................................................................................................9
2.1.2. Les remèdes des hémorragies localisées et extériorisées :..........................................................9
2.1.3. Hémorragie distillante:............................................................................................................................10
2.1.4. Hémorragies abondantes :......................................................................................................................10
2.2. HYPERCALCÉMIE...............................................................................................................................................11
2.2.1. Clinique...........................................................................................................................................................11
2.2.2. Examens complémentaires......................................................................................................................11
2.2.3. Traitement...................................................................................................................................................11
2.2.4. Traitement par Calcitonine :...................................................................................................................11
2.2.5. Biphosphonates utilisés en soins palliatifs pour traiter l’hypercalcémie maligne.................12
3. QUELQUES SITUATIONS PARTICULIERES AUX SOINS PALLIATIFS...........................................16
3.1. ENCOMBREMENT ET RALES AGONIQUES............................................................................................16
3.2. CARCINOSE PÉRITONÉALE AVEC OCCLUSION DEFINITIVE......................................................17
3.3. SYNDROME CAVE SUPÉRIEUR...................................................................................................................19
3.3.1. CLINIQUE...................................................................................................................................................19
3.3.2. TRAITEMENT...........................................................................................................................................19
3.4. RETENTION URINAIRE :............................................................................................................................20
3.4.1. PRINCIPALES ÉTIOLOGIES DE LA DYSURIE ET DE LA RÉTENTION URINAIRE.......20
3.4.2. TRAITEMENT DE LA DYSURIE ET DE LA RÉTENTION URINAIRE..................................20
4. BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................................................................21

3
1. REFLEXIONS SUR LES URGENCES EN SOINS PALLIATIFS
1.1. LE SENS DE L’URGENCE
Peut-il y avoir urgence en fin de vie?
- Entre abstention et acharnement: les projets héroïques face au « laisser mourir »
- Quelle attente ?
o Le fantasme de l’hôpital tout puissant : « Et s’il y avait encore quelque chose à
faire? »
o Que peut-on proposer à domicile sans « perte de chance » pour le patient ?
- L’exacerbation des divergences de projet « pour » le malade
La difficulté constante en soins palliatifs est de prendre une décision adaptée a priori : même
en soins palliatifs, il peut y avoir des événements intercurrents dont la prise en charge (à domicile
ou hospitalière) peut améliorer le confort du patient ou simplement avoir du sens pour lui. Ce n’est
qu’a posteriori que l’on peut juger du caractère opportun ou inapproprié d’une telle décision.
Malgré l'urgence et le contexte palliatif, il est important –si le temps le permet- d'analyser la
situation en équipe pluridisciplinaire dans un souci d'approche globale et d'envisager les
possibilités thérapeutiques étiologiques en priorité.
Lorsque celles-ci n'ont pas ou plus lieu d'être, les traitements symptomatiques seront
recommandés et exposés.
L'intensité du traitement dépendra de la gravité des symptômes et du stade plus ou moins
avancé du cancer.
Une démarche thérapeutique ne peut être appliquée qu'avec information et accord du
malade.
1.2. L’ANTICIPATION :
1.2.1. Le principe:
Un travail en équipe multidisciplinaire a pour objectif une cohérence des objectifs et des
décisions :
- Identification de situations à risque
- Préparation du patient, de son entourage et des soignants à reconnaître les signes avant-
coureurs d’éventuelles complications
- Proposer des prescriptions anticipées personnalisées
- Permettre un soulagement rapide, éventuellement par un autre que le médecin traitant (IDE,
médecin de garde)
1.2.2. Les prescriptions anticipées personnalisées:
La possibilité de soulager rapidement un malade de sa douleur ou d'autres symptômes
pénibles se heurte parfois à l'impossibilité d'agir des infirmier(e)s faute de prescriptions en
l'absence de médecins ou parfois même de disponibilité du médicament.
Pour éviter une telle situation, les soignants ont souhaité l'établissement de
prescriptions anticipées, c'est-à-dire de " prescriptions médicales personnalisées, rédigées à
l'avance dans le but de supprimer le plus rapidement possible les effets pénibles de
symptômes au moment ou ils se produisent, et révisables à tout moment "
Les prescriptions anticipées apportent un réel bénéfice au malade, un soulagement à
l'entourage et aux soignants, et ont fait l'objet de directives officielles.
Elles exigent cependant une stratégie d'équipe claire.
- Domaine d’application :

4
o L'intérêt de telles prescriptions n'est plus à démontrer dans le domaine de la douleur.
Cette nouvelle pratique a été officialisée par des circulaires ministérielles et d'autres textes
réglementaires qui modifient le rôle infirmier et contribuent à changer peu à peu les
mentalités.
La circulaire DGS/DH n° 98/586 du 22 septembre 1998, relative à la mise en œuvre du plan
de lutte contre la douleur 1998 - 2000, rappelle l'importance d'évaluer la douleur et exige
l'élaboration, en équipe pluridisciplinaire, des protocoles de soins. Elle en précise les modalités.
Depuis février 1999, pour soulager la douleur aiguë, les infirmier(e)s sont autorisés à mettre en
œuvre un protocole de soins dès que le médecin a identifié l'origine de la douleur, et ils sont
habilités par le décret du 11 février 2002 , à entreprendre et à adapter les traitements
antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin,
leur permettant ainsi d'intervenir de façon plus rapide et plus efficace, auprès d'un patient qui
souffre.
o Les prescriptions anticipées ne sont pas réservées au traitement de la douleur. Elles
peuvent s’appliquer à tout symptôme pénible en soins palliatifs dont le traitement doit être
rapidement pris en compte. Cette anticipation est encore plus précieuse à domicile où les
soignants ne peuvent intervenir sans un minimum de délai. Des prescriptions peuvent être faites
" en cas de" : fièvre, convulsions, nausées, vomissements, angoisse, anxiété, insomnie, dyspnée,
encombrement, hémorragie…
o Les situations de détresse sont une autre indication de prescriptions anticipées : détresse
respiratoire, hémorragie externe, agitation ou angoisse majeures, ou plus rarement douleurs
insupportables rebelles à tout traitement. Une sédation transitoire est souvent envisagée à la
demande du malade ou avec son consentement. Elle est légitime en l'absence de toute autre
alternative bénéfique pour le malade. Les modalités de la sédation sont développées dans un
chapitre distinct.
- Les conditions :
Les prescriptions anticipées supposent un certain nombre de conditions pour ne pas
représenter un danger le malade, ni mettre en difficulté l'infirmier(e) (ou le médecin de
garde) qui doit juger de la situation clinique, de la plainte du malade, de l'importance du
symptôme et de la pertinence de l'application de la prescription.
o La prescription anticipée doit être acceptées et comprise par l’équipe : il est
indispensable que le médecin commente verbalement ce qu'il a prescrit, et que l'intérêt de
telles prescriptions soit exposé aux membres de l'équipe et discuté avec eux.
o Bien informés, les infirmier(e)s peuvent initier les traitements dès l'apparition des
symptômes. En cas d'incertitude, d'hésitation, de difficulté d'évaluation, ils (elles) peuvent
demander conseil à leurs collègues, ou solliciter l'avis du médecin.
o La prescription doit être personnalisée, explicite, précise et détaillée : en particulier les
indications précises, les posologies, les modes d’administration, les précautions de
surveillance.
o La prescription doit être actualisée et révisée selon l’évolution : la situation clinique est
par nature évolutive en soins palliatifs.
o Une fois réalisées, les prescriptions sont notées dans le dossier ainsi que l'évaluation de
leur efficacité, et le médecin doit en être régulièrement informé.
- Les limites :
o Les prescriptions anticipées donnent une liberté d'initiative aux infirmiers, dans les limites
de leur rôle propre.
o L'anticipation des prescriptions reste sous la responsabilité du médecin prescripteur.
o Le bon usage de ces prescriptions dépend de la cohérence de l'équipe et de la qualité de la
collaboration entre les médecins et les infirmier(e)s.

5
o Ces prescriptions anticipées sont parfois litigieuses, du fait même qu’elles sont établies par
avance et non en situation. Peut-on reprocher à un soignant de ne pas avoir appliqué la
prescription alors qu'elle ne semble pas adaptée à la situation envisagée ?
o L’anticipation ne peut proposer qu’une attitude « moyenne », ne devant pas dispenser d’une
réflexion.
o La sécurité apportée par ces prescriptions ne doit pas dispenser les soignants d'écouter et
de prendre le temps de rassurer les malades par leur présence ou leurs propos.
1.2.3. Les directives anticipées :
Contrairement aux prescriptions anticipées qui sont l’anticipation de modalités de soins
fait des soignants, les directives anticipées concernent les choix du patient faits avant une
situation potentielle. Les conditions dans lesquelles un patient peut formuler ses attentes
concernant les soins qui lui seront prodigués à la fin de sa vie ont été précisées dans un décret
publié au Journal officiel le 7 février 2006.
Limitation des soins médicaux :
Ce décret a été rédigé après la parution de la loi du 22 avril 2005 sur les droits des
malades et sur la fin de vie. Cette loi encadre pour les personnes majeures la rédaction de leurs
"directives anticipées" pour le cas où elles seraient un jour hors d'état d'exprimer leur volonté
quant à la limitation ou l'arrêt des traitements médicaux en fin de vie.
Les conditions de validité des directives anticipées:
o Les "directives anticipées" doivent être formulées dans un document écrit, daté et
signé par leur auteur.
o Ce dernier s'identifiera également par son nom, son prénom, ainsi que la date et le lieu
de sa naissance.
o La validité des directives est de trois ans, elles pourront être renouvelées, modifiées
ou révoquées par la suite.
o Les documents peuvent être conservés non seulement par l’auteur mais aussi par le
médecin qu'il aura choisi ou par un proche.
o Dans tous les cas, l'existence de ces directives doit alors être mentionnée dans le
dossier médical du patient.
Directives anticipées et testament de vie :
La désignation de la personne de confiance doit être distinguée de ce que d'aucuns
appellent le " testament de vie ". Ce dernier est un acte élaboré par les militants de l’ADMD
(Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité qui prône la dépénalisation de l’euthanasie),
qui est censé exprimer la volonté de leur militant de refuser l'acharnement thérapeutique et ne
pas être réanimé, de bénéficier d'une accélération de la fin de vie. Ce document est
improprement appelé " testament ". En effet un testament est un document qui exprime les
volontés d'une personne décédée alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un document qui est censé
être applicable du vivant de la personne qui l'a créé.
Indépendamment de cette différence formelle, on constate aussi nettement la
différence entre la désignation de la personne de confiance et le " testament de vie ». Certes
ces deux actes expriment une volonté. Mais dans un cas (la personne de confiance), il s'agit de
désigner une personne qui exprimera la volonté du malade et disposera d'une possibilité
d'adaptation en fonction de l'état de la personne. Dans un autre cas (le testament de vie), il
s'agit de l'expression d'une volonté dans un document non reconnu légalement, qui ne laisse pas
la possibilité d'adapter le traitement face aux problèmes pouvant survenir. De surcroît il laisse
entière liberté aux médecins de décider, ce qui est paradoxal puisque ce type de document est
censé être un acte de liberté personnelle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%