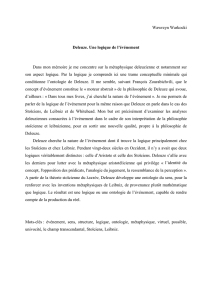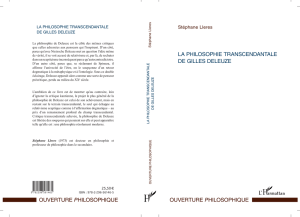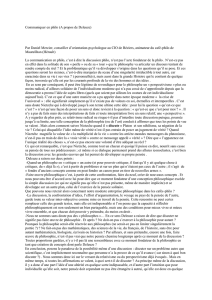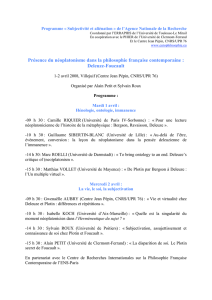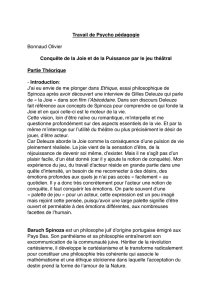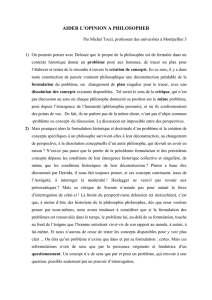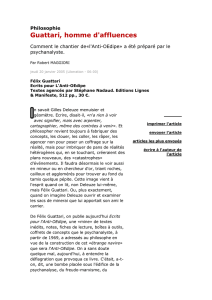Barbion Sébastien - ORBi

Université de Liège
Faculté de Philosophie et Lettres
Département de Philosophie
LE TRAITRE ET SES MANIERES
La métaphysique de l’Idée dans la pensée de Gilles Deleuze
Mémoire présenté par Barbion Sébastien
en vue de l’obtention du grade de
Master en Philosophie
Promoteur : Florence Caeymaex
Année académique 2010/2011

2
« (…) un plan d’immanence ne dispose pas d’une dimension
supplémentaire : le processus de composition doit être saisi pour lui-
même, à travers ce qu’il donne, dans ce qu’il donne. C’est un plan de
composition, non pas d’organisation ni de développement. (…) Ici, le
plan ne retient que des mouvements et des repos, des charges
dynamiques affectives : le plan sera perçu avec ce qu’il nous fait
percevoir, et au fur et à mesure. » (Deleuze, Spinoza et nous
1
)
Il peut sembler curieux de rapprocher l’Idée et l’Être dans une ontologie de l’Idée.
C’est comme si nous étions contraints de répéter Platon qui a dit et achevé au plus haut point
la collusion de l’Idée et de l’Être. Or, la philosophie, au moins depuis Hegel, a montré une
autre voie, dans laquelle il n’y a plus d’ontologie, et a fortiori plus d’Idée ontologique. À tout
le moins, nous pourrions dire avec Deleuze que l’ontologie n’a pas toujours consisté à dire ce
qu’est l’Être - vieille question platonicienne qui désignait l’Idée. Pourtant, bien après Platon,
certains philosophes reprennent le chant de l’identique (ce qu’est l’être) et du fondement
(désigner le point d’arrêt, l’immuable à partir duquel émanent, procèdent des ordres
secondaires, dérivés, fondés dans l’identité du point d’arrêt) – ce que nous appellerons
« représentation classique » ou « représentation de la représentation par la représentation » –,
offrant notamment une fondation scientifique et Véritable du Sens : Frege redit Platon en
« ontologisant » le logique (« platonisme logique », « objectivisme sémantique ») ; Husserl
trouve le fondement dans la conscience transcendantale, conscience donatrice de sens
(Sinngebende). Même Hegel gardera un pied dans la représentation classique (un pied de
géant), tout en annonçant l’ultime critique : Hegel, moment d’exaspération des philosophies
de la représentation, s’épuisant dans la représentation, clôt une ère en ouvrant déjà le monde à
venir. Pour notre compte, nous essayerons de nous porter aux extrêmes limites de la
(re)découverte d’une ontologie du sens. Nous réaliserons cette opération avec Deleuze,
réinvestissant un certain nombre d’apports décisifs du grand ouvrage Différence et
répétition à une ontologie du sens. L’« Idée » y est un concept génétique, fondement
paradoxal, fondement qui ne constitue aucun point d’arrêt, fondement qu’on ne peut ni saisir
dans l’immédiateté d’une intuition (une quelconque « vision des essences » ou science
intuitive spinoziste), ni dé-couvrir au terme d’un long processus de démystification, de
destruction des illusions qui nous barrent l’accès au « réel », au « vrai », au « beau », à toute
figure de l’identité qui continue à fonder, mais toujours faire et découvrir dans le jeu
1
Extrait d’un bref et magnifique article de Deleuze : Deleuze, Spinoza et nous (1978), dans Deleuze, Spinoza,
philosophie pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981/2003, p. 172.

3
complexe de réalisation du réel, d’expression de l’Idée. C’est que la perte du fondement que
l’on chantonne encore tristement, bien après la mort de Dieu qui fut, pour la philosophie, la
fin de la représentation classique, révèle une ontologie du sens, sur fond d’une ontologie de
l’Idée, seule à même de redonner sens à des existences effondées, existences sans essences,
s’incarnant dans des Idées virtuelles mais bien réelles, irréductibles à la conscience sans pour
autant exister de manière autonome dans un troisième royaume intermédiaire entre l’objet et
le sujet. In fine, pour notre compte et sur les pas de Deleuze, nous essayerons de dire deux
choses : que l’Idée donne du sens à l’existence par-delà la perte de sens fondé dans une
ontologie de l’Être ; que l’Idée, bien qu’idéelle-virtuelle, constitue un objet réel, étant déjà
elle-même réelle, n’existant jamais indépendamment de ce qui s’y incarne, évitant ainsi tout
objectivisme sémantique comme toute constitution transcendantale qui soit au datif
(immanence à). Qu’advient-il à l’Idée si nous n’allons pas jusqu’à en faire un être objectif à
la manière des étants, un être actuel et désignable, fut-ce en droit, qui puisse fonder la
connaissance véritable, que ce soit à la manière de Platon ou de ceux qu’on qualifiera bien
après de psychologistes ? Que devient l’Idée si elle n’est ni une objectivité Véritable et
immuable existant indépendamment des sujets, eux-mêmes ayant une essence stable et
immuable, ni une objectivité relative, idée dans l’esprit dont la Vérité est relative à la cause
qui l’a produite (Dieu) ou aux conditions empiriques de sa formation (psychologisme des
relations entre sujets et objets chez les empiristes) ? Surtout, comment parvenir à approcher
une telle conception de l’Idée ? Il faudra pénétrer dans un autre monde philosophique, dans
lequel l’Idée n’est plus soumise tacitement à une image dogmatique de la pensée caractérisée
souverainement par le culte de l’Identité, ramenant tout Dehors à l’ordre du concept
philosophique – un monde qui ne se réduit pas à la représentation, représentation de la
représentation par la représentation. Pour autant, il est certain que ce « nouveau monde » se
réalise comme « ombre de la représentation », se produit comme oubli d’un aspect de son
procès de réalisation, s’exprime toujours aussi comme production représentative. Et cet
aspect de sa production n’est pas illusion à détruire : c’est constitutivement, essentiellement,
que l’Idée se produit dans l’actuel comme la propre trahison de son processus expressif,
insistant seulement sur l’un de ses aspects dans l’actuel (le monde existant là, dans un espace-
temps déterminé). Se produiront ainsi dans ce texte deux mouvements qui s’opposent comme
représentation, tout en s’exprimant au creux d’un même procès de réalisation de réel (ou « du
réel » comme on dit c’est « du pain »). Il n’y a pas le réel derrière les apparences, le vrai
derrière le faux : il y a le traitre et ses manières, réalisation de réel. Toute production
expressive est absolument excessive : elle est le jeu de réalisation du réel qui tantôt s’enfonce

4
dans la représentation de sa propre représentation par les contraintes de la trahison
représentative, tantôt peut se reprendre dans une suspension des contraintes de l’actuel,
approchant au plus près le moment de la trahison, là où le réel se réalise, où l’Idée se fait
monde comme problème.

5
I. Différence et répétition. L’ontologie deleuzienne, une ontologie du sens et de
l’incarnation
2
A. Ontologie du sens
Une ontologie du sens
Deleuze ne manque pas de saluer un effort nouveau chez Hegel, à travers le compte-
rendu d’une lecture qu’en donne Hyppolite
3
. Si ontologie il demeure, ce ne peut être qu’une
ontologie du sens et non de l’essence. « Le retour éternel spéculatif n’inclut pas une histoire
monotone qui se répéterait, mais une perspective de sens, de téléologie, immanente à l’extase
du devenir. »
4
Perspective de sens ouverte par une dynamique d’existence, et non plus
déploiement d’une essence, si l’on parle encore d’ontologie ce sera à condition de ne plus
faire de l’essence fixe et immuable l’objet donné à la réflexion d’un sujet. Il y a une ouverture
dynamique, un devenir, dans lequel il y aura production de sens : le sens est une perspective
ouverte dans un devenir et non pas un donné à saisir dans l’Être. L’homme naitra à la nature
pour Hegel, mais cette nature n’avait pas en soi de sens : « « Le désert, disait Balzac, c’est
Dieu sans l’homme » ; ainsi la pure nature pour Hegel, quand elle est encore en soi, et n’a pas
trouvé dans l’homme ce qui est capable de lui conférer un sens. »
5
. Bref, le sens est à
produire. Dès lors, comme produit il sera exigé de penser ses conditions de production.
L’anthropologie semble être convoquée ici. En effet, à suivre Hyppolite, ne devons-nous pas
dire que c’est l’homme qui confère un sens à la nature ? On se gardera de rendre souverain le
« conférer ». D’une part, l’homme ne trouvera plus le sens tout fait, donné, rapporté à un
fondement essentiel, pas plus qu’il ne le donnera selon des caprices psychologiques ; d’autre
part, et en vertu de ce premier aspect, l’anthropologie devra être mise en mouvement, étudiée
comme un moment dans un développement. L’homme confère certes un sens à la nature,
mais l’homme et la nature ne se trouvent pas l’un en face de l’autre. Nulle part ne trouve-t-on
donnés un sujet face à son objet, pris dans une relation réflexive dans laquelle le sujet
2
Pour tout ce chapitre, d’une grande sécheresse, le lecteur pourra s’aider de l’annexe 1 qui en reprend la
structure essentielle.
3
À vrai dire cet effort n’est que relativement nouveau : Deleuze en voit des balbutiements chez Platon et Kant
(et il est certain que Spinoza pousse cet effort très loin, plus loin même que Hegel). Hyppolite, Logique et
existence, Paris, PUF, 1953. Et compte-rendu de Deleuze : Deleuze, « Jean Hyppolite, Logique et existence »
(1954), dans L’île déserte (Textes et Entretiens 1953 – 1974), Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, p. 18 - 23.
(Cité ID).
4
Hyppolite, « Note sur la préface de la “Phénoménologie de l’esprit” et le thème : l’absolu est sujet » (1967),
dans Hyppolite, Figures de la pensée philosophique, Tome 1, Paris, PUF, 1971, p. 334. (Cité Figures 1).
5
Hyppolite, « Situation de l’homme dans la phénoménologie hégélienne » (1947), dans Figures 1, p. 107.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
1
/
153
100%