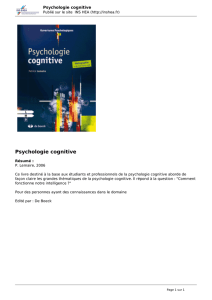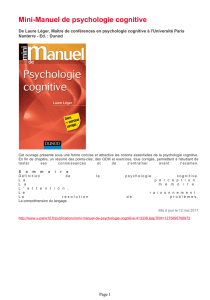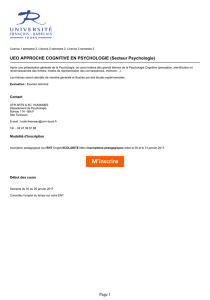Master du Département de Psychologie, UFR Sciences

Master du Département de Psychologie, UFR Sciences Humaines et Arts
Thèmes de Travail d’Etude et de Recherche (TER) de M1 proposés par les enseignants-chercheurs et chercheurs du Centre de
Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCA)
Master 1 / Année universitaire 2015-2016
Ce document regroupe l’ensemble des thèmes proposés par sous–discipline :
psychologie cognitive, psychologie du développement, et psychologie sociale.
Nom et coordonnées de
l’Enseignant-chercheur
ou chercheur
Thème du projet
TER en Psychologie COGNITIVE
BOUQUET Cédric
cedric.bouquet@univ-poitiers.fr
Sous-discipline (psychologie
cognitive)
Equipe C2SE du CeRCA
Représentation des intentions de l’être aimé : quand le soi et l’autre se chevauchent cognitivement. Selon le modèle d’expansion de soi,
chacun cherche à étendre ses ressources matérielles, sociales et intellectuelles (Aron & Aron, 1996). Les relations intimes seraient le
moyen privilégié pour satisfaire ce besoin. L’amour consiste alors en une inclusion de l’autre dans le soi (le soi et l’autre se chevauchent
cognitivement). La recherche originale proposée vise à tester expérimentalement cette prédiction.
Mots clés : relation amoureuse ; empathie
Contrôle cognitif et Emotion. L’influence des émotions sur les processus cognitifs restent méconnus. L’objet de ce TER sera d’explorer ces
liens en évaluant l’impact de l’induction d’un état affectif (positif vs. négatif) sur la flexibilité mentale.
Mots clés : contrôle cognitif ; flexibilité ; émotion
BOUQUET Cédric
cedric.bouquet@univ-poitiers.fr
Empathie & Imitation. Les comportements d’imitation automatique et « effets caméléon » (le sourire contagieux, copier la posture de
l’autre) témoignent de notre tendance spontanée et inconsciente à imiter les comportements d’autrui (Chartrand & Bargh, 1999). Ces

CROIZET Jean-Claude
jean-claude.croizet@univ-poitiers.fr
Sous-discipline (psychologie
cognitive et psychologie sociale)
Equipe C2SE du CeRCA
comportements pourraient refléter des processus impliqués dans l’empathie. Les recherches proposées auront pour objectif d’étudier les
facteurs modulant ces comportements d’imitation ainsi que les liens avec les processus d’empathie.
Mots clés : imitation automatique ; empathie ; théorie de l’esprit
CLARYS David
bureau 0.19, MSHS
david.clarys@univ-poitiers.fr
Sous-discipline : psychologie
cognitive et du vieillissement
Equipe C2SE du CeRCA
Etude de l’effet d’interférence dans la tâche de Stroop au cours du vieillissement normal (collaboration Maria Augustinova & Ludovic
Ferrand, Clermont-Ferrand)
L’effet « Stroop » (Stroop, 1935) se traduit par le fait qu’un individu aura plus de difficultés et/ou prendra plus de temps pour dénommer la
couleur de l’encre avec laquelle est écrit le nom d’une autre couleur (le mot « rouge » écrit en vert) que lorsqu’il y a correspondance entre
le nom et l’encre (le mot « rouge » écrit en rouge). Cet effet très robuste est interprété par le fait que la lecture d’un mot est automatique
et irrépressible et donc que l’on ne peut pas s’empêcher de lire le mot et d’en récupérer le sens même si l’on sait que ce n’est pas la
réponse attendue. Il apparaît alors une interférence entre le sens de ce qui est lu et la perception de la couleur. Toutefois, des travaux
plus récents sont venus questionnés cette interprétation. En effet, il est apparu que l’effet Stroop présente une certaine flexibilité dans
diverses conditions telles que porter l’attention sur une seule lettre colorée (Besner et al., 1997), exécuter la tâche en présence d’une
autre personne (e.g., Huguet et al., 1999) ou encore être persuadé sous hypnose que les mots affichés ne sont qu’une simple suite de
symboles sans signification aucune (Raz et al., 2005, 2006). Au premier abord, ces résultats semblent remettre en cause le fait que
l’activation sémantique soit vraiment automatique. Toutefois, l’équipe de Clermont-Ferrand a récemment publié plusieurs études
montrant que cet effet persiste dès lors que l’on utilise une tâche de Stroop associé (par exemple, le mot « ciel », supposé activer la
couleur « bleue » écrit en vert). Ceci vient étayer l’idée que l’information sémantique est toujours activée de manière automatique et
irrépressible au cours de la lecture. Dans le domaine du vieillissement, une hypothèse interprétative est qu’une part importante du déclin
cognitif s’explique par les difficultés d’inhibition qui apparaissent chez les personnes âgées. Celle-ci est notamment étayée par des
données issues de la tâche de Stroop. Il apparaît donc capital de questionner cette interprétation en soumettant des personnes âgées à
une situation de Stroop associé. A notre connaissance, ceci n’a été examiné que dans une seule étude (Li & Bosman, 1996), auprès d’une
population âgée ayant un très haut niveau d’étude et n’étant pas examinée du point de vue d’un possible début de démence. L’objectif de
ce TER est donc de répliquer cette unique étude, en soumettant un groupe de jeunes adultes et un groupe de personnes âgées à un
protocole de Stroop classique et associé basé sur des réponses orales, tel qu’il est mis en œuvre par l’équipe de Clermont.
Tous les projets suivants sont centrés sur la mémoire épisodique et ses troubles au cours du vieillissement normal, et sous réserve de faisabilité,
dans la maladie d'Alzheimer et le stress post-traumatique. Les conceptions actuelles de la mémoire épisodique postulent qu'elle implique une prise
de conscience de l’identité propre du sujet dans le temps subjectif s’étendant du passé au futur. De ce fait, on considère qu'une bonne évaluation
de la mémoire épisodique doit s'intéresser à l'état de conscience associé à la récupération d'une information (conscience autonoétique /
noétique). Ainsi, les projets proposés (à l’exception du 1er) reposent sur la notion d'état de conscience associé à la récupération d'une information
en mémoire et sont basés sur un nouveau paradigme expérimental pour examiner la relation entre mémoire et conscience (le paradigme
Remember/Know).
Rôle des fonctions exécutives dans le déclin de la mémoire épisodique lié au vieillissement
Des travaux récents réalisés dans la laboratoire montrent que le déclin de la mémoire épisodique lié au vieillissement s'explique plus par le
déficit exécutif qui apparaît chez les personnes âgées, que par la réduction de la vitesse de traitement (Bugaïska, Clarys, et al., 2007). De
plus, nous avons montré que c'est la réduction de la capacité de mise à jour en mémoire de travail, plus que la flexibilité ou l’inhibition,
qui explique les difficultés de mémoire des personnes âgées (Clarys et al., 2009). Néanmoins, à ce stade il n’est pas encore possible de

préciser comment, ni à quel moment le rôle de la mise à jour en mémoire de travail se situe. Est-ce à l'encodage, pour la création et la
mise à jour des associations entre les informations cibles et les détails contextuels, ou à la récupération des informations, pour la
réinstallation de ces associations ? L’objectif de ce TER est de répondre à ces questions en manipulant les capacités de mise à jour de
participants jeunes et âgés, à l’encodage ou à la récupération.
Mots clés : mémoire, vieillissement, fonctions exécutives
Le déclin de la mémoire qui s’observe avec l’avancée ne âge est-il le même quel que soit le moment de test ?
La chronopsychologie concerne l'étude des variations de comportements dans le temps, et particulièrement les fluctuations journalières des
performances intellectuelles. Les travaux en chronopsychologie, souvent assez anciens, ont permis d’établir des profils journaliers de
performance en fonction de la nature des tâches cognitives. Pour l'essentiel, ils ont porté sur les capacités intellectuelles des enfants en
milieu scolaire. Il existe peu d'études sur l'impact du rythme journalier sur le fonctionnement de la mémoire chez l'adulte et à notre
connaissance, aucune étude n'a été conduite dans le cadre de l'évaluation des états de conscience associés à la mémoire. Compte-tenu
des données de la littérature en chronopsychologie et en psychologie de la mémoire, on peut s'attendre à ce que seul le niveau de
conscience autonoétique connaissance des fluctuations circadiennes. Ce projet de TER consistera donc à proposer le protocole
d'évaluation des états de conscience à des participants jeunes et âgés, à différents moments de la journée. Plusieurs étudiant(e)s peuvent
travailler sur ce thème.
Mots clés : Chronopsychologie, mémoire, vieillissement
La valence émotionnelle des informations mémorisées module-t-elle le déclin de la mémoire des personnes âgées ?
Ce projet de recherche vise à explorer les facteurs susceptibles de moduler l'effet du vieillissement sur la conscience autonoétique. Différentes
études ont été réalisées afin d’apprécier l’effet de la connotation émotionnelle sur les performances mnésiques des personnes âgées.
D’une manière générale, il semble qu’avec l’avancée en âge, un biais pour les mots positifs comparés aux mots négatifs et neutres soit
observé (Charles, Mather & Carstensen, 2003). Néanmoins, certaines études ont échoué à mettre en évidence un biais de mémoire pour
les items positifs (Kensinger, Garoff-Eaton, & Schacter, 2007). Dans le cadre de l'effet du vieillissement sur les états de conscience associés
à la récupération en mémoire, les travaux concernant une éventuelle modulation de cet effet par le contenu émotionnel sont rares et peu
cohérents. Pour un TER, l'objectif de l'étude sera de reprendre un protocole mis au point par des collègues anglais chez des participants
jeunes (Dewhurst & Parry, 2000) et de le proposer à un nouveau groupe de jeunes et à un groupe de personnes âgées.
Mots clés : mémoire, vieillissement, émotion
Autres Thèmes possibles : Dans la mesure où les étudiants ont accès aux populations concernées, il est possible d’élaborer des projets
sur les troubles de mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer ou dans l’état de stress post-traumatique (PTSD).
Dyanne ESCORCIA Dyanne
dyanne.escorcia@univ-poitiers.fr
05.49.36.63.45
Psychologie cognitive
Equipe Production Ecrite du CeRCA
Dimensions métacognitives de la production écrite
L’apprentissage de l’écriture joue un rôle clé dans la réussite des apprentissages, de la maternelle à l’université. Plusieurs facteurs cognitifs
peuvent contribuer à cet apprentissage. L’objectif du présent TER est d’étudier précisément :
le lien entre la métacognition et la réussite des élèves et/ ou des étudiants dans le domaine de la production écrite
la nature des connaissances métacognitives du scripteur relatives à ses stratégies d’écriture, à ses compétences rédactionnelles, et à la
tâche d’écriture
le fonctionnement des stratégies de planification, de monitoring et d’autoévaluation que le scripteur met en place afin d’autodiriger sa
production
La métacognition est régulièrement définie sous l’angle de deux dimensions : les connaissances du sujet relatives à ses processus intellectuels, et
les processus d’autorégulation. Cette définition générale sera approfondie et opérationnalisée dans le cadre du TER. Les méthodologies employées

pourront être de deux sortes : un questionnaire qui permettra de mettre en évidence les connaissances des scripteurs à propos de leurs
démarches d’écriture ; et des méthodes d’études en temps réel (observations, verbalisations à haute voix…). Les étudiants qui inscriront leur TER
dans cette thématique pourront utiliser l’un ou l’autre type de méthode.
Mots clés : connaissances métacognitives, autorégulation, autoévaluation, monitoring, réussite scolaire
GIMENES Manuel & LAMBERT Eric
manuel.gimenes@univ-poitiers.fr
eric.lambert@univ-poitiers.fr
Sous-discipline (psychologie
cognitive)
Equipes C2SE et PREC du CeRCA
Quelle est la meilleure méthode de mémorisation: lire, dire ou écrire ? L’effet de production est le fait qu’un mot lu à voix haute (même
murmuré) est mieux mémorisé qu’un mot lu silencieusement (MacLeod et al., 2010). L’objectif du TER sera de voir (1) si la lecture à voix
haute améliore aussi la mémorisation de l’orthographe du mot et (2) si l’effet de production s’observe quand les participants (adultes)
doivent écrire le mot (plutôt que de le lire à voix haute). L’objectif final sera de tester l’importance de l’écriture manuscrite dans
l’apprentissage de l’orthographe de mots nouveaux.
Mots clés : Effet de production – Lecture – Ecriture
KALENZAGA Sandrine
Bureau 0.48, MSHS
sandrine.kalenzaga@univ-poitiers.fr
Sous-discipline : psychologie
cognitive
Equipe C2SE du CeRCA
Effet de la répétition des vérifications sur la nature des souvenirs dans le Trouble Obsessionnel Compulsif
Selon le modèle de Rachman (2002) portant sur la compulsion de vérification dans le Trouble Obsessionnel Compulsif (TOC), il existe un
mécanisme d’auto-entretien de cette compulsion qui réside dans le fait que plus le patient vérifie, plus il doute d’avoir effectivement
réalisé l’action. L’objectif de ce TER est de tester l’hypothèse selon laquelle la répétition des vérifications conduit à une sémantisation du
souvenir chez les patients TOC, associée à une perte de la capacité à revivre mentalement le souvenir de l’action afin de pouvoir s’assurer
qu’elle a effectivement été réalisée. Ce TER sera réalisé en collaboration avec l’Unité de Recherche Clinique de l’hôpital Henri Laborit.
Mots clés : Trouble Obsessionnel Compulsif, Compulsion de vérification, Mémoire
Anxiété sociale et représentations de soi
L’anxiété sociale résulterait notamment d’un trouble de l’estime de soi. L’estime de soi se construit sur la base, d’une part de la
perception que l’individu a de lui-même en fonction de ses idéaux, et d’autre part sur la façon dont il pense être perçu par autrui.
L’objectif de ce travail sera de comprendre, au moyen de l’effet de référence à soi (Rogers et al., 1977), si les connaissances négatives
générales que les personnes souffrant d’anxiété sociale ont sur elles-mêmes (et qui contribue à entretenir le trouble) sont plutôt basées
sur la façon dont elles se perçoivent ou plutôt sur la façon dont elles pensent être perçues par autrui.
Mots clés : Anxiété sociale, estime de soi, concept de soi
Identification au groupe, concept de soi et menace du stéréotype dans le vieillissement

Il est maintenant largement démontré que les personnes âgées sont sensibles à la menace du stéréotype concernant leurs capacités
cognitives, mnésiques en particulier. Des travaux récents montrent que l’effet de la menace du stéréotype est modulé par la façon dont
les personnes âgées s’identifient à leur groupe d’appartenance. L’objectif de ce travail sera de mieux comprendre le rôle joué par
l’identification au groupe ainsi que par la perception de soi et des personnes de leur groupe d’appartenance dans la sensibilité à la
menace du stéréotype présentée par les personnes âgées.
Mots clés : Menace du stéréotype, vieillissement, concept de soi
Effet de référence à soi dans la maladie d’Alzheimer
Nous avons montré que les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer pouvaient bénéficier de l’effet de référence à soi en mémoire
(Rogers et al., 1977), attestant d’une certaine préservation de la conscience de soi chez ces patients (Kalenzaga et al., 2013 ; Kalenzaga &
Clarys, 2013). L’objectif de ce TER sera d’étudier si l’effet de référence à soi est modulé par la nature des mots (mots liés ou non à la
démence) et par le degré de conscience de la maladie.
Mots clés : Maladie d’Alzheimer, effet de référence à soi, conscience de soi
LE BIGOT Ludovic
GIL Sandrine
KNUTSEN Dominique
ludovic.le.bigot@univ-poitiers.fr
sandrine.gil@univ-poitiers.fr
Psychologie cognitive
Ergonomie cognitive
Equipe CLIF du CeRCA
TER 1 : Dialogue et mémoire / TER 2 : Dialogue, mémoire et émotion
La mémoire joue un rôle central dans la réussite du dialogue. Au cours d’un dialogue, chaque locuteur récupère en mémoire des
informations mentionnées lors d’interactions antérieures en vue de produire des énoncés adaptés à son partenaire.
A ce jour, peu d’études portent sur le lien entre dialogue et mémoire, et encore moins entre dialogue, mémoire, et émotion ; de plus, la
grande majorité de ces études portent sur des situations de dialogue peu naturelles et peu représentatives d’une situation réelle
d’interaction (descriptions de figures de tangram, localisation d’objets dans une grille, etc.).
L’objectif des 2 TER est de mettre à jour le rôle de processus de mémoire épisodique dans le déroulement du dialogue dans des situations
plus naturelles de dialogue (dialogue en face-à-face dans un environnement familier des locuteurs, interaction par téléphone, etc.) pour le
premier, et le rôle des émotions dans la mémorisation des informations au cours d’un dialogue pour le second.
Mots clés : dialogue, mémoire épisodique, émotion
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%