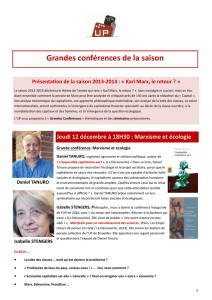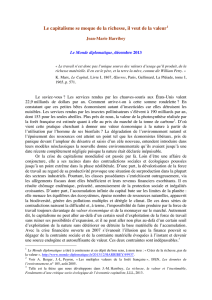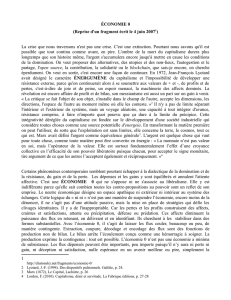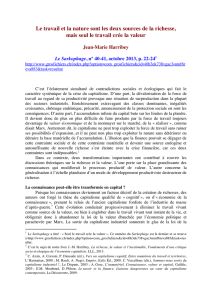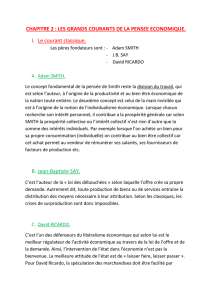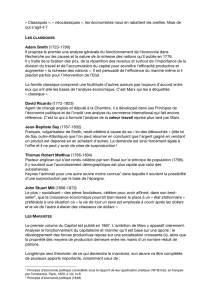Le cognitivisme, nouvelle société ou impasse théorique et politique ?

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=AMX&ID_NUMPUBLIE=AMX_036&ID_ARTICLE=AMX_036_0151
Le cognitivisme, nouvelle société ou impasse théorique et politique ?
par Jean-Marie HARRIBEY
| Presses Universitaires de France | Actuel Marx
2004/2 - n° 36
ISSN 0994-4524 | ISBN 978-2-1305-4689-4 | pages 151 à 180
Pour citer cet article :
— Harribey J.-M., Le cognitivisme, nouvelle société ou impasse théorique et politique ?, Actuel Marx 2004/2, n° 36, p.
151-180.
Distribution électronique Cairn pour les Presses Universitaires de France.
© Presses Universitaires de France. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Le cognitivisme, nouvelle société
ou impasse théorique et politique ?
Jean-Marie HARRIBEY
Les transformations qu’a connues le capitalisme à la fin du XXe
siècle et qu’il connaît au début du XXIe dessinent un nouveau régime
d’accumulation à dominante financière. Il s’agit d’un mode de captation
de la valeur entre les mains des groupes financiers les plus puissants et,
derrière ceux-ci, de la classe sociale détentrice des droits de propriété.
Centralisation et concentration du capital, renforcement du pouvoir des
actionnaires et nouvelle gouvernance, externalisation et sous-traitance
des segments les moins rentables en sont les principaux leviers finan-
ciers. Mais ces mutations dans la manière de gérer la finance n’auraient
pas eu de retombées positives sur la rentabilité du capital si, dans le
même temps, le mode de gestion de la force de travail n’avait été pro-
fondément bouleversé. Chômage et précarité, flexibilisation et intensifi-
cation du travail, recul relatif des salaires par rapport à la productivité
du travail furent autant d’instruments pour augmenter le taux d’exploi-
tation de la force de travail dont l’illustration la plus connue est la
détérioration constatée dans tous les pays de la part de la masse sala-
riale dans la valeur ajoutée. C’est dans l’augmentation du taux de plus-
value au sein de la sphère productive que réside la source de
l’économie-casino caractéristique de la décennie 1990 qui vit une éco-
nomie « nouvelle » si éphémère.
Parallèlement, le capitalisme suscite et intègre aussitôt une révolu-
tion des techniques d’information et de communication qui contribue à
accélérer les transformations des outils et des méthodes de production,
des produits et des rapports de forces entre travail et capital. Mais cette
révolution technique ne serait elle-même rien sans l’intégration des
connaissances comme facteur décisif de la création de richesses. Ainsi
prend naissance et se développe un capitalisme que certains auteurs ont

152 JEAN-MARIE HARRIBEY
qualifié de « cognitif », prenant le relais de l’ancien capitalisme fordiste
de l’industrie de masse d’après-guerre. L’évolution serait telle qu’elle
conduirait progressivement soit, selon certains, à éliminer le travail vi-
vant comme source de la valeur, soit, selon d’autres, à englober dans le
travail vivant tout instant de la vie, et, de toute façon, nous obligerait à
quitter le rivage de la loi marxienne de la valeur. Sur le plan théorique,
la sortie du capitalisme industriel sonnerait le glas de la loi de la valeur-
travail 1. Et, sur le plan politique, la seule issue serait d’accompagner
l’évolution de ce capitalisme – considérée comme résultant de l’évo-
lution des techniques et des connaissances en dehors de tout rapport de
forces puisque les classes disparaissent – qui promet à chaque travail-
leur la possibilité de « se produire soi-même », et simultanément, pour
tous ceux que le système met quand même à l’écart, de s’avancer sur les
voies du revenu d’existence en lieu et place d’un plein emploi
désormais hors d’atteinte et surtout contraire à l’objectif d’émanci-
pation.
Le but est ici d’examiner la validité de ces thèses en essayant de
répondre à trois questions : 1) les mutations de la production et de
l’accumulation capitalistes modifient-elles la source de la valeur ? 2)
modifient-elles la nature des rapports sociaux ? 3) en quoi la valeur est
un rapport social ? Aux deux premières questions, notre réponse sera
négative. La troisième nous permettra de reconsidérer positivement la
théorie de la valeur de Marx.
Les mutations de la production et de l’accumulation capitalistes
modifient-elles la source de la valeur ?
En quoi consiste le capitalisme cognitif selon les créateurs de ce
concept ? C’est d’abord une « économie de l’immatériel », c’est-à-dire
dans laquelle la connaissance devient « principale force productive »,
écrit André Gorz 2. Mais c’est plus que cela car se produit « une auto-
nomisation de la sphère de la production de connaissances, en tant que
sphère d’accumulation capitaliste en soi » pour Antonella Corsani qui
poursuit en disant : « Le capital ne soumet plus la science pour la rendre
adéquate à sa logique d’accumulation, à ses lois de valorisation à
1. La Théorie de la valeur-travail n’aurait eu de validité qu’au temps du
capitalisme industriel pur. P. Dieuaide [2001, p. 20] écrit ainsi : « le fordisme ou la
Théorie de la valeur-travail à son apogée ».
2. A. Gorz [2003, p. 13]. Voir aussi C. Azaïs, A. Corsani, P. Dieuaide (sous la
dir. de) [2000].

LE COGNITIVISME, NOUVELLE SOCIETE OU IMPASSE THEORIQUE ET POLITIQUE ? 153
travers le système de la fabrique et dans un processus de production de
marchandises. Sa valorisation vise immédiatement, et de l’intérieur, la
sphère de production de connaissances, le processus de production des
connaissances par des connaissances » 3.
Ainsi se réaliserait la prophétie de Marx : « Cependant, à mesure
que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle
dépend moins du temps de travail et du quantum de travail employé que
de la puissance des agents mis en mouvement au cours du temps de
travail, laquelle à son tour – leur puissance efficace – n’a elle-même
aucun rapport avec le temps de travail immédiatement dépensé pour les
produire, mais dépend bien plutôt du niveau général de la science et du
progrès de la technologie, autrement dit de l’application de cette science
à la production. […] Dans cette mutation ce n’est ni le travail immédiat
effectué par l’homme lui-même, ni son temps de travail, mais l’appro-
priation de sa propre force productive générale, sa compréhension et sa
domination de la nature, par son existence en tant que corps social, en
un mot le développement de l’individu social, qui apparaît comme le
grand pilier fondamental de la production et de la richesse. […] Dès
lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé d’être la grande
source de la richesse, le temps de travail cesse d’être nécessairement sa
mesure et, par suite, la valeur d’échange d’être la mesure de la valeur
d’usage » 4.
Nous nous interrogeons ici sur le point de savoir si la conclusion
tirée par les penseurs du capitalisme cognitif ne reposerait pas sur une
suite d’erreurs, de confusions et sur un grave contresens au sujet de la
citation de Marx ci-dessus.
Une erreur sur le concept de valeur
La plupart des auteurs théorisant le capitalisme cognitif passent
alternativement du concept de valeur d’usage à celui de valeur
d’échange en gommant la différence irréductible entre eux au risque de
se tromper sur la nature de leur relation.
Ils ignorent ou oublient l’incommensurabilité de la valeur d’usage
et de la valeur d’échange au point de les mettre en comparaison, ce qui
est un pur non-sens. Ainsi A. Gorz, se référant à Jeremy Rifkin [2000],
écrit-il : « La nouveauté, pour Rifkin, peut se résumer ainsi : la dimen-
sion immatérielle des produits l’emporte sur leur réalité matérielle ; leur
3. A. Corsani [2003, p. 57].
4. K. Marx [1980, tome II, pp. 192-193].

154 JEAN-MARIE HARRIBEY
valeur symbolique, esthétique ou sociale, sur leur valeur d’usage
pratique et, bien entendu, sur leur valeur d’échange qu’elle gomme » 5.
Cette phrase comporte deux idées. L’une est banale car toute marchan-
dise représente une valeur d’usage à la fois matérielle et symbolique, la
nouveauté de la période étant que la seconde prend le pas sur la pre-
mière. L’autre est fausse en ce sens que la valeur d’usage ne peut
l’emporter sur la valeur d’échange puisqu’elles appartiennent à deux
registres différents et incommensurables : le premier est pratique ou
symbolique, le second est économique. Cela est un acquis de l’écono-
mie politique que précisément l’analyse économique libérale néo-
classique moderne s’attache à nier furieusement. Il est curieux de la voir
rejointe par les penseurs du capitalisme cognitif qui prétendent être sur
une posture critique. D’autant plus que, par ailleurs, des réminiscences
de l’économie politique surgissent ici et là : « la valeur d’usage […]
n’est pas mesurable » 6. Réminiscences contrebalancées par : « Le lien
entre “plus” et “mieux”, entre “valeur” au (sens économique) et “ri-
chesse” se rompt » 7. S’il est sûr que le lien qualitatif se rompt, il ne
faut pas y chercher une rupture d’un lien quantitatif qui n’a jamais
existé.
La confusion entourant les concepts de valeur d’usage et de valeur
d’échange aboutit à utiliser la notion de « valeur intrinsèque » qui est
renvoyée à juste titre « en dehors de l’économie » 8 pour désigner sim-
plement ce qui est valeur d’usage sans valeur d’échange. La contradic-
tion éclate lorsqu’il est question de verser un revenu d’existence – donc
obligatoirement prélevé sur la sphère productive monétaire – pour pou-
voir participer à l’échange de « richesses non monnayables ayant une
valeur intrinsèque » 9. Le revenu d’existence aurait donc pour but de
restreindre la sphère productive alors qu’il serait prélevé sur celle-ci.
Cette contradiction nous paraît irréductible.
La notion de valeur intrinsèque est largement utilisée par les éco-
nomistes néo-classiques de l’environnement pour justifier la marchan-
disation des éléments naturels. Elle comporte donc un effet pervers que
les théoriciens du capitalisme cognitif n’évitent pas. Par ailleurs, les ri-
chesses non monétaires comme la santé, la nature sont assimilées à des
5. A. Gorz [2003, p. 49, souligné par nous]. La même idée est reprise p. 63.
6. A. Gorz [2003, p. 94]. L’auteur avait cité auparavant Enzo Rullani qui
rappelait la même chose [p. 75].
7. A. Gorz [2003, p. 85].
8. A. Gorz [2003, p. 75]. Voir aussi p. 34.
9. A. Gorz [2003, p. 31]. Voir aussi p. 101.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%