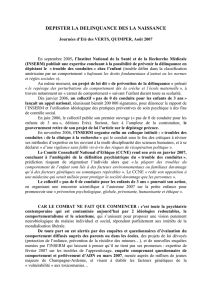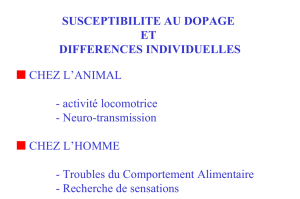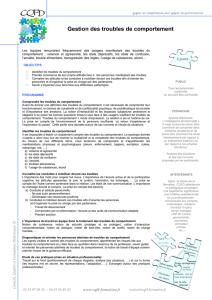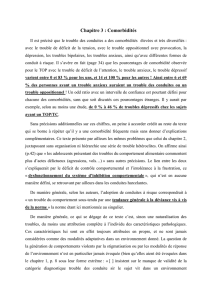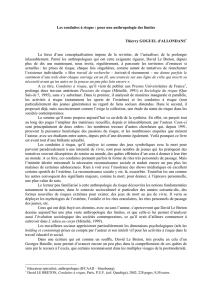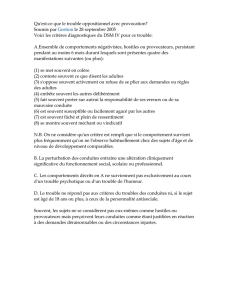A propos du rapport de l`INSERM sur « LE TROUBLE DES

1
A propos du rapport de l’INSERM sur
« LE TROUBLE DES CONDUITES CHEZ L’ENFANT
ET L’ADOLESCENT »
et des réactions qu’il a suscitées.
Docteur Colette VIDAILHET
Psychiatre d’enfants et d’adolescents
Professeur émérite à la Faculté de Médecine de Nancy
En septembre 2005, l’INSERM a fait paraître une expertise collective (1) faite à la demande
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Indépendants, le groupe
d’experts est pluridisciplinaire, experts en pédopsychiatrie, psychologie, épidémiologie,
science cognitive, génétique, neurobiologie, éthologie (dont deux canadiens).
Le rapport s’appuie sur plus de 1000 articles de la littérature internationale qui en constituent
la base documentaire.
Il est précisé dans l’avant-propos que ce rapport ne traite pas de la délinquance mais du
trouble des conduites, qui, « en complémentarité avec d’autres facteurs, peut constituer un
facteur de risque de délinquance ».
La première lecture permet de mesurer l’énorme travail effectué et soulève des questions
(c’est bien le moindre), pour un sujet aussi vaste et aussi complexe, donnant aux spécialistes
de l’enfance l’occasion de débattre avec le recul nécessaire à la réflexion.
Au lieu de cela, on assiste aujourd’hui à un battage médiatique, à des batailles entre
théoriciens du psychisme qui semblent oublier qu’il y a des enfants et des familles qui
souffrent, et attendraient plutôt des médecins compréhension et aide.
Il est vrai que ce rapport survient dans un contexte particulier (ce point sera abordé
ultérieurement), qui éclaire peut-être l’excès de certaines réactions, leurs motivations et à mon
sens, leur partialité.
La polémique est extrême, ne fait pas place aux nuances, les titres de la grande presse sont
souvent outranciers, tournant en dérision le rapport de l’INSERM, le ton de certains
commentaires est ironique et parfois méprisant, les bons mots abondent : « Les bébés
délinquants… Qui veut ficher les enfants… Des enfants sages sur ordonnance… Les
médicaments utilisés comme contrôle social… Fliquez pas les enfants… Rapport effrayant…
Rapport délirant… Rapport sans valeur scientifique et qu’on ne pourra pas lire sans frémir,
etc… ».
Une pétition : « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans », en réponse à
l’expertise de l’INSERM, est mise sur Internet (2). Elle a recueilli à ce jour plus de 96 000
signatures. Il n’est pas sûr que ces milliers de personnes aient lu le rapport de près de 500
pages et sa synthèse d’une soixantaine de pages pour savoir si la pétition qu’elles signaient
correspondait bien au rapport.

2
Les « hostilités » ont été réactivées par le rapport parlementaire sur la prévention de la
violence, du Député UMP Benisti, qui paraît après la « crise des banlieues ».
Tout cela fait qu’une deuxième lecture très attentive est nécessaire pour s’assurer de ce que
retient la synthèse du rapport.
La synthèse du rapport
La définition des troubles des conduites est donnée par le DSM IV R : « Ensemble de
conduites, répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux
d’autrui ou les normes et règles sociales correspondant à l’âge du sujet ». Les symptômes au
nombre de 15 sont regroupés en 4 catégories. La CIM 10 liste 23 symptômes qu’elle classe en
3 catégories. La classification française des troubles mentaux de l’enfant et de l’adolescent
comporte aussi l’item : « Trouble des conduites et des comportements ».
Le rapport de l’INSERM dit que : « Pour que ce diagnostic soit retenu, il faut que les
symptômes soient sévères, répétés, durables » (p. 1) et insiste pour que ces symptômes soient
différenciés des conduites normales de l’enfant : mensonges, agressivité, vols… en attirant
notre attention sur leur persistance au-delà de 4 ans qui doit nous rendre plus attentifs, sachant
que les comportements d’opposition et d’agressivité dominent dans l’enfance et tendent à se
normaliser. La question est donc de savoir pourquoi certains enfants maintiennent un
comportement agressif (p. 2).
La prévalence est de 5 à 9 % chez les garçons de 15 ans, deux tiers des sujets ayant le
diagnostic dans l’enfance l’ont toujours à l’adolescence, le pronostic est moins bon quand le
trouble débute avant 10 ans, la très grande majorité des adultes présentant une personnalité
anti-sociale ont des antécédents de troubles des conduites, mais seulement la moitié des
jeunes ayant eu un trouble des conduites développent par la suite une personnalité anti-sociale
(p. 7) (c’est donc bien d’un facteur de risque dont on parle et non pas d’une fatalité).
La seule étude épidémiologique française est citée, menée dans 18 écoles primaires à
Chartres, qui rapporte une prévalence de 6,5 %, voisine donc de ce qui est indiqué dans les
autres études.
Le rapport dit que le trouble des conduites est rarement isolé, et qu’il y a une comorbidité
élevée et très diversifiée : le trouble hyperactif avec déficit de l’attention, le trouble dépressif
(avec risque de tentative de suicide), les troubles anxieux (le syndrome de stress post-
traumatique est développé), l’usage de drogues psychoactives avec influence réciproque (plus
on a de troubles des conduites et plus il y a risque d’usage de drogues, et plus il y a usage de
drogues et plus il y a risque de troubles des conduites).
Le rapport mentionne l’intérêt d’un suivi longitudinal, mais il fait état du peu d’études à ce
sujet. Dans la petite enfance, filles et garçons utilisent l’agression physique de façon assez
semblable, la différence se creuse à l’adolescence où l’écart devient substantiel.

3
Le score d’héritabilité génétique est proche de 50 %. Le rapport insiste sur le fait que les
facteurs génétiques sont à appréhender dans une dynamique d’interaction et de synergie avec
les autres facteurs en particulier événements de vie et pratiques éducatives parentales (p. 15).
Le rapport à plusieurs reprises cite la multifactorialité, les interactions entre gènes et
environnement. Il note aussi les résultats très hétérogènes des études génétiques.
Un tempérament et une personnalité dits « difficiles » ont une influence vis-à-vis de
l’apparition d’un trouble des conduites, mais le rapport insiste sur le fait que ce type de
caractéristique tempéramentale, ainsi que l’ensemble des facteurs de risque, n’ont pas de
spécificité, qu’ils constituent des facteurs non spécifiques vis-à-vis du trouble des conduites,
mais aussi de tout trouble mental en général. Comme il s’agit de risque, c'est-à-dire une
notion statistique et non individuelle, un enfant au tempérament un peu difficile peut
d’évoluer tout à fait normalement. Les caractéristiques mentionnées à propos des
personnalités dites difficiles, sont : « qualité négative de l’humeur, faible adaptabilité, forte
distractibilité, réaction émotionnelle intense, hyperactivité, repli social, agressivité, indocilité,
impulsivité, absence de culpabilité ».
Le rapport relève ensuite d’autres facteurs de risque. Ils sont dits semblables pour la
délinquance, le trouble des conduites et pour d’autres difficultés ou troubles mentaux. Le
rapport insiste à nouveau là sur la non-spécificité de ces facteurs (p. 20).
- Antécédents de comportements anti-sociaux chez les parents.
- Très jeune âge de la mère à la naissance du premier bébé.
- Faible niveau scolaire de la mère.
- Discorde familiale (mais le rapport dit que le trouble des conduites précède la
séparation et que les conflits constitueraient davantage un facteur de risque que le
divorce en lui-même).
- Pratiques éducatives inadaptées.
- Pauvreté.
- Comportement coercitif des parents à l’égard de l’enfant
- Rôle de la dépression parentale, en particulier de la dépression maternelle.
- Influence négative d’un frère ou d’une sœur délinquant ou en prison et des pairs
délinquants.
- L’exposition à la violence télévisuelle qui entraîne désensibilisation, banalisation,
habituation, passivité, déculpabilisation et au pire où les comportements violents sont
vantés, encouragés, voire glorifiés. Mais ce sont les enfants qui ont déjà des problèmes
de violence qui sont influencés.
- Les déficits neurocognitifs sont étudiés car impliqués dans le trouble des conduites :
faible niveau verbal et déficit exécutif.
La difficulté du diagnostic est largement soulignée. Il s’agit bien d’un diagnostic médical,
qui nécessite une évaluation rigoureuse, plurimodale, prenant en compte l’histoire et le mode
de fonctionnement familial (p. 26). Les données sont recueillies auprès de l’enfant, de la
famille, des enseignants, des pairs…
La prévention est ensuite abordée. Les experts constatent que le dépistage, la prévention et
la prise en charge médicale du trouble des conduites en France restent insuffisants au regard
de ses conséquences (risque de mort prématurée…) et du coût pour la société (instabilité
professionnelle, délinquance, criminalité…).

4
Il propose des mesures très variées, différenciées en fonction des facteurs de vulnérabilité,
portant sur l’enfant, la famille, l’environnement :
• Identifier et aider les familles présentant des facteurs de risque, pendant la grossesse et
à la maternité (visites à domicile, etc.).
• Développer les compétences sociales, émotionnelles, cognitives, en crèche et en
maternelle (travail avec la PMI et l’Education Nationale recommandé).
• Prendre en charge la globalité de la famille avec une application non violente du
respect de la discipline.
• Prendre en charge l’enfant sur un plan psychothérapique, et, à ce sujet, le rapport
mentionne essentiellement les thérapies cognitivo-comportementales évaluées dans la
littérature internationale, en signalant leur effet léger à modéré sur l’agressivité (p. 33),
et leur plus grande efficacité à partir de 10-11 ans.
• Eviter de regrouper des adolescents déviants, car ils risquent d’élargir leur répertoire
agressif, les experts préconisent des familles d’accueil.
• Ne mettre en route le traitement médicamenteux qu’en deuxième intention, après les
interventions psychologiques et sociales. Le rapport mentionne le peu d’études sur les
médicaments et le peu d’efficacité de ces derniers contre l’agressivité. La question de
la RITALINE est très peu abordée dans la synthèse.
• Recommande l’information des enseignants, des professions de santé, des intervenants
en PMI, CMP, CMPP, AEMO, et recommande les échanges avec les juges et les juges
aux affaires familiales puisqu’au cours de son évolution, le trouble des conduites peut
conduire à la délinquance.
• Développer les structures d’accueil et d’écoute pour enfants et adolescents, car, le
rapport dit que beaucoup de questions se posent quant à la signification de ces
conduites.
• Mieux utiliser les bilans systématiques de 8 jours, 9 mois, 24 mois, 5-6 ans, et
préconise un examen de santé à 36 mois « à cet âge on peut faire un premier repérage
d’un tempérament difficile ».
• Introduire dans le carnet de santé quelques items supplémentaires concernant les
troubles du langage et la persistance d’un niveau élevé d’agressivité et de colères
intenses et fréquentes (l’enfant mord, frappe…).
• Mettre en place un repérage et un suivi des enfants à risque dès la période ante et péri
natale : antécédents familiaux de troubles des conduites, criminalité au sein de la
famille, mère très jeune, consommation d’alcool, de substances psychoactives pendant
la grossesse… et favoriser les liens mère-enfant lors des naissances prématurées.
• Suivre régulièrement les enfants de l’ASE.
• Mettre en place un repérage et un suivi des adolescents à haut risque ou présentant
déjà des signes d’appel et suivre également les adolescents incarcérés, évaluer et
assurer un suivi psychologique de tous les adolescents ayant effectué une tentative de
suicide.
• Faire une évaluation clinique rigoureuse pour aboutir à un diagnostic, même si l’usage
des questionnaires destinés aux enfants, aux parents et aux enseignants est mentionné,
il n’est nulle part dit qu’un questionnaire remplace un diagnostic et le rapport insiste
sur la difficulté de ce diagnostic qui nécessite une évaluation clinique rigoureuse. Il
recommande l’usage de plusieurs outils de diagnostic, préconise des évaluations
régulières réalisées par une équipe pluridisciplinaire puisqu’il s’agit d’un diagnostic
évolutif chez un être en développement et en changement (p. 26).

5
• Adapter la thérapeutique à la sévérité du trouble, le trouble des conduites est traité
dans un premier temps par des interventions psychologiques et sociales.
• Implanter des méthodes et des programmes de prévention validés, le rapport fait état
d’une vingtaine de programmes développés dans les pays anglosaxons qui ont été
validés.
C’est un énorme travail, qui soulève des questions importantes, qui suscitent la réflexion.
Fallait-il en faire un esclandre dans les médias ?
Quelles ont été les critiques ?
Confondre le social et le médical, mélanger le comportement antisocial avec le mal-être
personnel, médicaliser, psychiatriser… C’est faux. Le rapport traite bien d’un trouble mental,
répertorié dans toutes les classifications médicales, étrangères et française des troubles
mentaux, trouble qui, non repéré, non pris en compte tôt, peut conduire à des comportements
de délinquance, de violence en général ou à divers troubles mentaux. Ce trouble est analysé en
tant que facteur de risque parmi d’autres, les experts ne traitent pas de la délinquance. Ils
insistent sur la pluralité des facteurs étiopathogéniques dans le développement de conduites
délinquantes ou de violence en général. Ils n’abordent qu’un point très particulier auquel les
classifications médicales se sont attachées : trouble des conduites et des comportements.
En rester au plan symptomatique et ne pas replacer les symptômes dans le cadre du
développement de la personnalité. C’est une lecture tendancieuse. Le rapport dit combien le
diagnostic est difficile, nécessite une évaluation précise et pluridisciplinaire au cours de
laquelle le psychiatre est libre de sa démarche diagnostique. Il est recommandé l’usage de
plusieurs outils diagnostiques. Le rapport insiste sur le caractère sévère et durable des
troubles, afin de ne pas les confondre avec les symptômes normaux de l’enfant qui sont
énumérés dans le rapport (p. 10). Les experts posent donc bien la question si difficile du
normal et du pathologique. Le rapport insiste aussi sur le caractère évolutif du diagnostic. Le
pédopsychiatre pourra user de sa façon de faire habituelle pour comprendre : s’agit-il d’un
enfant normal ? de troubles réactionnels ? de difficultés d’ordre éducatif ? de troubles
dépressifs, de troubles anxieux, classés ici dans les co-morbidités mais qui pourraient être
aussi envisagés comme diagnostic différentiel ou facettes de la personnalité d’un enfant. Ceci
montre bien la complexité de ce diagnostic pour l’établissement duquel le rapport insiste sur
la sévérité et la persistance des troubles.
Cette critique tendancieuse est en lien direct avec un débat très particulier à la psychiatrie :
faut-il ou non traiter le symptôme ? Le symptôme est souvent la manifestation d’un conflit,
d’un dysfonctionnement, qu’il faudra aborder… Mais, ici, ces symptômes font souffrir
l’enfant, sa famille, son maître, ses copains de classe. Un enfant qui a des troubles des
conduites sera réprimandé, puni, exclu des jeux, se sentira dévalorisé, développera mésestime
de lui-même, souffrance voire dépression, majoration de l’agressivité. Traiter le symptôme
peut déjà prévenir les conséquences pathogènes et soulager l’enfant. Il n’est pas question de
choisir entre deux camps, ceux qui respectent le symptôme et ceux qui le combattent. A la
fois on ne peut laisser un enfant s’enfermer et se structurer dans un symptôme qui lui est
nuisible, et à la fois on ne peut ignorer qu’il s’agit d’un signe d’appel ou de l’expression d’une
souffrance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%