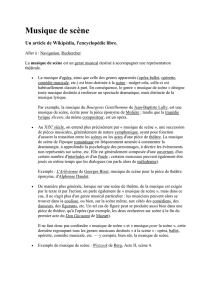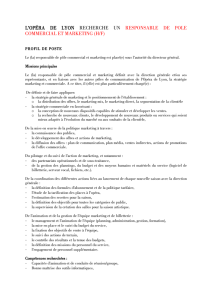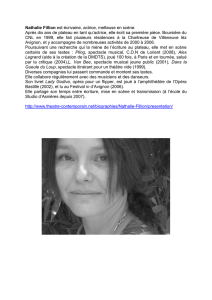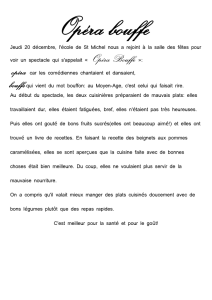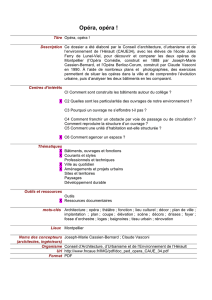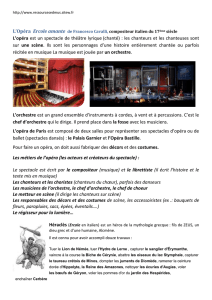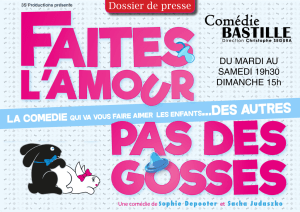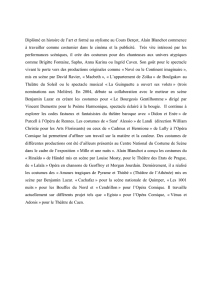Le Théâtre de Dunkerque sous l`Empire Par Albert Bril, Union

Albert Bril / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 1
Le Théâtre de Dunkerque sous l’Empire
Par Albert Bril, Union Faulconnier Tome VIII
Transcrit, illustré et mis en page par Jean-Marie Muyls
Dès le milieu du XVIII
e
siècle, on avait essayé d'étendre et de renouveler le genre dramatique en
France. La Révolution qui aurait dû hâter ce mouvement, passa comme un ouragan et le théâtre de 1800
était à peu près tel que vingt ans plus tôt. La même contradiction apparaît trente ans plus tard. Les libéraux
seront classiques, révolutionnaires en politique, conservateurs en poésie.
Il serait injuste, pourtant, de prétendre que l'époque du Consulat et de l'Empire ne fit que continuer
les errements précédents. L'œuvre dramatique de cette époque est tombée dans un discrédit qui n'est pas
tout à fait mérité. Les auteurs tragiques et comiques essayèrent sincèrement d'apporter un répertoire neuf à
la France nouvelle et d'exprimer sur la scène quelque chose des idées, des sentiments, des travers nés de la
Révolution. « Les tragédies les plus remarquables de ces vingt dernières années, écrit Marie-Joseph
Chénier (1789-1808), se distinguent par une action simple, souvent réduite aux seuls personnages qui lui
sont nécessaires, dégagée de cette foule de confidents aussi fastidieux qu'inutiles, de ces épisodes qui ne
font que retarder la marche des événements et distraire l'attention des spectateurs; de ces fadeurs
érotiques si anciennes sur notre théâtre, introduites, par la tyrannie de l'usage, au milieu de quelques
chefs-d' œuvre, prodiguées par les prétendus élèves de Racine, fréquentes dans les sombres tragédies de
Crébillon, signalées par Voltaire et désormais bannies de la scène comme indignes de la gravité du
cothurne. »
Source Internet
Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762)

Albert Bril / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 2
Pourquoi l’œuvre de
Chénier
et de ses successeurs nous parait-elle si pâle ? Parce que le style a
manqué à tous ces écrivains qui n'étaient pas sans talent. Ils manquaient de ce don de personnalité qui fit
l'éclat de la génération suivante. La poésie et la prose qu'ils parlent est banale et emphatique. De là, leur
insuffisance à répondre à cette tâche à laquelle semblait les appeler cette période d'événements de nature à
éveiller le génie. Le style, au théâtre, a une énorme importance s'il s'agit de fonder un genre nouveau. Les
réformes littéraires se font par le style neuf plus encore que par des idées nouvelles :
En l'an XII (1801), notre théâtre faisait partie du premier arrondissement théâtral du royaume
desservi par une troupe de comédie et d'opéra. La troupe, qui se composait de vingt artistes, et l'orchestre
n'avaient guère subi de modifications.
Le mois d'abonnement comprenait douze représentations données les mardi, jeudi et dimanche, et l'on
payait, pour un mois : les hommes, quinze francs; les dames, neuf francs. Pour trois mois : quarante-cinq
francs (hommes); vingt-quatre francs (dames). Pour six mois : soixante-dix francs (hommes); quarante-cinq
francs (dames).
Les militaires isolés, jusqu'au rang de capitaine d'infanterie, payaient neuf francs.
Les fonds de loges étaient de soixante-dix livres pour six mois. Les abonnements au mois et ceux des
militaires se payaient d'avance; ceux au trimestre étaient perçus à la dix-huitième représentation, de
même que le trimestre des abonnés pour six mois.
Le vendredi, la troupe allait en excursion à Bergues.
Le 21 nivôse, le sieur Olivier donne à la salle de spectacle une représentation générale « infiniment
plus complète, plus variée que toutes celles qu'il a données dans son précédent local, qui n'était pas assez
vaste pour beaucoup de tours, d'expériences, etc., qu'il lui a été possible d'y donner »
(1)
.
L'année d'après, l'ancienne salle de la rue Nationale était devenue une maison d'éducation où « le
sieur Chifflart, indépendamment de sa classe de jour, tient une école le soir, depuis six heures jusqu'à
huit. On y enseigne l'écriture, la grammaire, l'arithmétique et le dessin »
(2)
.
Le public affluait alors à la salle Malbosc, rue Saint-Sébastien, au théâtre pittoresque et mécanique.
Ce n'était rien moins qu'un précurseur du cinématographe. Qu'on en juge :
Un ingénieux artiste y présentait différents tableaux « effets d'optique et des points de vue, choisis
dans ce que la nature et la topographie ont de plus intéressant. On y remarque la vérité et la beauté.
Tantôt c'est un lac ou un fleuve, dont la surface tranquille est traversée par des barques et des canots
dont les mouvements obéissent avec docilité aux efforts de leurs conducteurs, ou par un cygne dont les
mouvements sont doux et gracieux, soit qu'il plonge son cou dans la plaine liquide, soit quand ce bel
oiseau fend l'élément humide. Tantôt une mer calme où les vaisseaux passent majestueusement en
saluant les forts.
Tantôt ce sont des montagnes dont les cimes se perdent dans les nues et offrent les effets les plus
imposants. Ces scènes paraissent aux yeux belles comme la nature et, dans leur exécution, font
apercevoir les talents de célèbres artistes. Parmi les sujets les plus remarquables on est surtout frappé de
différentes vues de Suisse : ce sont des sites les plus curieux que l'on puisse offrir au regard d'un ami de
la nature. Nulle part on ne trouverait une aussi étonnante variété d'accidents, ni de contrastes plus
étonnants. L'artiste a animé ces tableaux par un épisode amusant : c'est un chasseur qui parcourt la
plaine, suivi de son chien qui lance un lièvre, le fait fuir rapidement; le chien s'arrête, court, revient sur
lui-même, prend les voies et suit l'animal avec une intelligence qui ferait douter de l'imitation, si tout ce
qui environne le tableau ne la rappelait au spectateur. »
C'est le 20 janvier 1806 que nous voyons apparaître sur l'affiche la première pièce napoléonienne,
dont le répertoire devint si riche alors. Elle a pour titre : Le Triomphe de Napoléon 1
er
, action théâtrale,

Albert Bril / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 3
mêlée de vaudevilles, composée à l'occasion de la «
Bataille des Trois Empereurs
» et dédiée par un
amateur aux habitants de Dunkerque, ornée de jolies fêtes, combats, évolutions militaires et d'une
décoration nouvelle représentant un arc de triomphe élevé à la gloire de l'Empereur des Français; suivi des
Deux Frères, comédie en quatre actes.
Source Gallica Source Internet
A l'époque du carnaval, les artistes louaient leurs costumes, comme le prouve l'annonce suivante, des
« Avis divers » :
« Le sieur Cartellier, dit Saint-Albain, artiste comique et lyrique, loue ses habits de théâtre,
déguisements et habits de bal. Il demeure rue de Nieuport, chez la veuve Massemain, vis à vis le jardin
autrefois dit de Calonne, près de la Comédie, n° 12, au second. »
La même feuille annonce que M. Bosselet a l'honneur de prévenir le public qu'on donnera très
incessamment sur le théâtre de cette ville, au bénéfice de madame son épouse, une première représentation
de l'Homme à sentiments ou le Tartufe des mœurs, comédie en cinq actes et en vers de M. Chéron, imitée
en partie de la comédie anglaise intitulée : The School of scandal, de Sheridan.
« M. Bosselet, déterminé par l'accueil favorable que le public de cette ville fait à la bonne comédie, a
choisi cette pièce qui a été représentée pour la première fois sur le Théâtre Français, dans le courant de
germinal dernier, et qui y a obtenu le plus brillant succès. On peut, à juste titre, la regarder comme un des
meilleurs ouvrages qui aient été représentés depuis plus de vingt ans sur ce théâtre; suivi d'Un quart
d'heure de Silence, opéra en un acte. Le spectacle sera terminé par une première représentation de
Monsieur Vautour ou le Propriétaire sous le scellé, vaudeville en un acte »
(3)
.

Albert Bril / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 4
Citons encore, au répertoire de cette saison :
Le Vieillard et les Jeunes Gens ou le Tableau du Siècle; le Pot de Fleurs; les trois Fanchon;
Montoni ou les Mystères d'Udolphe; Point d'Adversaire; les Marionnettes; Un Jeu de la Fortune; le
Bouffe et le Tailleur; les deux Tuteurs; Une Folie; la jeune Mère ou les Acteurs de Société; Paul et
Virginie; Raoul, sire de Créqui; Un quart d'heure de Silence; Monsieur Deschalumeaux ou la Soirée de
Carnaval; Frédéric à Spandau ou le Libellé; Une Matinée du Maréchal de Catinat (dans cet opéra une
jeune artiste débute dans le rôle de Joséphine et son frère, âgé de dix ans, dans celui d'Auguste); le
Jugement de Dieu ou les Calomniateurs; Marcelin; Héléna ou l'Innocence reconnue; Léon ou le
Château de Monténero; l'Ermite du Mont Pausilippe ou César de Suza; Ma tante Aurore; Gulistan;
Adèle et Darsan; Milton; la mère Camus ou la Borgne, Bossue et Boiteuse; les Précepteurs (dans cette
pièce, M. Marcy, directeur, joue le rôle de Damis, capitaine de navire); Henri IV ou la bataille d'Ivry; les
Maris garçons.
A la veille de l'été, le 8 juin, « les artistes restés ou réunis en cette ville donnent une représentation
de l'Epreuve villageoise, opéra en deux actes, précédé des Deux Chasseurs et la Laitière, opéra en un
acte, joué par des enfants »
(4)
.
La saison suivante (1807-1808) s'ouvre le 7 novembre 1807, sous la direction de M. Duverger, «
directeur de Lille et des villes du département du Nord », par la représentation de Gulistan ou le Hullan de
Samarcande, opéra en trois actes, précédé des Petits Savoyards, opéra en un acte.
La troupe donne ensuite le Droit du Seigneur; les Dettes; le Mari retrouvé; Azémia; le Mercure
galant; la nouvelle Amitié à l'épreuve; Aline; les petites Marionnettes.
Le 18 février 1807, une bourrasque enlève une partie de la toiture de la salle de spectacle.
Entre autres nouveautés, on joue Victor ou l'Enfant de la Forêt, mélodrame en trois actes de M.
Guilbert Pixéricourt, au second acte duquel « M. Révalard, artiste distingué du Théâtre de la Porte Saint-
Martin, chargé du rôle de Roger, chef des brigands, exécute un combat à outrance au sabire et au
poignard avec Victor et au troisième acte, manœuvre réglée et commandée par M. Révalard. »
L'administration n'avait rien négligé pour la mise en scène.

Albert Bril / Généalogie et Histoire du Dunkerquois / G.H.Dk. Page 5
Puis, nous avons le major
Palmer; le Mariage du Capucin
; Ambroise :
le Jugement de Salomon
;
Célina ou l'Enfant du Mystére; la Caverne; le Calife de Bagdad.
Au carnaval, Cartellier-Saint-Albain loue encore ses habits de théâtre « et ceux de sa femme. »
Le magasinier du spectacle informe également les amateurs de mascarades « qu'il louera les habits
du magasin, consistant en habits de paysan à la turque, à l'espagnole, de nègre, de sauvage, de savoyard,
d'anglais, de travestissement, de page, de hussard, de dragon, de chevalier, de livrée, etc. »
Puis, c'est Plante fils qui « a l'honneur de prévenir le public que l'on trouvera chez lui et à la salle
de spectacle, un assortiment d'habits de bal, tels que dominos, mamelucks et costumes de théâtre. »
Le 14 août, il y a spectacle gratis. Au programme : Pierre-le-Grand et Crispin rival de son Maître.
Sous la rubrique : «Mélanges », notre Feuille du 8 août fait part de la mort de Mme Scio « dont la
perte récente est si vivement sentie au théâtre de l'Opéra-Comique, dont elle était l'ornement, après avoir
été celui du théâtre Feydeau, est née à Dunkerque. »
M
me
Scio, née Legrand, qui obtint, en effet, à cette époque, de grands succès à Paris, est née à Lille.
Ce sera quinze et vingt-cinq ans plus tard que nous aurons à parler de deux artistes dunkerquoises
qui s'illustrèrent dans les théâtres de Paris : Mmes Louise Lavoye (1823) et Suzanne Lagier (1833), et plus
près de nous encore, M
me
Méric Lalande (1867).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%