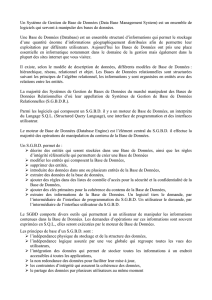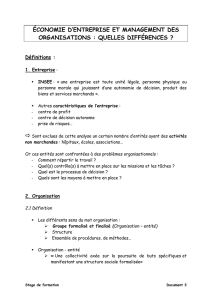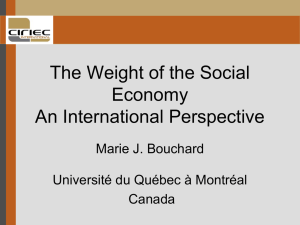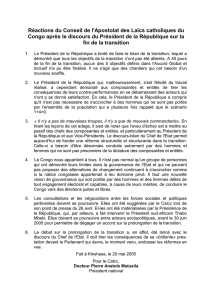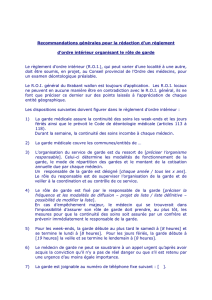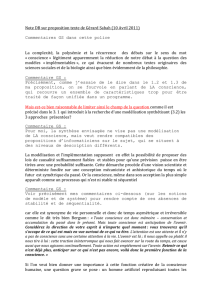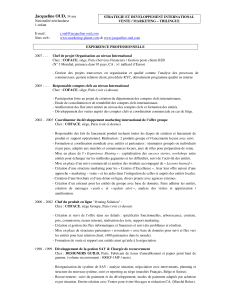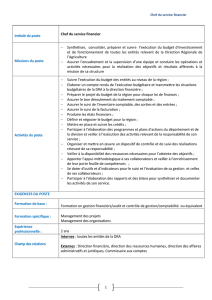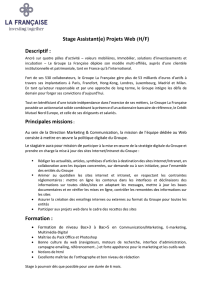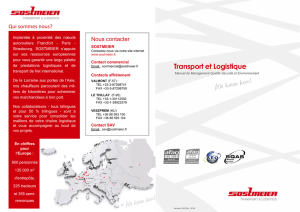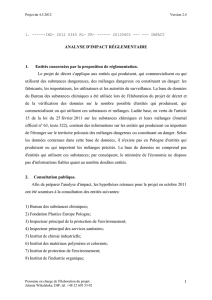les groupes d`économie sociale. dynamiques et trajectoires

Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et trajectoires.
Rafael Chaves et José Luis Monzón
LES GROUPES D’ÉCONOMIE SOCIALE.
DYNAMIQUES ET TRAJECTOIRES
Rafael CHAVES et José Luis MONZÓN
Département d’Économie Appliquée. U.D. Politique Économique
et CIRIEC-Espagne
Université de Valencia (ESPAGNE)
CITAR COMO :
CHAVES,R. Y MONZON,J.L. (2001) : « Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et
trajectoires », En : Côté,D. (dir) : Les holdings cooératifs. Évolution ou transformation définitive?
De Boeck – CIRIEC International, Bruxelles, pags. 53-76.
Table des matières
1 Introduction
2 Trajectoires: éléments théoriques
3 La logique des groupes d’économie sociale
4 La morphologie des groupes d’économie sociale
5 Trajectoires de l’économie sociale
6 Bibliographie

Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et trajectoires.
Rafael Chaves et José Luis Monzón
1 INTRODUCTION
Durant les dernières décennies, les groupes d’économie sociale se sont multipliés dans
le monde, en particulier dans les secteurs financier, de l’assurance, agroalimentaire et de la
distribution. Certains de ces groupes ont réussi à se positionner au premier rang de leur secteur
d’activité économique respectif.
Mais la pluralité a marqué leur évolution. Ainsi, croissance vertigineuse,
internationalisation, renforcement des liens au territoire et aux valeurs d’origine, privatisation et
vente au secteur privé à but lucratif (capitaliste) des activités plus rentables, et même
effondrement économique, ont parfois été le lot des groupes d’économie sociale.
Une vision rétrospective de ce champ de l’économie sociale met en évidence que la
matérialisation d’une pluralité de comportements et modes d’articulation interne, dans l’ample
éventail d’options possibles, a été leur caractéristique centrale. Néanmoins, dans ce panorama
nettement hétérogène, il est possible de repérer certaines régularités dans leur développement.
Étudier les facteurs qui influencent et orientent l’évolution et le développement des
groupes d’économie sociale devient impératif. Ce travail s’attache ainsi à analyser la
dynamique des groupes d’économie sociale en établissant les régularités dans leur évolution
sous deux angles: (1) la perspective du mode d’articulation morphologique des groupes
d’économie sociale, et (2) la perspective du maintien, du renforcement ou de la dénaturation
des traits distinctifs de l’économie sociale.
Une préoccupation centrale de ce travail consiste à vérifier si ces diverses formes
d’évolution renferment l’hypothèse de l’isomorphisme organisationnel, qui a traditionnellement
soulevé l’intérêt des chercheurs de l’économie sociale et coopérative. Selon cette hypothèse, le
processus de consolidation et de développement des groupes d’économie sociale, dans un
environnement de marché capitaliste, tendrait à les dépouiller de leurs traits distinctifs pour en
faire des entités proches des groupes d’entreprises dominantes. En effet, comme la théorie de
l’isomorphisme organisationnel l’indique (Oppenheimer, 1914; DiMaggio et Powell, 1983;
Bager, 1994), toutes les formes atypiques existantes dans un certain milieu, par exemple, les
coopératives dans l’économie de marché capitaliste, tendraient à perdre leurs traits distinctifs et
à converger vers la forme dominante – dans ce cas, les entreprises capitalistes. Si on applique
cette théorie aux groupes d’économie sociale, il semble qu’ils tendraient donc progressivement
à perdre leurs traits différentiels. Logiquement, cette perte progressive aboutira également à
une diminution de leurs propriétés spécifiques correspondantes, telle leur capacité de
contribution à la réalisation de buts d’intérêt général comme la création d’emploi, une
distribution plus équitable des revenus, une correction des déséquilibres territoriaux, la lutte
contre l’exclusion sociale, la satisfaction des nécessités sociales, la démocratisation
économique, etc. (Chaves, Monzón et Tomas-Carpi, 1999). Notre analyse devra donc aboutir à
l’identification des différentes trajectoires des groupes d’économie sociale, en particulier, des
trajectoires autorenforçantes ou dénaturantes des traits différentiels de l’économie sociale.
2 TRAJECTOIRES: ÉLÉMENTS THÉORIQUES
Ces derniers temps, la population d’entités d’économie sociale s’est adaptée de plusieurs
façons au nouveau contexte économique, dans l’ample éventail d’options possibles.
Évolutivement, l’expression précise du type de comportement des agents économiques
dans le temps, de leur adaptation ou transformation face aux menaces, pressions et défis de
l’environnement, est le contenu de la notion de trajectoire d’un agent économique. La notion de
trajectoire suppose l’existence de régularités dans le comportement de l’agent et, par
conséquent, d’une rationalité du processus. Quand il s’agit d’entreprises ou de groupes
d’entreprises, l’expression du comportement de ces agents se voit traduite dans des modes
typifiés de conception, voies d’évolution technologique et formes institutionnelles et
organisationnelles distinctives (Batsch, 1993; Tomás-Carpi, Gallego et al., 1999).

Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et trajectoires.
Rafael Chaves et José Luis Monzón
La matérialisation dans le temps d’une trajectoire d’entreprise ou autre est définie par,
d’un côté, la force directrice qui oriente l’évolution suivie et, de l’autre, l’influence de différents
types de facteurs.
Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, il s’agit d’une logique de création de
valeur d’un type spécifique, aussi connue comme logique de valorisation de certains actifs, tels
les capitaux investis ou le facteur travail, qui déterminent la trajectoire. Par conséquent, dans
cette logique de valorisation seront recueillis le centre d’émanation et l’explication de la
succession de décisions stratégiques qui définissent l’histoire économique du groupe. L’analyse
de ce centre d’émanation devient une tâche incontournable pour pouvoir analyser les
trajectoires. Mais il est également important d’analyser les facteurs centraux qui influencent,
conditionnent ou limitent l’orientation et l’évolution de l’agent principal. Dans ce contexte, on
part de l’hypothèse que chaque décision/action stratégique du groupe d’entreprises est le
résultat de la confluence systémique de deux groupes de facteurs: d’un côté, des éléments
internes du groupe, tels les principaux agents qui coexistent dans l’organisation, le cadre
institutionnel et culturel interne régnant, et le processus de négociation et d’affrontement interne
quand il s’agit d’adopter et de matérialiser cette suite de décisions stratégiques; et de l’autre,
les éléments externes de nature économique, institutionnelle ou culturelle (Cyert et March,
1963; Tomás-Carpi, 1991; Batsch, 1993; Coopey et al., 1998; Chaves, 1999b).
Pour pouvoir identifier les trajectoires des groupes d’économie sociale, il est pertinent
d’aborder les différents éléments considérés comme définitoires de la trajectoire.
3 LA LOGIQUE DES GROUPES D’ÉCONOMIE SOCIALE
3.1 La notion de groupe d’économie sociale
Quels sont les éléments définitoires d’un groupe d’économie sociale? Comme Chaves
l’indique (1999a), cette locution intègre deux éléments: d’une part, une structure
organisationnelle de groupe d’entreprises et, d’autre part, une réalité sociale se rattachant à
l’économie sociale. Il est donc indispensable de traiter les deux aspects comme point de départ
pour établir une définition.
Suivant la définition du terme « groupe » la plus générique, de nature sémantique1, il
s’agirait d’une « pluralité d’êtres qui forment un ensemble, matériellement ou mentalement
considéré ». Deux éléments peuvent être identifiés, l’un étant les unités différenciées (ou
nœuds), et l’autre, une logique de rapport entre elles (les liaisons) qui leur confère un sens de
collectif différencié. Si l’on applique ces éléments au monde économique des entreprises, les
deux éléments sont, d’un côté, les entreprises juridiquement indépendantes, et, de l’autre, une
logique de rapport (économique) entre celles-ci, qui est la base de leur configuration en tant
qu’entités différenciées. Les nœuds et les liaisons peuvent ainsi former différents types de
structures organisatives, des plus rigides et homogènes, comme le sont les holdings, aux plus
souples et flexibles, comme le sont les réseaux d’entreprises (Tomás-Carpi et al., 1997).
L’élément clé quand il s’agit de différencier les types de structures de groupes est la nature des
liaisons, c’est-à-dire, le genre de lien établi entre les entreprises du groupe. Ces liens peuvent
se fonder sur a) la coopération parmi des entités (nœuds), ou b) la domination de certaines
entités par rapport aux autres.
Quoique, en théorie, il existe un vaste éventail de possibilités de structures
organisationnelles de groupe, la conception la plus étendue de groupe d’entreprises dans la
littérature économique est celle du holding: une entreprise dominante ou mère dont les autres
entreprises dépendent au niveau du patrimoine, des finances ou économique, mais tout en
conservant leur indépendance juridique. C’est la forme la plus répandue de groupe
d’entreprises pour ce qui est des entreprises typiques du système économique, de nature
capitaliste. Cette conception est précisée dans la définition de « groupe industriel » la plus
étendue: « ensemble dérivé de la concentration d’unités d’entreprises au moyen d’une relation
de dépendance, à travers laquelle une société exerce sur d’autres un pouvoir qui détermine la
soumission de celles-ci à la volonté de la première, tout en conservant les personnalités
1 Dictionnaire de la langue espagnole, Real Academia Española, Madrid, 1984.

Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et trajectoires.
Rafael Chaves et José Luis Monzón
extérieures respectives ». Exceptionnellement, quelques définitions conçoivent l’existence
d’autres formes de groupes d’entreprises, considérées en général comme minoritaires, par
exemple la suivante: « ensemble de sociétés ou d’entreprises dont les décisions sont solidaires
ou interdépendantes et généralement orientées par une société dominante » 2.
Si le regard analytique s’oriente vers le secteur de l’économie sociale, celui-ci montre
une pluralité de structures de groupes d’entreprises dont le holding ne serait qu’une parmi
d’autres. À côté des formes traditionnelles du type holding coexistent des formes multiples
moins rigides, comme les groupes par coordination.
L’existence de cette pluralité de structures organisationnelles de groupes d’entreprises
d’économie sociale permet de réfuter l’hypothèse de l’existence d’une exacte corrélation entre
la structure du groupe et sa nature institutionnelle (capitaliste versus économie sociale),
synthétisable dans la proposition suivante: holding -> forme typique et hégémonique du groupe
d’entreprises capitaliste; groupe par coordination -> forme typique et hégémonique du groupe
d’entreprises d’économie sociale.
Le caractère différentiel des groupes d’entreprises d’économie sociale ne doit pas être
cherché dans leur morphologie mais dans d’autres éléments, dont un des principaux est la
nature de leur base d’entreprise, c’est-à-dire l’élément qui a dans le groupe les catégories
dominante et bénéficiaire, dans le sens de Gui (1991).
Sous cette perspective, dans un sens très général, on peut dire qu’il existe un groupe
d’économie sociale quand les deux catégories, dominante et bénéficiaire, reposent sur une
entité ou une coalition d’entités d’économie sociale. En dernier ressort, ce seront ces entités qui
imposeront leurs buts au groupe d’entreprises et qui orienteront leur trajectoire.
Mais cette première ébauche de définition peut sembler tautologique. Par conséquent, il
faut descendre au niveau de ces entités de base – et ne pas rester au niveau du groupe – pour
trouver le caractère différentiel, ce qui nous renvoie directement au débat sur le concept
d’économie sociale. À cet égard, deux approches de conceptualisation ont été employées: a)
celle qui souligne l’élément de l’agent économique important pour l’entité (p. ex., Gui, 1991); et
b) celle qui accentue l’importance des règles de comportement de l’entité (p. ex., la Charte de
l’économie sociale française de 1982, Monzón et Barea, 1994).
Si on cherche une synthèse éclectique des deux approches, on peut dire qu’il s’agit
d’un groupe d’économie sociale quand l’entité ou la coalition d’entités qui occupe une position
dominante et bénéficiaire dans le groupe satisfait à ces deux conditions: 1) l’agent économique
qui occupe la catégorie dominante et bénéficiaire est différent de l’investisseur-capitaliste; et 2)
le comportement de la dite entité respecte certains principes typifiés, synthétisables dans une
finalité de service aux membres et/ou à la collectivité plutôt qu’un but lucratif; un système de
décision démocratique; et une attribution des bénéfices qui considère comme prioritaires les
personnes et le facteur travail plutôt que le capital.
3.2 Les acteurs à l’origine des groupes
Partant de ces présupposés, s’interroger sur le type d’agent économique « dominant et
bénéficiaire » du groupe d’économie sociale est primordial, car ce sont ses intérêts (mutuels ou
généraux) qui orientent la stratégie, voire la trajectoire du groupe.
Auparavant, il convient de rappeler l’identité des détenteurs de ces catégories dans les
groupes d’entreprises capitalistes. Les catégories dominante et bénéficiaire, suivant l’approche
de Gui (1991), cristallisent pour ce type de groupe dans l’investisseur-capitaliste, qui est le
propriétaire de la quantité nécessaire d’actions dans la société capitaliste (SA et SARL) pour
exercer un contrôle effectif sur le groupe3. Les groupes de cette nature présentent une logique
2 Vocabulaire économique et financier, Asociación para el progreso de la dirección, Madrid, 1981.
3 Les différents types de contrôle (absolu, majoritaire et minoritaire), dépendants du pourcentage de
participations détenu et de la structure de la propriété des participations restantes, ont été largement

Les groupes d’économie sociale. Dynamiques et trajectoires.
Rafael Chaves et José Luis Monzón
de création de valeur pour l’investisseur du capital (qu’il soit familial, personnel, industriel ou
financier) visant, en principe, l’obtention d’un maximum de rentabilité possible en contrepartie
d’un minimum de risque.
Pour ce qui est des groupes d’économie sociale, la classification des agents
économiques offerte par Gui (1991) est intéressante à cet effet. Il répertorie quatre principaux
types d’acteurs susceptibles d’intégrer la base sociale des entités d’économie sociale, donc des
entités de base du Noyau Coopératif du groupe: les consommateurs ou usagers de biens et de
services, les producteurs, les travailleurs et les bénévoles qui offrent des ressources, des biens
et des services. Dans tous les cas, la logique de valorisation (intérêts) est différente de celle
des investisseurs-capitalistes.
Les deux premiers types d’agents – les consommateurs et les producteurs –,
contrairement aux deux derniers, ont en commun le rapport de leurs intérêts en tant que
collectif avec un secteur d’activité économique déterminé. Ainsi, dans le cas des
consommateurs demandeurs de logements, le rapport s’établit avec le secteur de la
construction, dans celui des consommateurs de services sanitaires, avec le secteur sanitaire,
etc. En ce qui concerne les producteurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs), le rapport s’établit
avec le secteur agroalimentaire, leur logique étant de valoriser leurs actifs, p. ex. la récolte,
dans ce secteur.
Les travailleurs, troisième type d’agents, tiennent à valoriser le principal actif dont ils
disposent: le facteur travail. Leur logique de valorisation se matérialise de manière multiforme,
cherchant à augmenter la capacité d’emploi, la rémunération, les qualifications, la stabilité, la
qualité, l’intégration et le statut social, etc., rationalité qui est, en principe, indépendante du
secteur économique. C’est à partir de cette rationalité qu’il faut interpréter les processus de
création de groupes par les coopératives de travailleurs (p. ex. le Groupe de Mondragón) et par
les entreprises d’insertion, processus qui vont de la création de groupes basés sur des
mécanismes de distribution inter-entreprises du travail et de stabilité de celui-ci, à celle de
groupes basés sur des mécanismes de placement dans des entreprises spécialement
constituées pour favoriser l’employabilité et l’insertion de collectifs défavorisés sur le marché du
travail.
L’intérêt du quatrième type d’acteurs réside dans la répercussion sur un objectif social,
plus concret (p. ex. lutte contre la toxicomanie, défense de l’environnement) ou général
(développement social et économique d’une région ou d’une zone rurale), de son action et de
ses ressources. Cet intérêt demeure institutionnalisé grâce à la constitution d’entités altruistes
(à but non lucratif, p. ex. une fondation) dotées d’un plan, d’une charte, ou de principes
orientant leur action.
Cette typologie d’acteurs est cependant trop simple. En réalité, l’homogénéité des
intérêts n’est pas toujours la règle dans les groupes, de même que pour les entités de base de
l’économie sociale. Il existe souvent des intérêts divergents (dans le sens de Cyert et March,
1963), et ce, à l’intérieur de la même catégorie d’agents (p. ex. les agriculteurs les plus
productifs et efficients face aux autres, les plus âgés face aux jeunes, Eschenburg, 1979; ou
encore les consommateurs qui valorisent davantage le prix du bien ou du service objet de la
consommation face à ceux qui valorisent plutôt la qualité, Gui, 1991).
3.3 Contraintes internes: cadre institutionnel et processus d’élaboration des décisions
Dans les groupes d’économie sociale, les décisions/actions successives effectivement
matérialisées, qui expriment la trajectoire réelle du groupe, sont le résultat d’un processus de
négociation entre des acteurs différents. Ces acteurs, ou agents économiques, présentent des
intérêts divers, voire divergents, et des positions de pouvoir et d’influence, ainsi que des
stratégies et une conception de la politique d’entreprise, tout aussi diverses. L’orientation de la
stratégie du groupe, et donc la forme et le contenu que celui-ci adopte, dépendront des intérêts
de la catégorie de l’agent dominant (ou de la coalition d’agents) au cours d’une période
étudiés par la littérature économique depuis Berle et Means (1932).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%