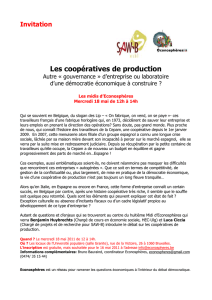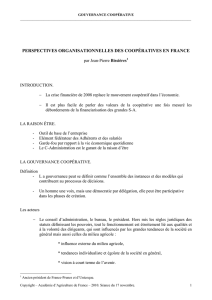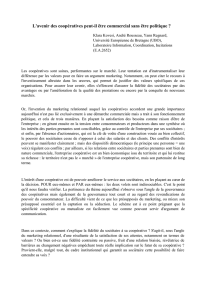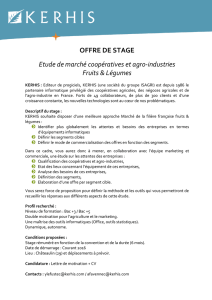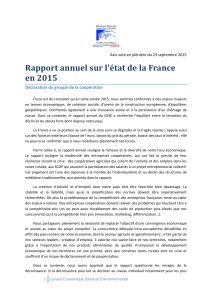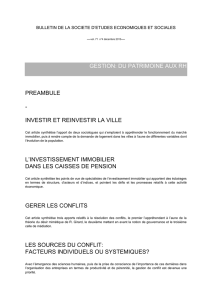Les entreprises coopératives

Invitation
DÉFI 2020: DE L’ANNÉE INTERNATIONALE
À LA DÉCENNIE COOPÉRATIVE
Mardi 15 janvier 2013
En partenariat avec
le Conseil économique, social
et environnemental
Avec le soutien
du Ministère de l’Economie sociale
et solidaire
Colloque organisé par Coop FR,
l’organisation représentative du
mouvement coopératif français, et
le Groupe de la Coopération
au CESE.
GROUPE DE LA COOPERATION
Avec le soutien
du ministère de l’Économie
sociale et solidaire
●La production de biens et services
●Les coopératives
●Sociétés de capitaux vs entreprises coopératives
●PIB et utilité sociale : question de mesure
●Coopératives et développement des territoires
●Coopératives, commerce équitable, développement
SUPPORT DE COURS
Les entreprises
coopératives
Jean-François Draperi
Directeur du Centre d’économie
sociale (Cestes/Cnam)
ÉDITION
2014

2Support de cours • Les entreprises coopératives • Édition 2014
Table des matières
NOTE DE L’AUTEUR 4
1. La production de biens et services et les formes d’entreprises 5
Texte 1 Production marchande et production non marchande de biens et services 5
Texte 2 Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire 6
Texte 3 Les organisations de production :
les diérents types d’entreprises 7
Texte 4 La distinction entre économie marchande et économie capitaliste 8
2. Les coopératives 10
Texte 5 Qu’est-ce qu’une coopérative ? 10
Texte 6 La double qualité coopérative 11
Texte 7 Le projet coopératif à travers l’histoire 11
Texte 8 Le projet de loi Hamon sur l’économie sociale et solidaire et les coopératives. 12
Texte 9 Avantages et inconvénients d’une spécificité française : associations et coopératives 13
Exemple 1 Naissance de la coopération de consommation :
La coopérative de Rochdale 14
Exemple 2 Une grande coopérative de production :
le familistère Godin à Guise 14
Exemple 3 En parallèle de l’histoire coopérative : la naissance des mutuelles d’assurance 15
Exemple 4 Une forme de la coopération agricole :
les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) 15
Exemple 5 Les coopératives d’entreprises individuelles ou familiales. 16
Exemple 6 Les coopératives de logement 16
Exemple 7 Les Sociétés coopératives de production (Scop) ou Sociétés coopératives et participatives 16
Exemple 8 Le Crédit Coopératif 17
Exemple 9 La société coopérative européenne 17
Texte 10 Les limites du mouvement coopératif 17
Texte 11 Le mouvement coopératif international 19
Texte 12 De l’année internationale des coopératives au Plan d’action 2020 20
3. Société de capitaux et entreprise coopérative :
deux organisations, deux modes de gouvernance 22
Texte 13 Du modèle managérial au modèle patrimonial :
la corporate gouvernance et les parties prenantes 22
Texte 14 Les conséquences sur la place des coopératives et de l’économie sociale 24
Texte 15 Nouveaux enjeux coopératifs : délocalisation, capitaux externes,
risque de démutualisation 25
Texte 16 Les atouts de l’organisation et de la gouvernance coopératives 27

3Support de cours • Les entreprises coopératives • Édition 2014
4. PIB et utilité sociale : questions de mesure 28
Texte 17 Du PIB à l’IDH 28
Texte 18 En France : un débat actuel 29
Texte 19 Eléments de l’utilité sociale
de l’économie sociale 30
Texte 20 Du PIB à l’utilité sociale
et de l’économie à l’économie sociale 31
5. Coopératives et développement des territoires 32
Texte 21 L’ancrage territorial des coopératives 32
Exemple 10 L’ancrage territorial des coopératives : exemple du Queyras 33
Texte 22 Le statut de Scic (loi du 17 juillet 2001) 34
Exemple 11 Une Scic innovante : Ôkhra 34
Exemple 12 Ardelaine, une coopérative de développement local 35
Exemple 13 Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) 35
Exemple 14 Coopaname 36
Exemple 15 À Chrysalide, un laboratoire
de recherche-action-formation 36
Texte 23 Coopérative et transmission de l’entreprise 36
6. Coopératives, commerce équitable, développement 38
Texte 24 La recommandation 193 de
L’organisation internationale du travail (OIT) 38
Exemple 16 Coopération d’épargne et de crédit et développement : un exemple au Mali 38
Exemple 17 Intégrer le secteur informel à l’économie mondiale :
l’action de la SEWA (Inde) 40
Texte 25 Le défi du commerce équitable 41
Texte 26 FLO, la coordination des labels
du commerce équitable 42
Exemple 18 La coopérative UCIRI à l’origine de Max Havelaar (Mexique) 42
Exemple 19 Les Nouveaux Robinson, première coopérative
de consommateurs de produits biologiques en France 43
Exemple 20 ENERCOOP : se fournir en électricité d’origine renouvelable 43
Exemple 21 Scop Ethiquable (Saint-Laurent, Gers) 43
Exemple 22 APROMALPI 44
Exemple 23 CICDA : des entreprises paysannes performantes 44
Exemple 24 La production et le commerce équitable Nord-Nord :
l’exemple des Associations pour le Maintien
d’une Agriculture paysanne (AMAP) 46
Bibliographie 48

4Support de cours • Les entreprises coopératives • Édition 2014
ouverture
NOTE DE L’AUTEUR
Jean-François
Draperi
Ce livret est destiné aux enseignants et intervenants ayant à présenter
les coopératives et le mouvement coopératif devant un public non spécialiste. Il est
conçu comme un manuel et peut être utilisé comme support d’intervention ou comme
document de travail communiqués aux élèves ou auditeurs.
Au-delà, il s’adresse à toute personne désirant découvrir les coopératives et le
mouvement coopératif contemporains.
Il s’organise autour de 26 textes et de 24 exemples qui présentent les coopératives
sous diérents angles et sont réunis en 6 parties : une présentation générale des
types d’entreprises permet de situer les coopératives et l’économie sociale et solidaire
dans l’ensemble de l’économie. La deuxième partie présente les entreprises et le
mouvement coopératif proprement dit et s’appuie sur de nombreux exemples qui
mettent en avant la diversité des entreprises coopératives. La troisième partie se
penche sur la gouvernance des entreprises coopératives. La quatrième partie montre
la nécessité, pour mesurer l’action coopérative et l’économie sociale, de ne pas se
limiter à son apport au PIB : économie au service de la société, la mesure de son
utilité sociale est incontournable. La cinquième partie met en évidence l’attachement
spécifique des coopératives au territoire : elles sont par excellence des entreprises de
développement local. Enfin la sixième partie montre le rôle précurseur et central des
coopératives dans le commerce équitable et dans le développement. Le document
alterne des textes courts et des textes approfondis, des tableaux synthétiques, des
exemples courts et des études de cas approfondis (classés également sous la rubrique
des exemples), et des exercices.
Bonne lecture !

5Support de cours • Les entreprises coopératives • Édition 2014
1. La production de biens et services et les formes d'entreprises
1. La production de biens
et services et les formes
d’entreprises
Texte 1 Production marchande et production
non marchande de biens et services
Les organisations productives sont les organisations
qui fournissent à la société des biens et des services :
les biens sont des produits matériels (pains, livres, voi-
tures, routes…), les services sont des produits immaté-
riels (formation, communication, assurance…).
Ces services peuvent être marchands ou non mar-
chands selon qu’ils sont vendus sur un marché ou
accessibles gratuitement. Le pain vendu à la boulan-
gerie est un bien marchand ; une assurance est un ser-
vice marchand. Les routes nationales comme le sport
réalisé dans une petite association locale sont des ser-
vices non marchands.
Les organisations produisant des biens et services
marchands sont des entreprises.
Les biens et services non marchands sont produits
essentiellement par l’Etat dans le cadre d’administra-
tions publiques (par exemple : l’Éducation nationale),
les associations (par exemple, l’association de pêche
ou la maison de jeunes) et la famille (pour des biens et
des services d’autoconsommation).
Certains biens et services peuvent être produits de
façon marchande et de façon non marchande : la
garde d’enfants, les services aux personnes âgées…,
et de façon générale l’essentiel de l’entraide entre les
personnes. Autre exemple : les routes nationales sont
dans le secteur non marchand mais les autoroutes
sont dans le secteur marchand.
Il existe un débat permanent pour distinguer ce qui
doit être fourni de façon non marchande et acces-
sible gratuitement et, le cas échéant, financé par
l’impôt d’une part, et ce qui est fourni sur un marché
et payant d’autre part. Selon la charte universelle des
droits de l’homme, les besoins fondamentaux doivent
être satisfaits par des biens et services accessibles à
chacun quelque soit sa richesse : la santé, l’éducation,
le logement, l’eau, l’électricité, les voies de transport,
le travail...
Cependant, plusieurs de ces activités sont fréquem-
ment réalisées au moins partiellement dans un cadre
marchand, ce qui pose de façon cruciale la question
des inégalités économiques et sociales. En eet, les
inégalités touchent dès lors l’accès à des besoins fon-
damentaux. La grande pauvreté en France et dans le
monde liée à l’inégalité d’accès aux biens et services
relatifs aux besoins fondamentaux contredit les valeurs
qui ont inspirés la définition des droits de l’homme et du
citoyen repris par l’Organisation des Nations Unies, la
Communauté européenne et la République Française.
Dans la conjoncture actuelle d’essor du libéralisme et
de transformation du rôle de l’Etat, la société se tourne
volontiers vers l’économie sociale et solidaire parce
que celle-ci ambitionne de proposer un projet écono-
mique original centré sur la personne.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
1
/
52
100%