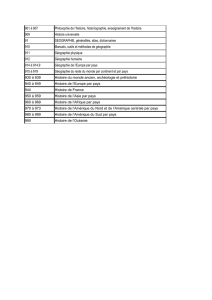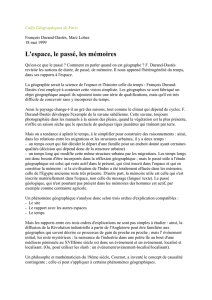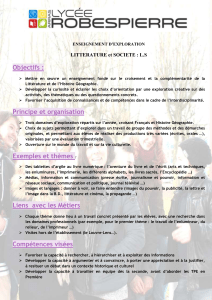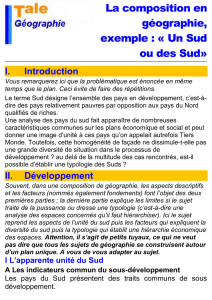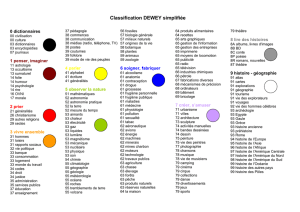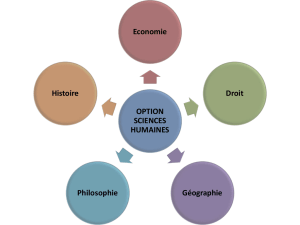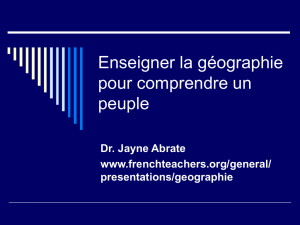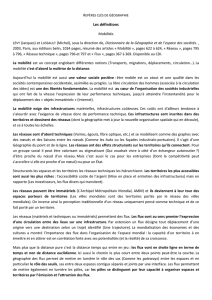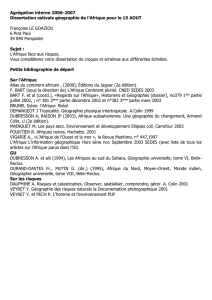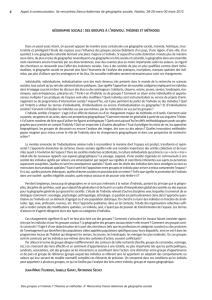géographie et développement durable, cours

1
Un nouvel enjeu pour la géographie : le développement durable ?
« Mais, que les Américains prennent garde de se livrer à une destruction
exagérée !... Peu à peu les baleines deviendront rares sur ces mers du Sud,
et il faudra les pourchasser jusqu’au-delà des banquises » (Jules Verne, Le
Sphinx des glaces, 1897).
Introduction : le développement durable, une chance pour la géographie ?
La circulaire du 8 juillet 2004 (BO n°28 du 15 juillet2004) « Généralisation d’une éducation à
l’environnement pour un développement durable (EEDD) » définit à la fois l’esprit et les contours de l’éducation
au développement durable. « Le concept de développement durable revêt une dimension éducative particulièrement
riche, en ce qu’il conduit à prendre en compte : - les différentes échelles de temps et d’espace ; - la complexité du domaine
dont les multiples composantes interagissant entre elles, appelle une approche systémique; - les différents axes d’analyse
scientifique qui fondent un développement durable (composantes environnementales, économiques, sociales, culturelles) ; - la
complexité des questions et des réponses envisagées, ce qui implique une approche critique et met en valeur l’importance des
choix et la responsabilité de chacun dans ces choix » Le développement durable figure explicitement dans le
socle commun de connaissance et de compétences (école-collège), mentionné dans le pilier Humanités
et il est devenu le concept central des programmes de géographie cinquième et de seconde qui seront à
l’œuvre à la rentrée 2010 : ceci explique d’ailleurs l’émergence du sujet…
Cette conjoncture tend à donner un premier élément de réponse à notre question, voire à clore
le débat tant le développement durable apparait bien comme un enjeu pour la géographie scolaire.
Celle-ci souffrirait d’être mal aimée des élèves, mal enseignée par des enseignants à 80% historiens.
Avec le développement durable la géographie scolaire tiendrait un thème fédérateur, consensuel, actuel
et en lien avec les préoccupations de la jeunesse !
Si donc la question est incontournable pour les enseignants de géographie du secondaire, c’est
une raison suffisante pour que la géographie universitaire s’empare de la question dans le but de fournir
aux enseignants de géographie un savoir scientifique de haut niveau et une approche critique. Mais
depuis les années 70 la géographie universitaire a coupé le cordon qui la faisait dépendre de la
« géographie des professeurs », il faut à l’Université d’autres motivations. Nous explorerons cette
question dans la première partie de ce cours : la géographie a-t-elle besoin du développement durable ?
puis nous nous centrerons sur le terme « développement » pour explorer la relation entre géographie et
développement et nous terminerons par une réponse paradoxale : c’est le développement durable qui a
besoin de la géographie !
I. La géographie à la rencontre développement durable
Il y a vingt ans, les sections géomorphologie et climatologie des départements de géographie des
Universités étaient désertées. Leur place qui fut longtemps la première dans les études de géographie
était devenue marginale. La géographie humaine, économique, sociale, spatialiste et plus tard culturelle
attirait étudiants et chercheurs. A l’instar de Roger Brunet ou d’Olivier Dolfuss les plus grands, et les
plus médiatisés, avaient montré l’exemple de l’abandon de ces spécialités au profit de spécialités plus
immédiatement en prise avec la question de l’aménagement du territoire (Brunet) ou de la
mondialisation (Dolfuss).
Aujourd’hui le mouvement s’est inversé: les géographes qui sont invités sur les plateaux de
télévision sont ceux qui apportent une expertise scientifique dans les domaines de la gestion des
ressources, ou dans le domaine de la géographie des risques.
Les géographes n’ont cependant pas attendu l’émergence du concept de développement durable
pour s’intéresser à la relation entre l’homme et l’environnement et souvent pour se poser en défenseur
de la nature.

2
Contrairement à l’idée répandue, le principe d’un développement qui soit durable ne date pas d’hier.
Ainsi, en 1811, dans son Dictionnaire général raisonné et historique des Eaux et Forêts Jacques Joseph
Baudrillard propose la définition suivante de l’aménagement : « C’est l’art de diviser une forêt en coupes
successives ou de régler l’étendue ou l’âge des coupes annuelles, de manière à assurer une succession constante de produits
pour le plus grand intérêt de la conservation et de la forêt, de la consommation en général et du propriétaire ». 50 ans
plus tard, Adolphe Parade dans Notice historique sur l’art des aménagements (1860) développe ainsi sa
définition : « L’art d’aménager les forêts est né d’un besoin d’ordre et de la préoccupation de sauvegarder les nécessités de
l’avenir, tout en donnant satisfaction aux exigences du présent ».
Il ne s’agit cependant pas là de géographes, pas plus que Jules Verne dont j’ai mis une citation en
exergue. C’est, encore une fois, Elisée Reclus qui sert de référence aux géographes qui se réclament
d’une tradition de préoccupation pour le thème du Développement durable. Ainsi l’un de ses derniers
biographes, Jean Didier Vincent intitule son livre : « Elisée Reclus, géographe, anarchiste, écologiste ». Dans un
petit ouvrage récemment réédité, histoire d’un ruisseau en 1869, Reclus abordait le rapport avec la
nature d’une façon poétique et quasi religieuse qui enthousiasme nombre d’écolo d’aujourd’hui (Doc 1).
Dans un article de la Revue des Deux mondes de 1866 il avait davantage théorisé sa position (Doc 2).
C’est la même année, 1866, qu’apparaît sous la plume du biologiste allemand Ernst Haeckel le
terme d’écologie qu’il fabrique à partir du grec « oikos » (maison –habitat) et logos (savoir) : science de
l’habitat… Dans son ouvrage Morphologie générale des organismes, Haeckel définissait la science écologique en ces
termes: « (...) la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large,
la science des conditions d'existence. ». Voila une définition que la géographie aurait volontiers pris pour
son compte. La relation entre la géographie et l’écologie (science) a été à peu près aussi compliquée que celle
que nous avons déjà évoquée entre la géographie et la sociologie, tant leurs objets et leurs méthodes étaient
souvent confondues. A la fin du XIXème siècle les géographes avaient inventé le terme de « géographie
humaine » que les géographes français ont préféré à anthropo-géographie proposé par Friedrich Ratzel.
Celui d’« écologie humaine » a été proposé en 1922 par Harlan H. Barrows: Geography as human ecology
Annals of the Association of American Geographers, vol 13, 1922 et repris en France par Maximillien
Sorre : Les Fondements biologiques de la géographie humaine. Essai d'une écologie de l’homme Paris,
Librairie Armand Colin, 1943.
Mais les années cinquante mettent un terme à ce qui est désormais perçu comme un déterminisme
naturel. La géographie humaine est alors économique, sociale et bien peu environnementale. Le divorce
est cependant loin d’être total. Voyez par exemple comme le géographe belge Hubert Béguin
envisageait en 1965 la question des inondations dans un article de synthèse de la revue Tiers Monde
(doc 3).
Béguin s’appuie largement sur des travaux pionniers de géographes américains, parmi lesquels
Gilbert Fowler White, qui publie en 1974 des travaux sur les investissements contre les inondations
dans la Tenessee Valley. Il montre que malgré les 5 Milliards de dollars investis par le gouvernement un
plus grand nombre de personnes vit dans les zones à risque qu’auparavant. Les aménagements ont
renforcé le sentiment de sécurité ! Les études se sont alors multipliées sur l’aspect psychologique des
comportements humains : pourquoi l’homme choisit-il de rester dans des zones à risque ? Pourquoi
oublie-t-il si vite les risques auxquels il s’expose ? Le croisement de ces préoccupations de des études
sur les « facteurs de risques » naturelles débouche sur l’émergence d’une branche autonome de la
géographie : la géographie des risques. Cette branche de la géographie à connu un essor formidable en
France sous l’impulsion de Fernand Verger (les zones humides du littoral français, Belin 2009) qui a
entraîné de nombreux géographes comme André Dauphiné (Risques et catastrophes - Observer,
spatialiser, comprendre et gérer, A Colin 2003) ou Patrick Pigeon (Géographie critique des risques,
Economica, 2005) et bien entendu Yvette Veyret.
La géographie de la santé a connu, on l’a vu, une mutation du même ordre : du déterminisme à
l’étude des relations entre milieu, société et représentations de la santé.
La géographie économique qui s’intéressait à la localisation des activités productives évolue avec
son objet : la raréfaction des ressources du sol et du sous-sol, le développement des transports ont
contribué dès les années soixante à dissocier de plus en plus les localisations industrielles des
localisations des ressources, cette dissociation spatiale devient en elle-même un objet géographique…

3
Des géographes glaciologue et climatologue comme Jean Jouzel (Le climat : jeu dangereux de Jean
Jouzel et Anne Debroise - Editions Dunod, 2004) ou Martine Tabeaud (Le changement en
environnement, presse de la Sorbonne, 2008) participent au débat public sur le réchauffement
climatique et contribuent à redonner de l’allant à la climatologie.
De façon autonome d’abord puis sous l’impulsion des problématiques posées dans la société
autour du développement durable, les problématiques du développement durable irradient toute la
géographie et constituent une source d’alimentation conceptuelle. Ainsi les concepts de capital naturel,
d’adaptabilité (capacité d'un système, d'une région ou d'une communauté, à ajuster ses mécanismes et sa
structure pour tenir compte des changements environnementaux réels, potentiels ou supposés),
d’accessibilité (quel prix économique les sociétés sont-elles prêtes à payer pour leur environnement,
quel prix environnemental sont-elles prêtes à payer pour leur développement ?).
Et finalement c’est toute la démarche géographique qui se retrouve dans les démarches liées au
développement durable dans ce qu’elles favorisent l’analyse des interdépendances spatiales. C'est le
territoire qui est le lieu d'interdépendances renforcées. Une action sur une zone donnée a, certes, des
conséquences sur la zone en question, mais aussi des effets de débordement sur d'autres territoires
(voire par exemple le passage, comme forme dominante, des pollutions localisées aux pollutions
transfrontières) et les géographes se passionnent aussi pour l’étude des disjonctions entre l'origine
spatiale du phénomène et le lieu de manifestation de ses effets. Ce qui a une très forte implication
géopolitique : "l'espace des réponses" (Etats…) est appelé à évoluer et avec lui les configurations
spatiales du pouvoir. Ainsi l’étude du développement durable en géographie intègre des domaines bien
éloignés a priori des strictes questions environnementales auxquels la vulgate journalistique tend à les
limiter.
II. Le développement durable : renouvellement de la notion de développement et de sa
géographie
Qu’est ce que le développement durable ?
La définition, devenue classique, é été formulée à la conférence de Rio de Janeiro en 1992
« Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins ». Cette conférence fut l'occasion, pour la première fois, de
médiatiser la notion de développement durable (sustainable development) préalablement défini par l'ONU
en 1987 (rapport Brundtland). Le terme de sustainable a été traduit par l'adjectif durable dans la mesure où
le mot soutenable, en français, n'implique aucune dimension temporelle. Il s'agit de tenter de concilier
les impératifs du développement, plus particulièrement pour les pays du Sud en retard, avec les
contraintes environnementales au Nord comme au Sud. Néanmoins, malgré des différences
d’interprétation parfois fortes, tout le monde reconnaît maintenant que cette notion recouvre les trois
aspects fondamentaux du développement et de la qualité de vie de nos sociétés : le développement
économique, la protection de l’environnement et le développement social et humain.
La notion de développement durable est apparue quand celle de « développement » a cessé
d’être centrale dans les discours.
La géographie a sans doute toujours préféré le développement au développement durable. Dans
les années 50 à 70 la géographie se préoccupait, comme l’économie de la croissance que les économistes
définissaient "l’augmentation soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues, d’un indicateur de
dimension : pour une nation, le produit global net en termes réels, la croissance a un caractère durable, elle
s’oppose aux phases d’expansion, récession ou dépression qui sont plus conjoncturelles et de durée plus
limitée » (F Perroux). La conception dominante de l’économie (y compris de l’économie spatiale)
reposait sur l’idée que l’économie se déploie dans un espace homogène et que la seule variable est le
temps. Ainsi Walter W. Rostow avait développé une théorie des étapes de la croissance économique
(doc 6) qui reposait sur ces postulats. Du coup, la géographie n’avait d’autre rôle que de dresser le
tableau des différences. La théorie de la croissance n’expliquait pas pourquoi que certains pays s’y
engageaient et pas d’autres, question d’histoire, question d’opportunité. A cette vision très optimiste, la
réalité opposait un démenti très net. C’est pourquoi les économistes cherchaient à définir les obstacles à

4
la croissance. Les géographes qui s’intéressaient à ces questions, comme Pierre Marthelot par exemple,
insistaient sur l’apport des géographes dans la détermination des stratégies de développement au niveau
local : l’étude des situations sous l’angle des potentialités, l’étude des ressources et des obstacles
envisagés sous l’angle d’un possibilisme très vidalien.
Chemin faisant, des économistes en virent à concevoir que l’économie fonctionnait en système
avec la société et à mobiliser la notion de développement. Nurske, par exemple développa une théorie
des cercles vicieux de la pauvreté qui ne pouvaient être brisés que par l’intrusion d’un facteur exogène :
ainsi naquit l’aide au développement. De leur côté les économistes marxistes considéraient que
l’obstacle principal au développement était le capitalisme et qu’il suffisait de le supprimer pour
construire le cercle vertueux de l’économie socialiste sur le modèle soviétique ou chinois. De fait le
développement était un enjeu de la guerre froide.
A la fin des années 60, au début des années 70 les échecs des politiques de développement
conduisent à des remises en cause de l’optimisme général. Des théoriciens comme Samir Amin et
Emmanuel Wallerstein s’intéressent à la question des relations de domination par les échanges. Samir
Amin développe la théorie de l’échange inégal : l’échange produits de base / produit transformés
s’opère de manière inégalitaire et profite aux plus riches, l’écart ne cessant de s’aggraver du fait de la
détérioration des termes de l’échange. Aux concepts de « pays développés et sous-développés », il
substitue les concepts beaucoup plus spatialisant de « centre et périphérie ». Ainsi les anciennes analyses
de l’économie spatiale à la Von Thünen se retrouvent recyclées au prix d’un changement d’échelle. Des
géographes comme Yves Lacoste s’emparent de ces théories pour en éprouver la pertinence à
différentes échelles. Pierre Gourou, dans un article des Cahiers des Sciences Humaines en 1992,
s’intéresse par exemple à la situation de l’Afrique noire qu’il connait bien. Il souligne l’importance des
structures sociales rurales, du mode d’appropriation du sol, de l’absence de propriété privée par
exemple pour expliquer l’échec des réformes agraires venues d’en haut.
L’analyse géographique s’en trouve largement renouvelée. La géographie du développement
économique envahit d’ailleurs les programmes scolaires dans les années 70 et 80. Jusqu’à ce qu’à
nouveau le vent tourne. Pour Sylvie Brunel le tournant est géopolitique.
Sylvie Brunel donne une définition politique et ethique de la notion : « le développement, c'est ce qui
permet à l'être humain d'exercer pleinement son libre arbitre parce qu'il vit mieux et plus longtemps, parce qu'il a accès à
l'éducation et à la santé, parce que les opportunités qui s'offrent à lui sont démultipliées. Or par une étrange coïncidence, le
développement se trouve discrédité au moment même où, avec la fin de la guerre froide, l'aide publique au développement
s'effondre parce qu'elle a perdu son intérêt stratégique avec la disparition de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là
qu'émerge le développement durable ».
La critique du développement durable qu’engage Sylvie Brunel est sévère : voici par exemple ce qu’elle
dit dans une conférence de 2009 après la sortie de son brûlot : Sylvie Brunel, A qui profite le
développement durable ? Larousse, 2008.
A cette critique les partisans du développement durable, y compris des géographes comme
répondent que le développement économique et social sont deux des piliers de la notion que Sylvie
Brunnel semble oublier et que le développement durable permet à l’inverse de relancer la notion de
développement, les géographies économiques et sociales y trouveraient l’occasion de se renouveler. Les
géographies du sous-développement, de la santé, de la faim, et les géopoliticiens auraient ainsi donc
toute leur place dans les études basées sur cette notion.
III. la géographie est une chance pour le développement durable !
Tandis que les abus terminologiques du "développement durable", son affichage au cœur de
nombreux rendez-vous politiques et scientifiques mais aussi à travers les stratégies de communication
des entreprises ou des collectivités territoriales, contribuent à brouiller la notion, les géographies
permettent, à l’inverse, de clarifier les niveaux d’analyse. Tout d’abord en rappelant comme le font
Sylvie Brunel et Yvette Veyret que le volet « environnemental » ne doit pas occulter les deux autres et
que c’est leur combinaison dans l’espace des sociétés qui, selon une démarche géographique, doit être
privilégiée.

5
L’approche géographique multiscalaire permet également d’aborder la notion de développement
durable sans occulter les tensions qu’elle génère. A petite échelle, Martine Tabeau souligne que le
« réchauffement climatique » ne fera pas que des perdants : les ressources et les voies de
communications des zones arctiques pourraient s’en trouver plus accessibles.
A une autre échelle voila l’exemple d’un article d’Hubert Théry et Neli Aparecida de Mello qui
montre comment l’Etat brésilien joue habilement des jeux d’échelles pour s’imposer comme le
champion de la préservation de la forêt tout en gardant le contrôle absolu de son territoire (L’État
brésilien et l’environnement en Amazonie : évolutions, contradictions et conflits, L’Espace géographique,
2000). Ou encore celui de Jérôme Monnet (L’urbanisme dans les Amériques : modèles de ville et modèles de
société, Éd. Karthala, 2000) montre comme l’argument environnemental est détourné dans les villes du
Brésil ou du Mexique pour justifier l’édification de barrières socio-spatiales de plus en plus étanches.
Yvette Veyret, s’interroge sur les effets d’échelle en matière de politique de développement
durable : « Doit-on privilégier l’approche top-down ou entrer en développement durable par le bottom-up ? Faut-il
privilégier l’échelle locale ou l’échelle globale ? Comment articuler les deux ? La mise en œuvre du développement durable
venu du haut est souvent mal perçue par les politiques et les populations locales qui la comprennent mal et y voient une
forme d’ingérence intolérable. Issue du bas, des citoyens, la mise en œuvre de politiques locales de développement durable
peut aller à l’encontre d’objectifs plus vastes et le phénomène NIMBY est dans bien des cas difficile à éviter ou à dépasser.
Comment le développement durable s’inscrit-il dans la question du développement des pays du sud ? Là encore les
propositions émanant des grands organismes internationaux (par le biais de la banque mondiale notamment), des ONG,
sont calquées sur les pratiques et les choix des pays riches et ne correspondent guère aux attentes des politiques et des
populations des pays en développement. Le développement durable n’a pour l’instant guère contribué à faire avancer ces
questions pourtant fondamentales. Les modèles issus des pays industrialisés ont fait long feu. L’ingérence écologique est
difficilement acceptée par les pays du sud ce qui se conçoit aisément, de sorte que le développement durable apparaît encore
largement aux yeux des pays en développement comme "un luxe de riche", une série de "y-a-qu’à" simpliste et
simplificateur, quand il n’est pas perçu non sans quelques raisons comme une manière de mieux traiter la nature que les
humains ».
Cette approche critique du concept n’empêche donc pas les géographes de s’engager dans la voie de
l’interdisciplinarité qu’ouvre le travail sur le développement durable. C’est le cas par exemple de la
revue Développement durable et territoire ( http://developpementdurable.revues.org/) crée en 2002,
qui rassemble des géographes, des économistes, des juristes, sociologues, spécialistes de sciences
politiques… dont les titres des dossiers montrent la richesse de l’apport de la géographie à l’approche
du développement durable : approche territoriales du DD, Gouvernance locale et DD, les dimensions
humaine et sociale du DD, la ville et l’enjeu du DD, économie plurielle, responsabilité sociétale et DD,
les territoire de l’eau, proximité et environnement, Méthodologie et pratiques territoriales de
l’évaluation en matière de DD, inégalités écologiques, inégalités sociales, biens communs et propriété ;
identités, patrimoines collectifs et développement soutenable, catastrophe et territoires.
Dernier exemple de la contribution de la géographie au développement du savoir sur le DD : Des
universités (Bordeaux, Toulouse, Pau, Bruxelles…) proposent un Certificat International d’Ecologie
Humaine, intégré au système LMD, dont les enseignants sont issus de la sociologie, de l’histoire, du
droit, des Sciences politiques, de la physique, de la biologie, et de la géographie !
Conclusion : à travers tous ces exemples on le voit, et cela nous renvoie à la fonction sociale de
l’enseignement de la géographie, c’est bien vers une géographie critique du développement durable qu’il
s’agit d’aller qui profitera autant à la géographie dont l’intérêt en sera renouvelé qu’à la notion de
développement durable qui, sans ce regard critique, se perdra dans les discours lénifiant, voire
manipulateurs.
1
/
5
100%