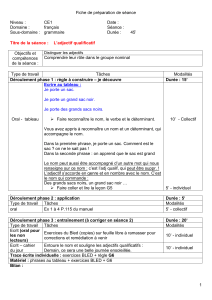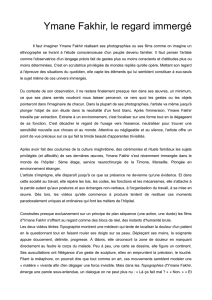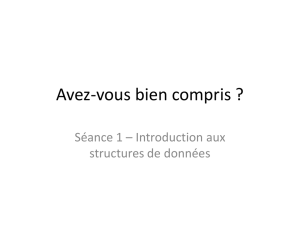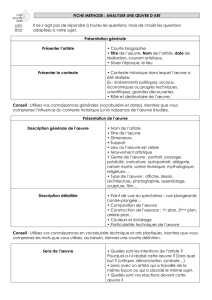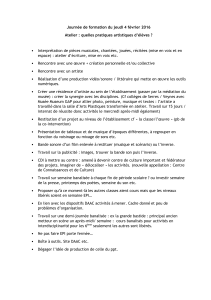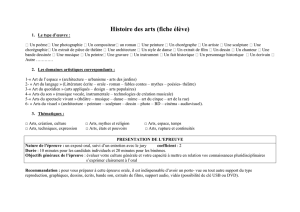le corps, la pensée, l`hybride

Kader Attia,
le corps, la pensée,
l’hybride
TEXTES DE KADER ATTIA
ET DE SELOUA LUSTE BOULBINA
« Ingrats qui se crurent libérés du corps et de cette
terre : mais à qui devaient-ils le spasme et la volupté de
leur extase ? À leur corps et à cette terre. »
Ainsi parlait Zarathoustra. Nietzsche
ARTISTE
60

RUBRIQUE
61
TOURS. DU 4 AVRIL AU 8 NOVEMBRE 2009.
Kasbah.
Centre de création contemporaine de Tours.

Failles, 2009
Depuis plusieurs années maintenant, j’interroge les
questions fondamentales de notre existence à travers
l’art, conduisant mes recherches à la lumière de la
philosophie, de la poésie et de la psychanalyse.
J’essaie de toujours entrevoir mon travail sur le
chemin de la recherche, avec l’aide du détour et de
l’ellipse. Chaque œuvre est relative à son contexte
spatial et temporel.
Le monde dans lequel nous vivons semble redécou-
vrir la réalité.
Il y a quelques années, suite à l’explosion de la
“bulle internet”, la spéculation économique, fondée
en partie sur une mythologie “des produits déri-
vés”, n’a cessé de se développer en repoussant les
limites du réel en dehors du système de valeurs du
bon sens. Même la probabilité de l’obtention d’un
crédit est devenue un produit financier, sur lequel on
a spéculé en bourse, entraînant la finance vers une
économie aux valeurs virtuelles. Une bulle de vide
où de modestes propriétaires de maisons acquises
à crédit ont vite été rattrapés par la réalité de leur
endettement, ce qui a conduit des millions d’entre
eux à rendre leur logement.
Mais ceci n’est que la partie visible de l’iceberg.
Ces dernières années, l’économie mondiale n’a
cessé de croître virtuellement, en se fondant sur
des valeurs fictives d’un argent qui n’existe pas : le
crédit. Il semble pourtant que l’onde de choc des
premières faillites de l’automne dernier réveille les
consciences. L’éthique comme la voie du Salut pos-
sible est à l’ordre du jour.
Mais pour combien de temps ?
Cette ère qui, depuis la chute du bloc de l’Est, nous
a accoutumés à penser qu’elle était celle de “la fin
des idéologies”, semble se préparer à une nouvelle
ère : celle des “nouvelles idées”, comme le dit le phi-
losophe Alain Badiou dans son article du Monde du 17
octobre 2007 intitulé : “De quelle réalité cette crise
est-elle le spectacle ?” Cette crise a en effet provoqué
une chose nouvelle. Elle a déclenché une faille réelle
dans ce monde virtuel sur lequel s’était assoupi,
confiant, notre système économique et social.
Ce retour violent du réel a surpris tout le monde.
Pourtant, la tension qui préserve les fragiles démo-
craties capitalistes – l’équilibre entre le marché et
l’État de droit – est toujours mise à l’épreuve par la
cupidité et la perte du bon sens des hommes.
ARTISTE
62

Dans une société capitaliste, cet équilibre entre l’État
de droit et l’économie de marché est indispensable,
sinon l’éthique, de quelque nature soit-elle, reste un
moyen au lieu d’être une fin.
C’est ce que l’on observe tous les jours, de l’art à la
guerre. Notre acceptation d’un degré insoutenable
d’inégalités dans nos régimes démocratiques, où la
“morale démocratique” sert d’alibi à ces contrastes,
en est un signe révélateur.
Voilà pourquoi je m’intéresse aux failles. Elles sont ce
que les humains ne regardent plus ; peut-être parce
qu’elles sont paradoxales, puisqu’elles séparent les
choses autant qu’elles les lient.
La Raison démontre que l’ordre des choses ne se
base pas seulement sur un système fondé sur les
comparaisons et les similitudes entre deux choses.
En effet, par inférence, nous pouvons également
assimiler les différences entre les choses comme
des analogies qui lient ces choses entre elles (René
Descartes, les Regulae).
Cette pensée de Descartes souligne ce qui se situe
entre deux notions paradoxales comme une taxinomie
variable, que ce soit pour le vide et le plein, l’absence
et la présence, l’espace et le temps, la vie et la mort…
La faille entre des éléments paradoxaux, lorsque la
pensée les envisage, révèle une multitude de sens qui
n’apparaissent pas dans chacun de ces éléments.
Cette faille les sépare autant quelle les relie ; elle est
autre chose…
Cet espace, à la fois vaste et ténu, est difficilement
définissable, si ce n’est par sa propre expérience.
Passer mon enfance entre la France et l’Algérie m’a
amené à me sentir proche aussi bien de la pensée
arabe et orientale que de la pensée occidentale.
Mon père, qui n’a jamais cessé d’aller et venir entre
ses montagnes natales et la France, m’a dit un jour :
Double page précédente :
Failles. 2008, installation, sacs plastiques vides, dimensions variables.
Courtesy Galerie Anne de Villepoix, Paris et galerie Christian Nagel,
Berlin & Cologne.
Ci-dessus :
Untitled.
2008, dessin, stylo à bille sur papier, 32 x 40 cm. Courtesy collection privée.
ARTISTE
63

“La chose la plus importante, lorsque tu émigres, ce
n’est ni l’endroit d’où tu viens, ni celui où tu vas, mais
c’est le voyage.” Cette image m’a beaucoup influencé
et joue encore un rôle important aujourd’hui. Elle a
développé chez moi une “pensée ergonomique” qui
m’amène à penser de façon “hybride”. J’envisage
l’entre-deux des choses comme un champ libre,
ouvert, au détriment de celui des extrêmes où l’on
risque d’être piégé d’un côté ou de l’autre.
Cette obligation d’“aller et venir” m’a conduit à ne
jamais me sentir à l’aise au même endroit, dans la
même position et, par extension, dans le même état
d’esprit, où l’immobilisme guette.
J’ai développé, inspiré par le comportement de mes
ancêtres aussi bien que par celui de mes parents
immigrés, une manière de penser nomade. Je l’inter-
roge souvent. Cette hybridité de ma pensée nourrit
mon processus artistique et vice versa…
Je crois que l’hybridité succédera à la fin de l’espèce
humaine telle que nous la connaissons aujourd’hui, et
telle qu’elle est apparue au début du XIXe siècle, comme
Michel Foucault l’explique dans Les Mots et les Choses.
Elle ne semble pas visible, pourtant, je sens que cette
mutation a commencé depuis un moment déjà.
Il faut du temps et de la distance avant de se rendre
compte de ce qui est en nous.
Quand j’étais en France, en banlieue, où je tra-
vaillais, chaque soir, lorsque je marchais de mon
atelier à chez moi, je passais beaucoup de temps à
regarder une foule de gens attendant avec des sacs
plastiques vides à la main, dans la rue, en face d’un
camion, d’où ils pouvaient recevoir de la nourriture
gratuite. Ils pouvaient avoir une brique de lait, un
pain de beurre, une boîte de sucre. Ils attendaient
en petits groupes, en silence, se serrant les uns
contre les autres dans le froid. Un jour, après avoir
longuement regardé un sac vide (laissé sur un banc
par un sans-abri, qui en avait retiré le sucre, le lait
et le riz qui lui avaient été donnés pour les vendre à
l’épicerie la plus proche), les traces que la nourri-
ture avait laissées sur la forme du sac sont restées
gravées dans ma mémoire. Le sac était vide, mais
tenait debout, gardant de manière suggestive la
trace de ce qu’il avait contenu. Le vide de ces formes
illustrait, à mes yeux, avec une pertinence à la fois
politique et poétique, les nombreuses questions que
je me posais depuis plusieurs années.
Ce sac vide représentait quelque chose entre ce qui
peut et ce qui ne peut être vu : par sa présence, il
montrait le vide à l’intérieur et à l’extérieur du sac ;
un vide physique et variable.
De la Chine au monde arabe, la relation paradoxale
du vide et du plein a une longue histoire. Cette idée a
certainement évolué pendant des années à travers
la Route de la soie, de la calligraphie à l’architecture,
de la religion à la philosophie. Le vide a beaucoup
d’importance en Orient, un territoire s’étendant de
Rabat à Tokyo comme dit Édouard Saïd dans son
Orientalisme. De Lao-Tseu à Henri Moore, le vide a
toujours été une donnée spatiale, opposée au plein. La
phrase de Lao-Tseu : “L’Homme crée des choses, mais
c’est le vide qui leur donne sens”, l’exprime très bien.
Lorsque Yves Klein expose Le Vide en 1958 comme
une altérité dans un contexte de doute politique, il
montre que le vide peut aussi être pensé comme
politique et historique. En effet, à cette époque, la
France était au milieu d’une période de transition
entre la IVe et la Ve République. Elle se trouvait égale-
ment en plein dans les guerres de décolonisation, en
Indochine ou en Algérie. Les doutes quant à l’avenir,
pressentis à travers le vide que la perte des colonies
laisserait sur le plan économique, géopolitique et
culturel, ont alimenté une angoisse face à un avenir
qui apparaissait comme un vide immense.
Dans l’installation Failles, faite de sacs plastiques
vides, le référent politique du vide (son “histoire”),
coexiste avec son signe poétique. Cette relation entre
le signifiant et le signifié, régie par l’interdépendance,
est possible car chacun représente l’autre.
Ces deux aspects du vide, poétique et politique, exis-
tent aussi bien dans l’espace que dans le temps. Ces
notions existent en effet à travers l’espace contenu et
l’espace contenant chaque sculpture, mais elles sont
aussi liées à la fragilité de la forme que décrit ce sac
plastique, qui lui donne alors une existence éphémère.
J’utilise ces matériaux – des sacs plastiques – car,
vides, ils décrivent des formes qui ne tiennent jamais
longtemps. La fragilité de ces sculptures présuppose
qu’elles auront une existence éphémère, tributaire de
l’espace et du temps. Cette subordination inscrit l’exis-
tence de ces sculptures dans une faille temporelle qui,
d’un point de vue métaphorique, est un vide temporel.
Contrairement à ce qui en a fait la raison d’être de la
sculpture, de Lao-Tseu à Michel-Ange, de Brancusi à
Henry Moore et Oteiza, le vide n’est pas uniquement
une réalité physique et spatiale qui permet à la sculp-
ture d’exister. Le vide et sa géométrie sont variables,
car il peut être éphémère, et donc, temporel.
Les sacs, en tant qu’objets, ne sont pas l’intégralité
de l’œuvre. Ils sont des objets du quotidien réappro-
priés afin d’impliquer le spectateur dans une expé-
rience qui restera en deçà et au-delà de l’œuvre d’art,
dans le champ du réel.
Par ce qu’il nomme “l’ordre des choses”, Michel
Foucault démontre comment la représentation des
choses ne dépend ni complètement de la culture,
ni totalement des règles scientifiques qui les défi-
nissent, mais également de l’espace entre ces deux
notions, qui est l’expérience. Cette expérience affecte
notre perception du monde plus que nous voudrions
le croire, et la manière dont il apparaît à nos yeux y
est subordonnée.
ARTISTE
64
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%