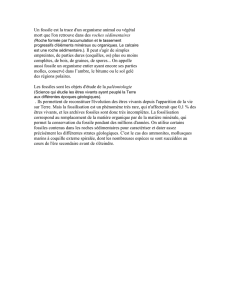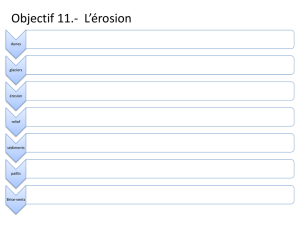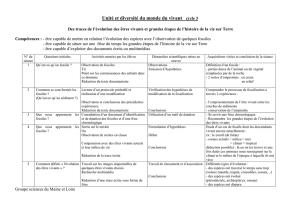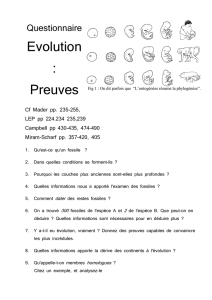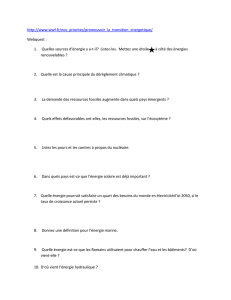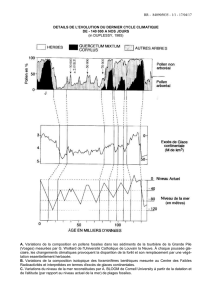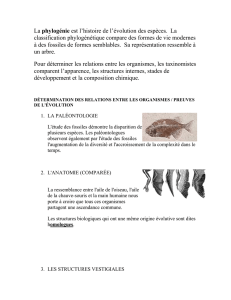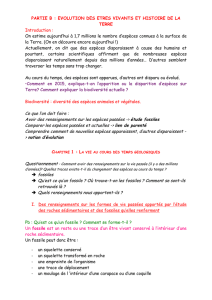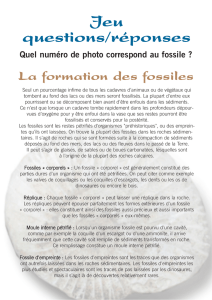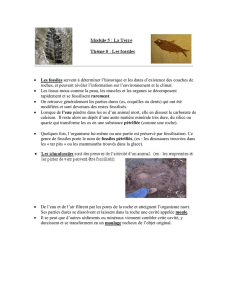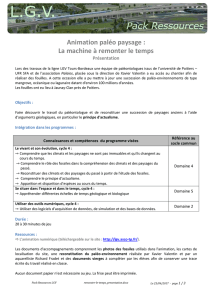Lire la suite sur le compte-rendu disponible en téléchargement

S
ociété des
S
ciences
N
aturelles
de la Charente-Maritime
28 rue Albert 1
er
– 17000 La Rochelle. Tél. : 05.46.31.87.17 [email protected]
Fondée en 1836 – Reconnue d’utilité publique depuis 1852 – Agréée au titre de l’environnement-département de la Charente-Maritime
www.societesciences17.org
Mercredi 3 juin 18h 1944° séance
Présidence de Pierre Miramand - 46 participants -
Conférence :
Les « fossiles vivants » : un mythe qui a la vie dure
animée par
Pierre Miramand
Université La Rochelle, Laboratoire LIENSs
Jusqu’au dix-huitième siècle, les fossiles étaient considérés, soit comme des jeux de la nature, soit comme des restes
du déluge, malgré que quelques érudits, dont Leonard de Vinci et Bernard Palissy, avaient, dès la renaissance, reconnu
la vrai nature des fossiles comme étant des restes d’animaux pétrifiés. Au début du dix-neuvième siècle Cuvier étudie
des dents fossiles remmenées de l’Ohio et de Sibérie qui étaient considérées par ses contemporains comme des dents
appartenant à des éléphants. Il leur applique sa méthode d’anatomie comparée et conclut que celles-ci
n’appartenaient pas à des éléphants, mais étaient les restes d’animaux aujourd’hui éteints. Cuvier va ainsi révéler à
ses contemporains l’existence de mondes disparus. Pour expliquer leurs extinctions, il va développer une théorie dite
théorie des catastrophes dans laquelle il explique que les faunes du passé ont disparu lors de grands cataclysmes et
ont été remplacées par de nouvelles faunes. Alcide d’Orbigny, disciple de Cuvier et comme lui fixiste, va appliquer
cette théorie aux invertébrés et va découper les strates géologiques en 28 étages qui correspondaient pour lui à autant
de créations. C’est la naissance de la bio stratigraphie. Dans ce contexte, un fossile pour A. d’Orbigny ne pouvait exister
que dans un seul étage, et il n’était pas concevable que des espèces traversent les grands cataclysmes qui ont frappé la
biosphère. Pourtant ce concept va apparemment être remis en cause par des découvertes faites à la fin du dix-
neuvième siècle, lorsque les scientifiques vont explorer les grands fonds marins. C’est d’abord en 1856, la découverte
par 300 m de fond d’exemplaires vivants de gastéropodes pleurotomaires que l’on croyait éteints depuis le miocène.
Puis, en 1872, ce fut la remontée de 4000 m de fond d’un crinoïde pédonculé lors de l’expédition britannique du
Challenger. Cette découverte stupéfia les scientifiques, car ces animaux n’étaient connus qu’à l’état fossile et on les
croyait éteints depuis le mésozoïque. Ces découvertes spectaculaires ont fait qualifier ces organismes de « fossiles
vivants », terme employé par Darwin, dans un autre sens, pour qualifier des espèces actuelles qui constituaient, pour
lui, des formes de transition entre des ordres actuellement profondément séparés. Ce terme va alors être utilisé pour
des espèces que l’on croyait éteintes depuis des millions d’années et retrouvées fortuitement.
La découverte en 1938 au large des Comores d’un cœlacanthe vivant, organisme qui n’était connu qu’à l’état fossile
depuis le dévonien et dont aucun exemplaire fossile n’avait été retrouvé depuis le crétacé, va rendre l’expression
« fossiles vivants » très populaire. Depuis, de nombreux « fossiles vivants » requalifiés d’espèces panchroniques, c'est-
à-dire présentant des ressemblances morphologiques avec des espèces éteintes ont été identifiées. Citons, parmi les
plus célèbres, les nautiles, les limules, les lingules, les scorpions, les méduses et les requins dont le plus ancien fossile
connu date du dévonien et semble avoir la même morphologie que les requins actuels. Ces espèces vont faire naitre
beaucoup d’interrogations, notamment au sujet de la théorie de l’évolution. Elles vont être utilisées soit par des
« fixistes » qui vont les prendre en exemple pour nier l’évolution des espèces, soit par des non darwiniens, comme, par
exemple Teilhard de Chardin qui développa la théorie du « Christ cosmique » ou Pierre Paul Grassé qui développa une
théorie néo lamarckienne de l’évolution.
Mais est-ce vrai que les espèces panchroniques n’évoluent plus ?

S
ociété des
de la C
harente
28 rue Albert 1
er
– 17000 La
Fondée en 1836 –
Reconnue d’utilité publique depuis 1852
Ce sont des espèces à évolution lente dont la morphologie externe a peu changé.
crétacé est vraisembl
ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la
fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «
vivants
». Par exemple les crinoïdes pédonc
leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de
remarquables qualités d’adaptation et d’évolution. D’ailleurs les crinoïdes p
disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment
un fossile de crinoïde pédonculé daté de l’éocène.
requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les
requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une
épine e
n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est
différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En
réalité les plus anciens re
quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des
héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de
requins feront leur apparition dans les océans.
Pour qualifier
les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon
qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent
actuellement dans les grands fonds, encore peu ex
grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la
pression évolutive sur ces espèces. Ce sont des espèces à évolution l
ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie
externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo
évolué au cours du temps comme pour les autres espèces. Le terme de
notre vocabulaire.
Communiqué du conférencier
Tous nos remerciements pour une présentation très appréciée des «
Le cas du cœlacanthe montre que c’est faux. On ne
connait aucun fossile de cœlacanthe du genre
actuel Latimeria
. Les derniers fossiles connus du
crétacé appartiennent au genre
Macropoma
sont anatomiquement différents des cœlacanthes
actuels, not
amment au niveau de leur taille et
surtout au niveau du squelette de leurs nageoires.
En réalité, les cœlacanthes n’ont pas cessé
d’évoluer depuis le dévonien en s’adaptant à
différents habitats. Ceci est montré par les 2
espèces actuelles qui ont des diff
génétiques significatives. Les cœlacanthes ne sont
pas des fossiles vivants, il n’y a de bons fossiles que
morts !
ociété des
S
ciences
N
aturelles
harente
-Maritime
Rochelle. Tél. : 05.46.31.87.17
Reconnue d’utilité publique depuis 1852
– Agréée au titre de l’environnement-
département de la Charente
www.societesciences17.org
Ce sont des espèces à évolution lente dont la morphologie externe a peu changé.
Le manque de fossiles depuis le
ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la
fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «
». Par exemple les crinoïdes pédonc
ulés actuels des grands fonds vivent sur les substrats meubles, alors que
leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de
remarquables qualités d’adaptation et d’évolution. D’ailleurs les crinoïdes p
édonculés n’avaient pas complétement
disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment
un fossile de crinoïde pédonculé daté de l’éocène.
La ressemblance morphologique des requins du dévo
requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les
requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une
n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est
différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En
quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des
héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de
requins feront leur apparition dans les océans.
les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon
qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent
actuellement dans les grands fonds, encore peu ex
plorés et qui sont des zones peu propices à la fossilisation. Les
grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la
pression évolutive sur ces espèces. Ce sont des espèces à évolution l
ente qui présentent une mosaïque de caractères
ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie
externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo
évolué au cours du temps comme pour les autres espèces. Le terme de
«
fossiles vivants
Tous nos remerciements pour une présentation très appréciée des «
mystères »de
l’évolution.
Le cas du cœlacanthe montre que c’est faux. On ne
connait aucun fossile de cœlacanthe du genre
. Les derniers fossiles connus du
Macropoma
. Ils
sont anatomiquement différents des cœlacanthes
amment au niveau de leur taille et
surtout au niveau du squelette de leurs nageoires.
En réalité, les cœlacanthes n’ont pas cessé
d’évoluer depuis le dévonien en s’adaptant à
différents habitats. Ceci est montré par les 2
espèces actuelles qui ont des diff
érences
génétiques significatives. Les cœlacanthes ne sont
pas des fossiles vivants, il n’y a de bons fossiles que
aturelles
département de la Charente
-Maritime
Le manque de fossiles depuis le
ablement dû à leur nouveau mode de vie dans des zones océaniques profondes peu propices à la
fossilisation. Les mêmes considérations peuvent être formulées pour tous les organismes qualifiés, à tort de «
fossiles
ulés actuels des grands fonds vivent sur les substrats meubles, alors que
leurs ancêtres mésozoïques vivaient fixés sur des substrats durs, ce qui dénote chez ces échinodermes de
édonculés n’avaient pas complétement
disparu depuis le crétacé, comme le pensaient les naturalistes du siècle passé. En effet, il a été découvert récemment
La ressemblance morphologique des requins du dévo
nien avec les
requins actuels n’est qu’un exemple de convergence évolutive dû à une adaptation au milieu océanique. En réalité, les
requins du dévonien sont très différents des requins actuels, leur bouche est terminale et non ventrale, ils ont une
n os alors que les requins actuels sont entièrement cartilagineux, l'articulation de leur nageoire pectorale est
différente, ils n’ont pas de denticules dermiques et ont une absence de calcification de leurs corps vertébraux. En
quins modernes datent du permien et ce n’est qu’au trias qu’apparait l’ordre des
héxanchiformes, encore présent dans nos mers et ce n’est qu’à l’éocène que la plupart des familles actuelles de
les espèces panchroniques, on emploie actuellement le terme de Taxons lazares qui désigne un taxon
qu’on croyait éteint et qui semble réapparaitre à un moment donné, la plupart du temps parce qu’ils vivent
plorés et qui sont des zones peu propices à la fossilisation. Les
grands fonds, sont, en outre, des zones où les conditions environnementales sont relativement stables, ce qui réduit la
ente qui présentent une mosaïque de caractères
ancestraux et de caractères dérivés. Leur apparente stabilité morphologique ne concerne que leur morphologie
externe qui ne représente que 5 % du génome. Leur anatomie interne, leur physiologie et leur patrimo
ine génétique a
fossiles vivants
» doit donc être banni de
l’évolution.
1
/
2
100%