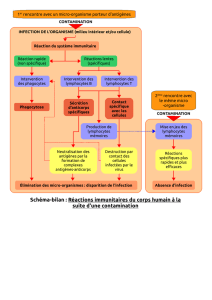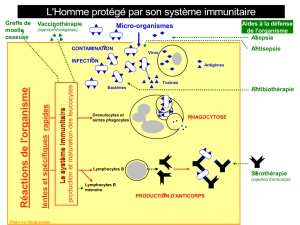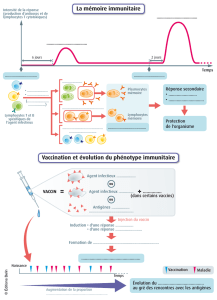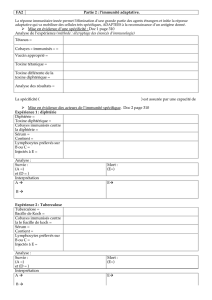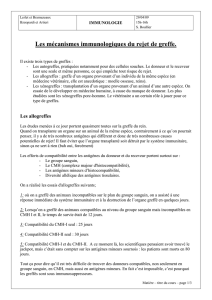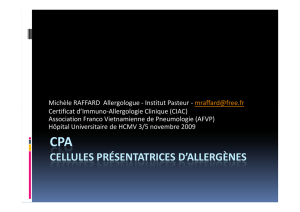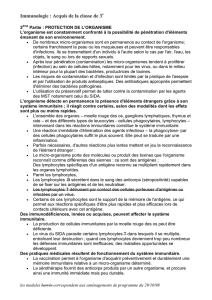MÉCANISMES DE LA RECONNAISSANCE ALLOGÉNIQUE

FLAMMARION
MÉDECINE
-
SCIENCES
—
ACTUALITÉS
NÉPHROLOGIQUES
2003
MÉCANISMES DE LA RECONNAISSANCE
ALLOGÉNIQUE
par
P.J. DUPONT P.-E. HERBERT et A.N. WARRENS*
En l’absence de toute immunosuppression, la transplantation d’un organe
d’un individu à un autre individu d’une même espèce, provoque une réponse
immune rapide et intense qui conduit au rejet de l’organe transplanté. La reconnais-
sance des antigènes étrangers (allo-antigènes) présents sur le greffon constitue la
phase initiale du rejet ou reconnaissance allogénique. Un des défis de l’immuno-
logie de transplantation consiste à mieux comprendre les mécanismes de cette
reconnaissance allogénique avec l’espoir de développer des stratégies d’inter-
vention spécifique pour limiter la toxicité des immunosuppresseurs actuellement
utilisés.
Reconnaissance allogénique
et complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
En 1901, Karl Landsteiner apporta une contribution importante à la biologie de
la transplantation avec la découverte des groupes érythrocytaires ABO [1]. Très
vite cependant, il s’avéra que la seule compatibilité ABO n’était pas suffisante
pour éviter le rejet de greffe. Les antigènes responsables du rejet, produits d’autres
gènes, furent dénommés les « antigènes de transplantation ». En fonction de
l’intensité de la réaction de rejet induite, ces antigènes furent qualifiés d’antigènes
d’histocompatibilité « mineurs » ou « majeurs ». En fait, la différence entre ces
antigènes est plus quantitative. Les produits des gènes du complexe majeur d’his-
tocompatibilité (CMH) jouent un rôle central dans la reconnaissance des antigènes
par les lymphocytes T.
Le complexe majeur d’histocompatibilité, ou système HLA chez l’homme
(
Human Leucocyte Antigens
) comporte un ensemble de gènes polymorphes, localisés
* Department of Immunology, Imperial College London, United Kingdom.

286
P
.
J
.
DUPONT
ET
COLL
.
sur le bras court du chromosome 6. Leur polymorphisme est tel qu’il est extrê-
mement rare que 2 individus non apparentés possèdent les mêmes formes allé-
liques de ces molécules HLA. L’incompatibilité HLA représente donc une barrière
significative pour le succès d’une transplantation.
Les molécules HLA sont divisées en 2 classes, de structure similaire mais non
identique, de distribution tissulaire et de fonction différentes. Les antigènes HLA
de classe I sont largement exprimés sur pratiquement toutes les cellules nucléées.
Ces molécules présentent des peptides antigéniques générés par le clivage protéo-
lytique de protéines intracellulaires. Les complexes HLA-I/peptide sont reconnus
par les lymphocytes T cytotoxiques CD8
+
qui sont responsables de la destruction
des cellules cibles qui expriment ces peptides antigéniques. Leur rôle principal est
probablement la présentation des épitopes viraux. Les molécules HLA de classe
II ont une expression plus restreinte, puisqu’elles ne sont retrouvées que sur les
cellules présentatrices de l’antigène (CPA) et les lymphocytes B. Elles présentent
aux lymphocytes T auxiliaires CD4
+
des peptides d’origine exogène internalisés
dans la cellule.
Antigènes mineurs d’histocompatibilité
Même si le rôle des antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité est
primordial, le rejet peut néanmoins survenir après une transplantation entre deux
individus CMH-identiques. Ceci est dû à la reconnaissance par les lymphocytes T
d’antigènes mineurs d’histocompatibilité. Les molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité constituent les éléments physiologiques de présentation de
peptides antigéniques aux lymphocytes T. Les antigènes mineurs, quant à eux, ne
provoquent une réponse que lorsqu’ils sont présentés en tant que peptides allo-
géniques associés aux molécules du complexe majeur d’histocompatibilité. Les
antigènes mineurs sont des protéines polymorphes à partir desquelles des peptides
alléliques peuvent être générés. Un exemple simple est l’antigène H-Y, présent
chez les individus mâles et absent chez les individus femelles. En général, les anti-
gènes mineurs d’histocompatibilité sont beaucoup moins polymorphes que les
antigènes majeurs et provoquent une réponse immune moindre. Dans la mesure
où la plupart des travaux concernant la reconnaissance allogénique se sont inté-
ressés aux différences dans le complexe majeur d’histocompatibilité, nous n’évo-
querons plus les antigènes mineurs.
Deux voies de reconnaissance allogénique :
la voie directe et la voie indirecte
Les lymphocytes T alloréactifs rencontrent les antigènes étrangers dans les gan-
glions et la rate. Les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité peuvent
être reconnues par les lymphocytes T grâce à 2 voies qui peuvent coexister : la
voie directe et la voie indirecte (fig. 1a, b). Ces voies sont définies par l’origine
des cellules présentant l’antigène, donneur ou receveur. En cas de reconnaissance
directe, les CPA du donneur présentent les complexes peptide + molécules du
complexe majeur d’histocompatibilité du donneur aux lymphocytes T alloréactifs
du receveur. En revanche, en cas de reconnaissance indirecte, ce sont les CPA du
receveur qui internalisent les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité

MÉCANISMES
DE
RECONNAISSANCE
ALLOGÉNIQUE
287
du donneur, les apprêtent et présentent des fragments peptidiques de ces molécules
aux lymphocytes T dans le contexte du complexe majeur d’histocompatibilité du
receveur.
La contribution relative de ces deux voies devient de plus en plus claire. Classi-
quement, la voie directe était prédominante dans le rejet aigu et l’initiation de la
réponse allogénique alors que la voie indirecte était celle du rejet chronique. Grâce
aux souris transgéniques et aux techniques d’invalidation des gènes, il a été pos-
sible d’étudier plus précisément le rôle respectif de ces 2 voies. Il est apparu
qu’elles peuvent coexister et être impliquées dans le rejet simultanément ou non.
Nous débuterons par la voie directe.
L
y
mphoc
y
te
T
c
y
totoxiqu
e
C
D
8
+
L
y
mphoc
y
te
T
c
y
totoxiqu
e
C
D
8
+
L
y
mphoc
y
te
T
au
xili
a
ir
e
C
D
4
+
L
y
mphoc
y
te
T
au
xili
a
ir
e
C
D
4
+
C
ellul
e
ALLO
G
É
NI
Q
U
E
Cellule
pr
é
se
nt
a
tri
ce
de l’antigène du donneur
é
se
nt
a
tri
ce
de
l
’
anti
g
è
n
e
du
r
ece
v
eur
Peptide T
CR
C
MH classe I
I
C
MH classe
I
Molécule CMH
C
MH du receveu
r
IL
-
2
Reconnaissance allogénique : voie directe
Reconnaissance allogénique : voie indirecte
FIG. 1. — (a) Reconnaissance allogénique directe : les cellules T du receveur reconnaissent les
complexes CMH allogénique-peptides présentés par les CPA du donneur. Les cellules T du
receveur pourraient aussi reconnaître la structure du CMH allogénique en l’absence de
peptide. (b) Reconnaissance allogénique indirecte : les antigènes du CMH provenant de
la destruction de cellules allogéniques sont internalisés puis apprêtés par les CPA du
receveur puis présentés aux cellules T en tant que peptides allogéniques associés aux
molécules du CMH du receveur.
fig. 1a
fig. 1b

288
P
.
J
.
DUPONT
ET
COLL
.
La voie de reconnaissance allogénique directe induit
une réponse immune intense
Les tissus incompatibles au complexe majeur d’histocompatibilité provoquent
des réponses immunes particulièrement intenses. S’il s’agit d’une transplantation
d’organe solide, elle se traduit par le rejet d’allogreffe, s’il s’agit d’une greffe de
moelle osseuse, elle se traduit par une réaction du greffon contre l’hôte. Cette
immunogénicité puissante est liée au fait que le répertoire normal des lympho-
cytes T contient un grand nombre de cellules capables de répondre aux molécules
CMH allogéniques. Deux hypothèses non mutuellement exclusives ont été propo-
sées pour expliquer ce phénomène (fig. 2).
Hypothèse de la haute densité de déterminants
(fig. 2a)
Cette hypothèse part du principe que les lymphocytes T alloréactifs reconnais-
sent principalement les déterminants étrangers de la structure du CMH allogénique
lui-même [2]. Les peptides peuvent ne jouer qu’un rôle accessoire. De ce fait,
chaque cellule présentatrice de l’antigène possède un grand nombre de ligands
potentiels à sa surface.
Physiologiquement, les antigènes étrangers sont internalisés par les CPA, apprê-
tés puis présentés en association avec les molécules de classe II du complexe
majeur d’histocompatibilité pour être reconnus par les lymphocytes T spécifiques
ayant une forte affinité pour leur ligand. Une faible proportion, peut-être 0,1 à
1p. 100, des molécules de classe II situées à la surface des CPA sont occupées par
le peptide spécifique. Seuls les lymphocytes T ayant une forte affinité pour leur
ligand seront activés.
Que se passe-t-il en situation allogénique ? Conformément à la première hypo-
thèse, chaque molécule du complexe majeur d’histocompatibilité étrangère pré-
sente à la surface de la cellule présentatrice de l’antigène est potentiellement
capable d’agir comme un ligand pour le récepteur du lymphocyte T alloréactif.
Il en résulte une augmentation considérable (de 100 à 1 000) du nombre de
ligands potentiels par cellule. Ainsi, les lymphocytes T ayant une affinité faible
ou intermédiaire pour leur ligand seront aussi activés. Il existe des arguments
pour penser que les lymphocytes T alloréactifs reconnaissent des régions poly-
morphes exposées à la surface des molécules du complexe majeur d’histo-
compatibilité. Ajitkumar et coll. [3] ont démontré que des mutations modifiant
les résidus de la région de contact avec le TCR entraînent une perte des facultés
de reconnaissance allogénique. De plus, les lymphocytes T peuvent reconnaître
différentes molécules de classe I partageant le même épitope anticorps [4].
Comme les sites de liaison anticorps sont situés à la surface des molécules du
complexe majeur d’histocompatibilité, ceci suggère une interaction directe entre
le TCR et la structure du CMH.
Parharm et coll. [5] ont montré que la reconnaissance allogénique pouvait être
inhibée par l’adjonction de peptides de synthèse correspondant à la portion
α
héli-
coïdale de la molécule allogénique du complexe majeur d’histocompatibilité.
Ces peptides bloquent probablement l’interaction TCR-CMH en occupant un site
de fixation sur le récepteur des lymphocytes T alloréactifs spécifiques d’une molé-
cule étrangère du complexe majeur d’histocompatibilité. Enfin, Elliott et Eisen
[6] ont montré que des molécules HLA-A2 « vides » séparées sur une colonne,

MÉCANISMES
DE
RECONNAISSANCE
ALLOGÉNIQUE
289
L
y
mphoc
y
te
T
L
y
mphoc
y
te
T
L
y
mphoc
y
te
T
Cellule présentatrice
de l’antigène
p
hoc
y
te
T
Lymp
L
Lym
a
ll
or
a
é
ac
ti
f
C
ellule p
r
é
sentatr
i
ce
d
e
l
’
ant
ig
è
ne
C
ellule
p
r
é
se
nt
a
tri
ce
de
l
’
a
nti
g
è
ne
H
y
pot
h
èse des multi
p
les com
p
lexes binaire
s
Hypothèse de la haute densité de déterminants
fig. 2a
fig. 2b
FIG. 2. — (a) Hypothèse de la haute densité de déterminants : les cellules T alloréactives
reconnaissent les composants exposés de la structure du CMH présents sur les cellules
présentatrices de l’antigène. Les cellules T spécifiques de l’antigène reconnaissent l’anti-
gène en association avec le CMH du soi. En comparaison avec les cellules T spécifiques
d’un antigène, les cellules T alloréactives disposent de plus de ligands potentiels par
cellule. Par conséquent, les cellules T alloréactives de faible affinité et d’affinité inter-
médiaire pour le ligand peuvent être stimulées et augmenter ainsi l’intensité de la réaction
allo-immune. (b) Hypothèse des multiples complexes binaires : le CMH allogénique peut
fixer un nombre de peptides différents de celui du CMH du soi ou bien les peptides du
soi mais dans une orientation différente. Par conséquent, de nombreux clones T différents
sont recrutés en réponse à un allo-antigène du CMH.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%