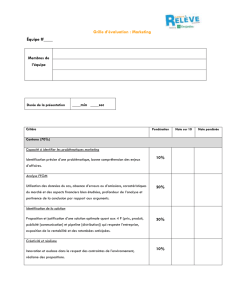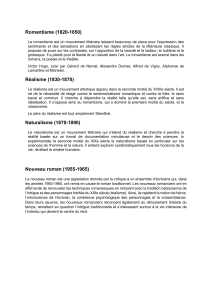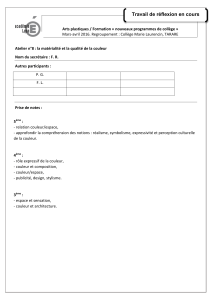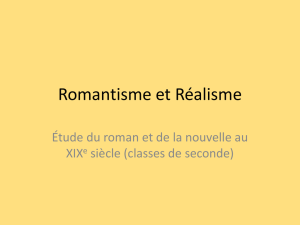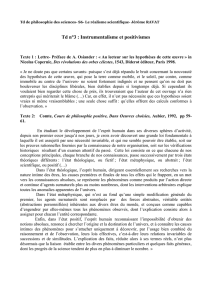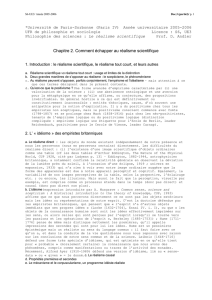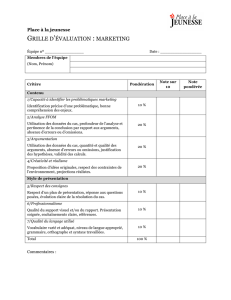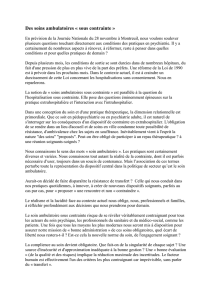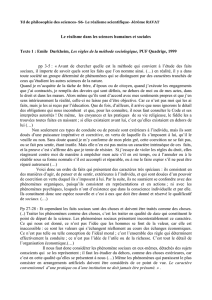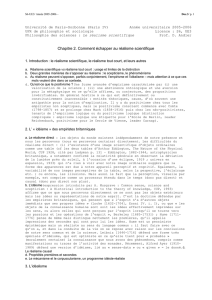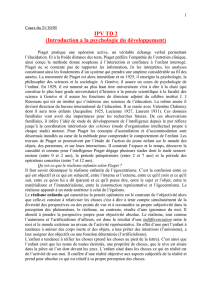Du réalisme naïf au pluréalisme

3
sous La direction de meLika oueLbani
Le réaLisme en perspective
université de tunis
FacuLté des sciences Humaines et sociaLes de tunis

5
DU REALISME NAÏF AU PLUREALISME
Denis Vernant
Université de Grenoble
La notion de « réalisme » s’avère polysémique et fort ambiguë1.
Il convient alors de la conceptualiser précisément. À cette fin,
nous proposerons d’examiner le réalisme naïf2 compris comme
attitude souvent admise, comme habitude de pensée. Après
en avoir opéré une critique dans ses dimensions ontologique,
gnoséologique et sémiologique, nous esquisserons une
définition de ce que nous qualifions de pluréalisme conçu
comme une manière rigoureuse de répondre à la question de
notre relation à ce qu’il est convenu d’appeler le « réel ».
1 déFinition du réaLisme naïF
Croyance commune, opinion courante, le réalisme naïf
plonge ses racines dans les thèses habituelles de la philosophie
traditionnelle. Par la simple perception, nous avons un accès
direct à la réalité que nous pouvons décrire et connaître. On
sait que selon Pascal « La coutume est une seconde nature »3.
1- Le terme est introduit dans le champ artistique en 1836 par Gustave Planche
pour s’opposer au néo-classicisme et à l’« art pour l’art » du romantisme en
peinture. Gourbet en fait le titre de son exposition de 1855. Le terme s’appliqua
ensuite à la littérature de Balzac à Zola. Après se succèderont le réalisme
socialiste, le surréalisme, le nouveau réalisme, etc.
2 - Il ne sera donc pas question du réalisme métaphysique des idées qui, dans
la querelle des universaux, opposa les Réaux aux Nominaux, puis inspira le
« platonisme » contemporain, notamment des mathématiciens.
3 - Lucide, Pascal justifie cette coutume ainsi : « Lorsqu’on ne sait pas la vérité
d’une chose, il est bon qu’il y ait une erreur commune qui fixe l’esprit des
hommes », Œuvres complètes, Pensée 744, p. 596. Goodman ne dit pas autre
chose : « Pour l’homme de la rue, les versions des sciences, de l’art et de la

6
Face à un tel tropisme intellectuel, l’urgence est d’en opérer
la critique.
1.1 Aspects ontologiques
La dimension première du réalisme naïf est celle ontologique
consistant à adopter un monisme radical selon lequel LE
monde est unique. Ainsi le premier Wittgenstein pose-t-
il au début du Tractatus que : « Le monde est la totalité des
faits », 1.14. Reste alors à définir et analyser les faits et leurs
relations. La réponse traditionnelle, d’Aristote à Leibniz,
consiste à adopter une ontologie substantialiste s’appuyant
sur le principe du parallélisme logico-grammatical. Le monde
s’analyse en substances/accidents et une telle analyse vaut
pour la grammaire, la logique et la métaphysique :
GRAMMAIRE Þ LOGIQUE Þ METAPHYSIQUE
Substantif Þ Sujet Þ Substance
Adjectif Þ Prédicat Þ Attribut
Parallélisme logico-grammatical
À cela s’ajoute un postulat absolutiste selon lequel LA réalité
existe en soi, indépendamment de la connaissance que nous
pouvons en avoir. Venons-en alors à cette connaissance que
nous avons du monde.
perception s’écartent de manières multiples du monde familier et commode
qu’il s’est construit de bric et de broc avec des morceaux de tradition
scientifique et artistique, et où il lutte pour sa propre survie », Manières de
faire des mondes, p. 30. Voir aussi p. 165.
4 - Cf, p. 33.

7
1.2 Aspects gnoséologiques
Le réalisme naïf considère que LE monde est toujours déjà
là et que les faits du monde sont donnés. On peut alors les
connaître directement par simple présentation au moyen de
leur perception qui nous fournit une certitude immédiate.
Dans les champs scientifiques, cette conception nourrit un
empirisme qui se contente des données de l’« expérience
première »5 ; dans le domaine artistique, l’illusion de l’« œil
innocent »6 et de la représentation réaliste par ressemblance,
etc.
1.3 Aspects sémiotiques
Dans son aspect sémiotique mettant en jeu le sens, le
réalisme naïf relève du paradigme représentationnel qui
s’appuie sur une sémantique de la dénotation et du reflet.
Une illustration flagrante en est la théorie de la proposition-
image du Tractatus : « L’image est ainsi attachée à la réalité ;
elle va jusqu’à atteindre la réalité », 2.1511. Lui est liée la
traditionnelle définition correspondantiste de la vérité qui
s’est imposée d’Aristote à Wittgenstein : « Pour reconnaître
si l’image est vraie ou fausse, nous devons la comparer avec la
réalité », 2.2223. La proposition dit le fait et montre sa forme.
La vérité résulte de l’isomorphie structurelle entre la forme de
la proposition et celle du fait.
2 critique du réaLisme naïF
Caractérisant nombre d’attitudes philosophiques, scienti-
5 - Voir la critique de Bachelard dans La Formation de l’esprit scientifique,
chap. 2 : « Le premier obstacle : l’expérience première ».
6 - Cf. Ernst Gombrich, Art et illusion, psychologie de la représentation
picturale.

8
fiques, artistiques, etc., le réalisme naïf doit faire l’objet d’une
critique argumentée interrogeant chacune de ses dimensions.
2.1 Aspects ontologiques
D’un point de vue ontologique, le monisme du réalisme naïf est
intenable en ce qu’il ne correspond aucunement à ce que l’on
peut constater. À travers le temps se déploie une multiplicité
de cultures, de ce que Cassirer appela des Weltanschauungen
(visions du monde). Et à une même époque pour une même
culture coexistent plus ou moins harmonieusement une
diversité des manières de concevoir notre rapport à nos
mondes : monde de la vie quotidienne (Lebenswelt), de
l’univers scientifique, de la création artistique, de la sphère
religieuse, etc.
À cela s’ajoute le fait que l’ontologie, naguère substantialiste,
devient clairement relationnelle. On sait que la logique
contemporaine tient son originalité et sa fécondité analytique
du calcul des relations inventé par Peirce, Frege et Russell ;
que la physique contemporaine, avec notamment le principe
d’incertitude d’Heisenberg et la dualité onde/corpuscule, ne
saurait se satisfaire d’un univers de substances clairement
individualisables et identifiables ; que la pragmatique évite
l’aporie cartésienne du solipsisme en se fondant sur un
primum relationis rendant compte de l’intersubjectivité et des
processus dialogiques de communication7, etc.
7 - On en trouve l’origine chez Martin Buber, Je et Tu, 1935. Pour un traitement
récent, cf. Francis Jacques, Dialogiques, Recherches logiques sur le dialogue,
1979. Plus généralement, cf. notre Introduction à la philosophie contemporaine
du langage, chap. 3, § 6, p. 128-138.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%