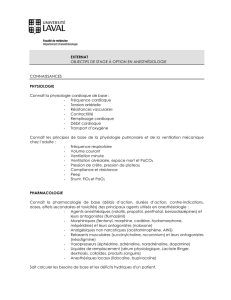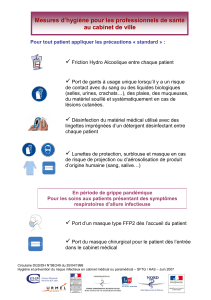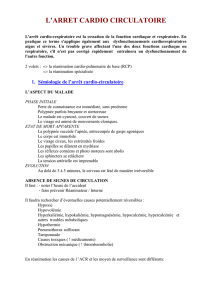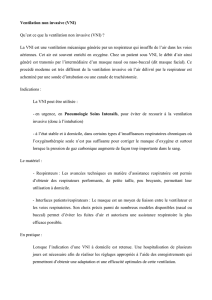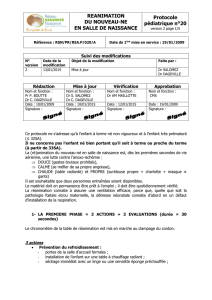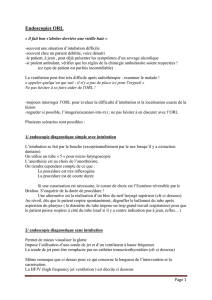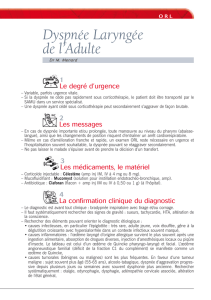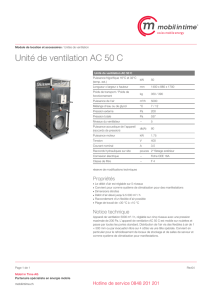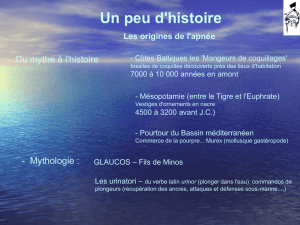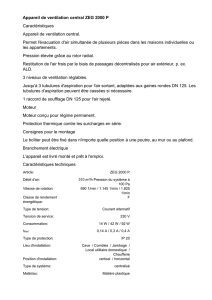Contrôle des voies aériennes

45
URGENCE PRATIQUE - 2008 No89
Harald GENZWÜRKER, Luc ANISET
Contrôle des voies aériennes
Techniques alternatives
L
’oxygénation du patient est un objectif essentiel dans la plupart des situations d’urgence. Cet objectif est atteint
grâce à différentes techniques (Tab.1). Le terme de « Airway Management » ne se limite pas à l’application de
certains outils, mais englobe tout ce qui concourt à assurer l’oxygénation du patient. Au-delà de l’oxygénation
immédiate, l’« Airway Management » prend en compte les techniques disponibles et applicables dans une
situation et avec une qualification du personnel données.
ROLE DES TECHNIQUES
ALTERNATIVES
Le problème majeur lors d’une ventilation au
masque réside dans le fait d’assurer une bonne
étanchéité du masque sur la face de la victime.
Dans une situation d’urgence l’opérateur est
souvent amené à exercer une pression d’insuf-
flation élevée afin d’assurer une ventilation suf-
fisante. Il s’ensuit une certaine pression sur le
sphincter œsophagien pouvant entraîner une
« ventilation » de l’estomac [Graphique 1]. Lors
d’un arrêt cardio-respiratoire, s’ajoute le fait
que la pression du sphincter œsophagien est
abaissée à une valeur d‘environ 5 cm H2O [2].
Même avec une technique de ventilation au
masque optimale, une ventilation partielle de
l’estomac est quasi programmée. Dans cette
situation particulière, mais aussi lorsqu’il est
difficile d’assurer une étanchéité correcte du
masque, des solutions alternatives doivent
être employées. L’intubation endo-trachéale
reste le « Gold Standard », mais elle prend un
certain temps à être réalisée [7], et fait encou-
rir le risque d’une intubation œsophagienne
non reconnue [10]. Les techniques standard, à
savoir la ventilation au masque et l’intubation
endotrachéale nécessitent un entraînement
conséquent. Pour des personnels, médecins
ou secouristes, non spécifiquement entraînés
on peut probablement préférer d’autres stra-
tégies plus faciles à apprendre
pour assurer la ventilation du
patient en situation d‘urgence [7].
L’oxygénation reste la priorité
absolue, par rapport au risque
d’une aspiration éventuelle [4].
OUTILS
SUPRA-GLOTTIQUES
Masque laryngé, combitube et
tube laryngé sont regroupés
comme outils supra-glottiques
dans les recomman-
dations actuelles de
l’European Resuscita-
tion Council [7] et dans
le protocole « Airway
management » de la so-
ciété allemande d’anes-
thésie et de réanima-
tion [3]. Ces outils ont
trouvé leur place dans
les algorithmes spéci-
fiques de l’oxygénation
et du contrôle des voies
aériennes en situation
d’urgence [Graphique
2]. Les alter natives
supra-glottiques par
rapport à la ventilation
au masque et à l’intuba-
tion sont déjà utilisées
dans de nombreuses
équipes SMUR [5]. L‘ex-
pression « supra-glotti-
que » résulte du point
de sortie de l‘air dans
l’outil, qui se trouve nor-
malement dans l’hypo-pharynx et en vis-à-vis
de la glotte.
Comparés à la ventilation au masque, les
dispositifs supra-glottiques permettent un
meilleur « colmatage » de la voie aérienne et
en conséquence sont à moindre risque d’une
ventilation de l’estomac. Comparés à l’intuba-
tion endotrachéale, leur mise en place peut
être réalisée plus vite et plus facilement même
en situation de laryngoscopie
difficile. Par contre, ils n’assurent
pas aussi bien le contrôle des
voies aériennes et la protection
contre une aspiration. Ces dis-
positifs nécessitent eux aussi un
entraînement minimal. Une for-
mation au mannequin et, dans
l’idéal, un entraînement planifié
au département d’anesthésie
sont la base d’une application
fructueuse dans une situation
d’urgence. Bien maîtrisés les
dispositifs supra-glottiques sont plus efficaces
qu’une ventilation au masque et présentent
une bonne alternative à l’intubation.
Les dispositifs supra-glottiques sont limités
dans leur application par une petite ouverture
de la bouche (la minima étant de 1,5 à 2,5 cm)
Classification des méthodes
d’oxygénation du patient en situation
d’urgence par degré croissant
d’invasivité des dispositifs
Oxygénation du patient en situation
d‘urgence
• Respiration spontanée
sans apport d’oxygène
avec apport d’oxygène
• Ventilation au masque
assistée
contrôlée
• Contrôle des voies aériennes
moyens supraglottiques
intubation endotrachéale
• Accès chirurgical aux voies aériennes
(ultima ratio)
Tableau 1.
Ventilation de l’estomac
Mobilité réduite des poumons
Diaphragme vers cranial
Compliance diminue
Graphique 1 : Problématique de la ventilation de l‘estomac: hypoventilation des poumons.
Redistribution volume tidal
poumons
á
estomac
Pression augmente
Harald GENZWÜRKER

URGENCE PRATIQUE - 2008 No89
46
ainsi que par des malformation du pharynx.
Le degré de protection contre l’aspiration des
divers dispositifs est très variable, allant d’une
protection non assurée avec le masque laryn-
gé standard jusqu‘à une protection de qualité
avec les dispositifs permettant de placer une
sonde gastrique.
Un avantage majeur des dispositifs supralot-
tiques par rapport à la ventilation au masque
est leur positionnement à l’entrée du larynx,
évitant, a priori, une ventilation involontaire de
l’estomac. La possibilité de mettre en place le
dispositif « à l’aveugle » permet d’éviter l’écueil
des intubations difficiles. La première ventila-
tion efficace peut, de fait, être assurée plus
rapidement.
MASQUE
LARYNGÉ
Destiné initialement
(1985) au contrôle des
voies aériennes pendant
l’anesthésie générale
pour des interventions
chirurgicales planifiées,
il a été également utilisé
ensuite dans le cadre
du contrôle des voies
aériennes en situation
d’urgence, au bloc
opératoire, puis en ex-
trahospitalier.
Le masque laryngé à
intubation (LMA-Fas-
trachTM) constitue une
variante du masque
laryngé original. Il est
disponible dans toutes
les tailles, à partir de la
taille « enfant ». La mise
en place du masque
laryngé assure rapide-
ment l’oxygénation du
patient, et son introduc-
tion est facilitée par une
tige anatomique [Gra-
phique 3]. Après que l’utlisateur se soit assuré
d’une ventilation adéquate, il peut réaliser une
intubation – à l’aveugle - à travers le masque
laryngé. Les taux de succès sont variables et
opérateurs dépendants. Aussi nous ne recom-
manderons le FastrachTM qu’aux opérateurs
aguerris. Une vérification du positionnement
du tube endotrachéal par l‘auscultation et la
capnométrie est indispensable.
COMBITUBE/EASYTUBE
Le Combitube a été introduit à peu près en
même temps que le masque laryngé. Son but
premier était le contrôle des voies aériennes
dans les situations d‘urgence. Dans son prin-
cipe il est constitué d’un tube endotrachéal
auquel a été adjoint un deuxième tube fermé
sur son extrémité distale et comportant des
ouvertures latérales au niveau du larynx
(Graphique. 4). Les concepteurs souhaitaient
pouvoir assurer une ventilation indépendam-
ment de la position de l’outil mis en place en
aveugle.
Un grand ballon proximal colmate le pharynx
et empêche tout reflux d’air vers la bouche et le
nez. Un petit ballon distal bloque le Combitube
au niveau de l’oesophage ou de la trachée. Il
est disponible en deux tailles pour adultes.
Le combitube est introduit en aveugle. La posi-
tion œsophageale est beaucoup plus probable
(>98%) que la position trachéale. Après gon-
flement des ballonnets, soit l‘air entre dans la
trachée par les ouvertures latérales, soit, dans
les cas très rares d’une position trachéale, il
utilise l’orifice distal.
Un autre outil comparable et plus récent est
l’Easytube qui apporte plusieurs améliorations
au Combitube. Il ne contient pas de caout-
chouc. Il est disponible en taille unique pour
adultes et en taille unique pour enfants d’une
taille supérieure à 90 cm. Le deuxième orifice
à côté de la partie du tube endotrachéal est
positionné au niveau de la glotte. Il est moins
traumatisant.
TUBE LARYNGÉ
Une des nouveautés les plus importantes
pour le contrôle des voies aériennes est le
tube laryngé, présenté pour la première fois en
1999. Développé avec la même finalité que le
masque laryngé, cet outil supraglottique s’est
vu rapidement proposé comme alternative à
l’intubation trachéale dans les situations d’ur-
gence. Cette utilisation est proposée en 2004
dans les algorithmes de gestion des voies aé-
riennes par la société allemande d’anesthésie
et de réanimation [3] ainsi qu’en 2005 dans les
recommandations de l’ERC [7].
Le tube laryngé simple LT est un tube à orifice
unique distal en silicone ou PVC. Son extrémité
est placée à l’entrée de l’œsophage. Un petit
ballon distal ferme l’entrée de l’œsophage,
tandis qu’un ballon plus grand ferme le pha-
Préoxygénation
Essai d’intubation
Réussite Echec
Sur toutes les niveaux de
l’algorithme :
• Oxygénation
• Position optimale
• Personnel supplémentaire
• Réévaluation de la stratégie
• Retour à la respiration spontanée
Ventilation au masque possible
Au maximum 2 nouveaux
essais d’intubation avec
technique modifiée
Outil supraglottique
(masque laryngé, combitube,
tube laryngé)
Réussite Echec Réussite Echec
Accès chirurgical
« ultima ratio »
Oui Non
Graphique 2 : Algorithme Airway management en situation d‘urgence.
Graphique 3 : Masque laryngé à intubation
(LMA-FastrachTM).
Graphique 4 : Combitube en position oesophageale.
Graphique 5 : LTS (tube laryngé avec canal d‘aspiration) en
position correcte.

47
URGENCE PRATIQUE - 2008 No89
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. - American Society of Anaesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway (2003) Practice guidelines for management
of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anaesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway.
Anesthesiology 98:1269-1277
2. - Bowman FP, Menegazzi JJ, Check BD, Duckett TM (1995) Lower esophageal sphincter pressure during prolonged cardiac arrest and
resuscitation. Ann Emerg Med 26:216-219
3. - Braun U, Goldmann K, Hempel V, Krier C (2004) Airway management - Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin. Anästh Intensivmed 45:302-306)
4. - Genzwürker H (2006) Airway management im Rettungsdienst. In: Ellinger K, Osswald PM, Genzwürker H (Hrsg) Kursbuch Notfallmedizin
- orientiert am bundeseinheitlichen Curriculum Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Deutscher Ärzteverlag, Köln, S 152-172
5. - Genzwürker H, Lessing P, Ellinger K, Viergutz T, Hinkelbein J (2007) Strukturqualität im Notarztdienst: Vergleich der Ausstattung arztbesetzter
Rettungsmittel in Baden-Württemberg in den Jahren 2001 und 2005. Anaesthesist 56:665-672
6. - Gerich TG, Schmidt U, Hubrich V, Lobenhoffer HP, Tscherne H (1998) Prehospital airway management in the acutely injured patient: the
role of surgical cricothyrotomy revisited. J Trauma 45:312-314
7. - Nolan JP, Deakin CD, Böttiger BW, Smith G (2005) European Resuscitation Council guidelines for resuscitation 2005. Section 4: Adult ad-
vanced life support. Resuscitation 67(S1):39-86
8. - Thierbach A, Lipp A (1999). Fiberoptische Intubation im Notfall. Notfall Rettungsmedizin 2;105-110
9. - Thöns M, Sefrin P (2007) Vorhaltung notfallmedizinischen Equipments für den Kindernotfall. Notarzt 23:117-122
10. - Timmermann A, Russo SG, Eich C, Roessler M, Braun U, Rosenblatt WH, Quintel M (2007) The out-of-hospital esophageal and endobron-
chial intubations performed by emergency physicians. Anesth Analg. 104:619-623.
rynx vers bouche et nez. La ventilation est
assurée par l’ouverture située entre les bal-
lons. Le tube laryngé est disponible en tailles
diverses pour toutes les classes d’âge. Le tube
laryngé ne contient pas de caoutchouc et est
atraumatique.
On note pour les besoins de la médecine d‘ur-
gence un développement du tube laryngé stan-
dard, à savoir le LTS (Laryngeal Tube Suction,
graphique 5). Il dispose d’un deuxième orifice,
permettant en position correcte la mise en
place d’une sonde gastrique.
TAILLES PÉDIATRIQUES
Seuls le masque laryngé et le tube laryngé sont
disponibles dans toutes les tailles nécessaires,
du nouveau-né jusqu’à l‘adulte. L’Easytube
n’est disponible en taille unique que pour les
enfants d’une taille supérieure à 90 cm, tan-
dis que le Combitube ne peut être appliqué
que chez l‘adulte. Ce manque de disponibilité
d’outils adaptés pose, d’ailleurs, un problème
SMUR allemands [5, 9].
CONIOTOMIE D‘URGENCE
Depuis le développement des dispositifs supra-
glottiques la coniotomie d’urgence a perdu de
son intérêt comme alternative unique à l’intu-
bation endotrachéale. Elle n’est plus indiquée
que lors de certains traumatismes graves, ou
lorsque les dispositifs cités ne peuvent être mis
en place. De fait, les urgentistes n’en ont que
peu la pratique (6). La qualité de la voie aérien-
ne établie par cette mesure est surestimée par
beaucoup de confrères. Un entraînement au
mannequin, chez l‘animal ou chez le cadavre
peut considérablement augmenter la sécurité
de l’utilisateur. Des sets simples de coniotomie
d‘urgence contribuent également à éviter des
complications majeures comme une hémorra-
gie ou une lésion trachéale par une application
agressive de cette procédure.
LA FIBRE OPTIQUE
Les fibres optiques flexibles sont le domaine
de l’intubation des patients conscients. Cette
technique ne joue pas de rôle dans le cadre de
la médecine d’urgence préhospitalière, hormis
quelques exceptions anecdotiques [8].
CONCLUSION
L‘utilisation des dispositifs supraglottiques
(masque laryngé, combitube, tube laryngé)
comme alternative à la ventilation au masque
et à l’intubation endotrachéale est aujourd’hui
considérée comme une option intéressante
dans le cadre du contrôle des voies aériennes.
Les standards de formation doivent compren-
dre l’apprentissage à leur usage. La coniotomie
d‘urgence est une mesure « ultima ratio », dont
l’application devra se limiter aux cas où des
stratégies moins invasives ont échoué.
n
Dr. med. Harald GENZWÜRKER
Dr. med. Luc ANISET
Département d’anesthésie et de réanimation chirurgicale
CHU Mannheim. Theodor-Kutzer-Ufer 1-3. D-68167 Mannheim
Courriel : harald.genzwuerker@anaes.ma.uni-heidelberg.de
1968
C
’était HIER
LA RÉGULATION MÉDICALE
DES APPELS
C’est en 1955 que furent
crées les premières équipes
mobiles de réanimation fran-
çaises. Leurs missions pre-
mière : assurer les secours
médicalisés aux accidentés
de la route ainsi que les
transferts inter hospitaliers pour
les malades atteints de paralysie
respiratoire. La réussite de ces
premières expériences conduisit
vers leur multiplication dans toute
la France dès 1965. Cette même
année parut un décret intermi-
nistériel créant officiellement le
Services Mobiles d’Urgence et de
Réanimation attachés aux hôpi-
taux (SMUR).
Sur cette lancée, les SAMU appa-
raissent en 1968 afin de coordon-
ner l’activité des SMUR. Ils sont
dotés d’un centre de régulation
médicale des appels (sur la photo
la salle de régulation « histori-
que » du SAMU de Montpellier).
Dès 1974 des médecins généra-
listes libéraux participent à cette
activité de régulation médicale
en complément des praticiens
hospitaliers concepteurs de ces
structures. Le 15, numéro gratuit
d’appel national pour les urgen-
ces médicales est créé en 1978
à la suite d’une décision intermi-
nistérielle. Ce numéro vient en
complément d’autres numéros
existants: le 17 pour la police, le
18 pour les pompiers.
L’assise réglementaire qui man-
quait est donnée aux SAMU par
la loi du 6 janvier 1986 (décrets du
16 décembre 1987) sur l’Aide Mé-
dicale Urgente et les Transports
Sanitaires.
n
1
/
3
100%