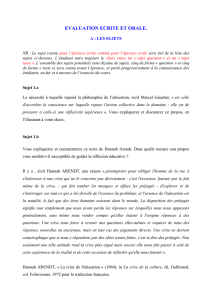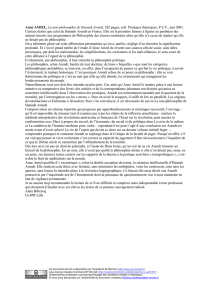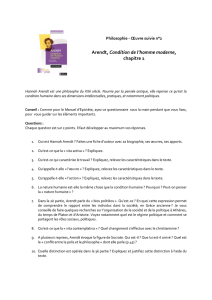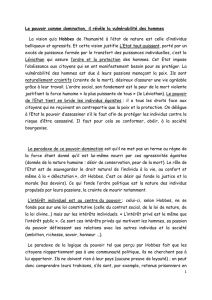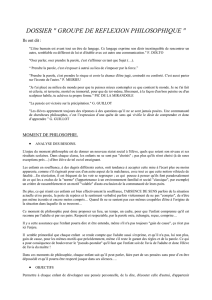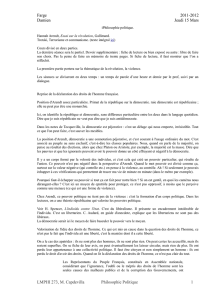Face à la philosophie politique de l`écologie, la violence comme

Face à la philosophie politique de l’écologie, la
violence comme seule issue
Floran Augagneur
Philosophe
philosophe. Il enseigne la philosophie des sciences et la philosophie politique de l’écologie à l’Insti-
tut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Ses recherches ont d’abord porté sur la philosophie
politique des gender studies. L’imaginaire des nouvelles technologies et la philosophie de la biolo-
gie sont ses principaux champs de recherche actuels. Il a cosigné avec Michel Rocard et Dominique
Bourg un article intitulé « Le genre humain, menacé » (Le Monde du 2 avril 2011).
1
Nous sommes au cœur d’une révolution sans précédent qui promet de bouleverser la continuité du
XXIe siècle, que l’on appelle d’ores et déjà le siècle de l’écologie. Le concept de développement
durable renvoie à deux préoccupations liées l’une à l’autre : celle des générations futures et celle de
la protection de l’environnement. Dans les deux cas le problème est mal posé.
2
Concernant les générations futures, je me sépare de Hans Jonas. Du point de vue de la philosophie
morale, assurer la survie de l’espèce à tout prix est indéfendable et même inapproprié comme objec-
tif en soi. En revanche, c’est un devoir moral d’éviter la souffrance et les inégalités qui résulteraient
d’un effondrement. Ce qu’il faut protéger, ce ne sont pas des êtres inexistants, ce sont nos valeurs
intemporelles de justice et de liberté qui seront les premières victimes des conflits écologiques que
nous préparons.
3
Je soutiens l’idée qu’on ne pourra pas non plus démêler le sens des événements qui se déroulent
sans cesser de penser en termes de protection de l’environnement. Dominée par la perspective prag-
matique d’un espace extérieur à protéger, l’utilisation de ces termes laisse entendre que la menace
viendrait d’un « dehors » envers lequel il faudrait maîtriser notre agressivité. Rien n’est plus faux.
Cette pensée dominante passe à côté de la transformation qui s’est opérée avec l’avènement de la
modernité. L’environnement n’existe plus, ou plutôt, désormais, l’environnement c’est nous. Nous
avons fait l’exact contraire du programme baconien : en voulant sortir de la nature, nous l’avons in-
tégrée dans le monde humain.
4
L’un des pères de la philosophie politique, Thomas Hobbes, est l’un des seuls à avoir fait jouer à la
violence un rôle constitutif majeur. Pour cet auteur, la violence, ou plus précisément la peur de la
violence, est à l’origine du pacte social. Il décrit ce qu’était la vie hors de la société :
5
« Les passions règnent, la guerre est éternelle, la pauvreté est insurmontable, la crainte ne nous
abandonne jamais, les horreurs de la solitude nous persécutent, la misère nous accable, la barba-
rie, l’ignorance et la brutalité nous ôtent toutes les douceurs de la vie. » [1]
6
La catastrophe, c’est le retour à ces souffrances et malheurs, à la décomposition et à l’abomination.
C’est ce que René Girard appelle le « rendez-vous planétaire de l’homme avec sa propre violence ».
Depuis que nous avons fait entrer la nature dans la société, le maintien des garde-fous, des verrous

qui nous évitent l’autodestruction, lui est intimement lié. C’est pour cette raison que la crise écolo-
gique est la principale menace qui pèse sur notre avenir commun et que la nature doit devenir un
sujet de réflexion de la philosophie politique en tant que telle.
7
Mon propos se résume donc en ceci : le péril vers lequel nous nous dirigeons n’est pas la fin de
l’humanité, mais l’avènement d’une humanité faite de violence et d’inégalités qui résulteront d’un
effondrement dû à l’idéologie profondément ancrée qui considère la nature comme une entité exté-
rieure. Cet effondrement adviendra, si nous n’avons pas recours à une métamorphose, sous l’effet
du processus de développement qui déséquilibrera notre système de régulation sociale. Pour en arri-
ver à cette conclusion, je vais m’appuyer sur les trois auteurs qui m’ont le plus influencé : Hannah
Arendt bien sûr, et deux esprits foisonnants, Jean-Pierre Dupuy et Vittorio Höslé.
8
La notion de développement durable a fait couler beaucoup d’encre. Mais la philosophie, contraire-
ment à l’économie ou l’histoire, est restée relativement en dehors du débat. Il y a une raison à cela.
Occultant la transformation de la science, la philosophie du siècle dernier, et particulièrement la
philosophie française, se sont condamnées à l’impuissance.
Le processus et la maîtrise
9
La nature est directement accessible aux sens des êtres qui la composent. Il ne pourrait en être autre-
ment, les sens, issus de millions d’années d’évolution et de sélection, reflètent pour chaque espèce
la meilleure façon de se mouvoir dans le milieu et de s’intégrer dans le monde. Nous avons mis fin
à cette relation historique entre l’être et la nature. Nous avons d’abord fait apparaître une nature qui
nous était jusqu’alors inaccessible, invisible.
10
La nature invisible est celle qui, depuis Copernic, Galilée, Newton et la révolution scientifique du
XVIIe siècle, est décryptée par la science. L’essor des sciences modernes est à l’origine de l’avène-
ment d’une époque nouvelle qu’elles ont provoquée en dévoilant que les expériences des sens
n’étaient que des illusions. Ce n’est plus l’observation mais les instruments de l’astrophysicien qui
donnent une place à la Terre dans l’univers, ou ce sont les outils de la physique quantique qui décri-
vent le comportement de la particule. L’homme pensait alors percer les secrets de la nature par la
science et la technique. Cette séparation entre l’être et l’apparence est au fondement de la science
moderne et du doute cartésien, elle a servi de socle au soupçon.
11
Mais la nature est aussi, désormais, construite, non plus comme un concept façonné à travers le
temps, mais physiquement par l’impact des hommes sur les systèmes régulateurs. La nature est arti-
ficielle. Si la nature artificielle est de notre cru, elle n’est pas de notre volonté. C’est le résultat im-
prévisible de nos actions. Depuis que la puissance humaine a atteint un certain seuil au siècle der-
nier, nous agissons dans la nature de la même manière que nous avons agi dans l’Histoire. Au-
jourd’hui, l’homme est devenu une telle force tellurique que de nombreux scientifiques, dont le prix
Nobel Paul Crutzen, proposent de nommer « anthropocène » l’époque dans laquelle nous sommes.
Mais il ne faut pas se méprendre, cette nature n’est en aucun cas le fruit de notre création dans le
sens entrepris par la biologie synthétique, elle est le résultat d’une chaîne d’événements que nous
avons engendrés en déclenchant des processus naturels inattendus qui nous échappent complète-
ment. Cette perte de la maîtrise et de la lisibilité faisait partie des caractéristiques qu’Hannah Arendt
attribuait à l’époque moderne :
12

« Si en déclenchant des processus naturels, nous avons commencé à agir dans la nature, nous
avons manifestement commencé à transporter l’imprévisibilité qui nous est propre dans le domaine
même que nous pensions régi par des lois inexorables. » [2]
13
Ce qui frappe dans ce constat, c’est que nous assistons bien à la fin de l’environnement. Les fron-
tières historiques entre les éléments naturels et l’artifice humain se sont effacées. Pour décrire ce
point, fondamental dans l’œuvre d’Arendt, elle a emprunté au génial mathématicien britannique Al-
fred North Whitehead, dont elle a été une lectrice attentive, le concept de processus (process) :
14
« La connexion [entre la nature et l’histoire] a son lieu dans le concept de processus : tous deux
impliquent que nous pensions et considérions tout en termes de processus et ne nous occupions plus
des étants singuliers ou des événements particuliers et de leurs causes spéciales et séparées. Les
mots clefs de l’historiographie moderne – « développement » et « progrès » – étaient, au XIXe
siècle, également les mots clefs des branches alors nouvelles de la science de la nature, particuliè-
rement de la biologie et de la géologie, l’une traitant de la vie animale et l’autre d’un objet non or-
ganique en termes de processus historiques. » [3]
15
Le « tout est dans tout et réciproquement » n’est en aucun cas un programme des science studies,
c’est la prise en compte de la situation qui résulte de la modernité. Ce bouleversement s’est traduit
par des allers-retours incessants de métaphores entre les sciences et la politique. Depuis leur émer-
gence, les sciences sociales pensent souffrir d’un déficit par rapport aux sciences dites exactes. Le
vocabulaire et les méthodes des sciences de la nature et des sciences formelles, la connaissance fine
et la maîtrise précise de leur objet, ont mis en évidence, par contraste, que les sciences de la société
et de l’homme relevaient plus de l’art que de la science. Pour renforcer leur scientificité, elles ont
traité l’homme comme un être de nature et l’évolution de la société comme un processus naturel.
Cette substitution est à l’origine de la conception organique de la matière politico-économique et de
l’utilisation du terme biologique de développement pour définir l’évolution des affaires strictement
humaines et sociales.
16
Ainsi, qu’elles soient naturelles, sociales ou politiques, les « sciences » ont remplacé le concept de
l’Être et de l’objet par le concept de processus et, alors que le propre de l’Être et de l’objet est de
dévoiler son existence, le processus est toujours enjoint à l’invisibilité et à l’insaisissable :
17
« La notion de processus ne désigne pas une quantité objective de l’histoire ou de la nature ; elle
est le résultat inévitable de l’action humaine. Le premier résultat du fait que l’homme agit dans
l’histoire est que l’histoire devient un processus, et l’argument le plus puissant pour l’action des
hommes dans la nature sous forme de recherche scientifique est qu’aujourd’hui, selon la formule de
Whitehead, “la nature est un processus”. » [4]
18
La première conclusion de ce constat est une cruelle condamnation de la fuite en avant dans le pro-
grès scientifique et technique. Les promoteurs de son accélération pour résoudre la crise écologique
ne voient pas que la prudence par la maîtrise, ou par la maîtrise de la maîtrise, est vaine. Le progrès
scientifique et technique mène à l’exact contraire de l’objectif recherché : alors que la modernité
devait aboutir à la maîtrise et la possession de la nature, elle a abouti au comble de la perte de con-
trôle en retirant toute capacité à l’homme de percevoir la réalité des processus qu’il a déclenchés. Il
est donc aisé de comprendre le désarroi de l’homme moderne. C’est même sa condition fondamen-
tale, l’homme moderne ne sait pas ce qu’il fait et ne sait pas où il va.

La science et la politique
19
La logique du développement durable est la parfaite antithèse de ce que Serge Moscovici, Ivan Il-
lich ou André Gorz ont appelé l’écologie politique dans la seconde moitié du siècle dernier. Ce cou-
rant politique est né bien avant la menace sur la survie de l’humanité. Lorsque l’écologie politique a
été théorisée, nous vivions encore, du moins c’est ce que nous pensions, dans un univers infini. Il
s’agissait d’une critique non marxiste – voire anti – de la société industrielle et du productivisme
aliénant. La philosophie de ces auteurs rejoignait la critique de la perte de sens d’une partie de la
philosophie allemande post-Auschwitz, notamment celle de l’école de Francfort. Ils n’avaient que
faire des controverses scientifiques, tel le dérèglement global du climat. Leur écologisme utopique
n’a jamais basculé dans un écologisme scientifique.
20
Le développement durable comme concept part d’un tout autre postulat. Il suggère que le processus
est au bord du précipice et qu’il faudrait d’urgence articuler le développement économique et la pré-
servation de l’environnement. On ne cherche pas à rompre avec une quelconque logique capitaliste :
on le sait, sa force historique est de renverser ses contradictions en sa faveur. En conséquence, les
impératifs écologiques relèveraient de la science et non de la politique. Les sciences seraient les
mieux placées et les plus légitimes pour parachever le processus de développement. La notion de
développement durable est scientiste par essence. Les politiques de développement durable s’ap-
puient sur les études scientifiques pour « déterminer les techniques et les seuils de pollution écolo-
giquement supportables, c’est-à-dire les conditions et les limites dans lesquelles le développement
de la technosphère industrielle peut être poursuivi » [5]. Pour adapter le développement aux néces-
sités de la « durabilité », l’ensemble de la vie et de la matière terrestre devra être calculé et quanti-
fié. Mais à mesure que la place de la science et de la technique s’étend, s’étendent aussi les nécessi-
tés d’une administration [6], du recours au pouvoir des experts et à leurs avis autorisés, et diminuent
tout autant l’autorité politique, la faculté de participation du citoyen et sa liberté.
21
Je conviens que cette opposition entre écologie politique et développement durable, qu’il me
semble tout de même opportun de rappeler, a perdu son sens en ce début de siècle. Elle est rendue
obsolète par le seuil que nous avons franchi : l’urgence à laquelle l’humanité est, pour la première
fois, confrontée. Ce seuil a opéré une transformation profonde. Nous sommes passés, en l’espace de
quelques années, d’une logique d’évolution et de progrès à une logique d’évitement (de la catas-
trophe) et de conservation (des acquis et des conditions de maintien de la vie). Car nous vivons bel
et bien une situation apocalyptique, dans le sens où le déchaînement de la violence humaine est
l’aboutissement de la situation actuelle si nous laissons le processus suivre son cours.
22
Il ne s’agit nullement d’irrationalité, de catastrophisme, de pessimisme, de technophobie ou d’antis-
cience. Bien au contraire, nous vivons une époque captivante où il est nécessaire de tout réinventer,
à commencer par la théorie politique. Le risque est que, pris dans une spirale aveuglante, nous lais-
sions filer le faible espace d’action dont nous disposons.
La cause du triomphe de l’économie
23
La question qui se pose au développement durable est celle de la compatibilité entre les contraintes
écologiques et le développement économique, entre écologie et économie. En principe, il n’y a pas
de raison de partir de l’hypothèse qu’écologie et économie ne le soient pas. Les deux termes sont

issus du grec ancien oïkos signifiant maison, mais avec une nuance sensible. Historiquement, l’éco-
nomie évoque le « sage et légitime gouvernement de la maison, pour le bien commun de toute la
famille » (Rousseau). L’oïkosde l’économie renvoie à l’habitat, au foyer, au domestique, alors que
celui de l’écologie renvoie au milieu, à l’ensemble, au biotope.
24
Économie et écologie entretiennent un rapport de hiérarchie enchevêtrée. La première se construit
au sein de la seconde, du particulier au général. Économie et écologie sont, comme des matrioch-
kas, des sphères qui se superposent. Lorsque la sphère inférieure (l’économie) sort du foyer, mono-
polise l’espace public et dépasse la sphère qui la contient (l’écologie), s’ensuit inévitablement une
rupture catastrophique.
25
On sait qu’en Grèce antique, polis, la cité, s’opposait à oïkos. Il s’agissait de la division entre le do-
maine public (la politique, l’art du gouvernement) et le domaine privé (l’économie, l’administration
du foyer). Le domaine public ne connaissait que des égaux, c’était l’espace de liberté. Le domaine
privé contenait la sphère des inégalités, il était placé sous la responsabilité du chef de famille, le
maître antique. Mais « dans nos conceptions, écrit Arendt, la frontière s’efface parce que nous ima-
ginons les peuples, les collectivités politiques comme des familles dont les affaires quotidiennes re-
lèvent de la sollicitude d’une gigantesque administration ménagère » [7]. Au commencement de
l’époque moderne, l’économie, qui aurait dû rester dans le foyer domestique, en sort et s’empare de
l’espace public. La sphère privée s’élève, les limites domestiques éclatent et, à la suite de l’empire
romain, c’est l’Église qui a maintenu l’unité. L’ascension moyenâgeuse du séculier au religieux est
transposable à celle, antique, du privé au public. Mais la sphère séculière féodale a absorbé toutes
les activités humaines du domaine public dans le « privé », et le processus a continué jusqu’à son
assimilation complète et au triomphe de l’économie. C’est ici que commence ce qu’aujourd’hui
nous appelons l’économiscisme.
26
Pour Arendt, le politique connaît le même dévoiement avec la compassion, cette identification du
riche au pauvre, cette passion de le sauver qui conduit à parler en son nom, au nom de tous et non à
tous, et qui mène au système totalitaire à partir de Robespierre. Il est à noter que le totalitarisme est
bien une pathologie de la modernité car sans les principes de la science appliqués à la politique (la
convertibilité du vrai et du faire selon Vico), ce régime est inconcevable.
27
L’histoire est le passage du laïc au religieux, puis au rationnel. La modernité a divisé la rationalité
entre sa branche instrumentale et sa branche axiologique, les moyens et les valeurs. Cette séparation
était indispensable pour permettre à la science de « dire » la vérité. Le désenchantement du monde
est un mouvement de désacralisation, de « démagification » et un processus d’autonomisation de la
rationalité instrumentale. C’est le passage du monde enchanté des mythes et des Dieux au monde
mécanique puis cybernétique des machines. Mais c’est parce que le monde se désenchante que le
vice de l’égoïsme individuel se libère et permet le déploiement de l’économie ; ce n’est pas la ratio-
nalisation du monde qui le désenchante.
28
Aujourd’hui, la gauche et la droite considèrent toutes deux l’économie comme la solution. Mais la
gauche dénonce traditionnellement la violence de l’économie, la droite insiste sur ses bienfaits. En-
gels décrit dans l’Anti-Dühring les liens inséparables entre l’économie, qui opprime et exploite, et
l’esclavage. À l’opposé, pour Montesquieu, « l’effet naturel du commerce est de porter à la paix ».
En réalité, ces deux traditions qui ont constitué deux pôles distincts, ne s’opposent pas, elles se
complètent.
29
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%