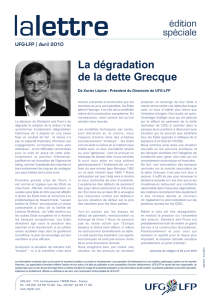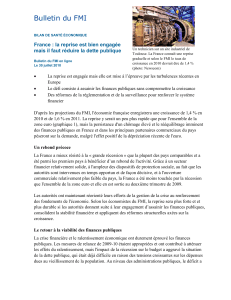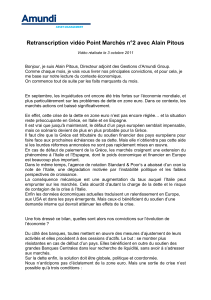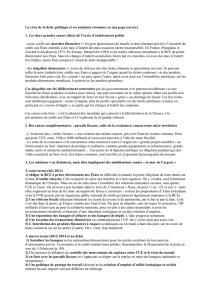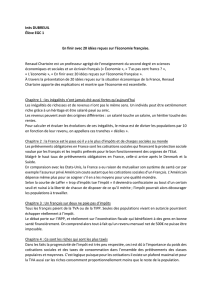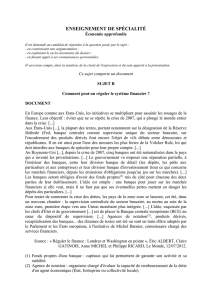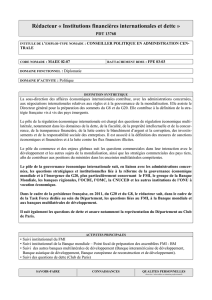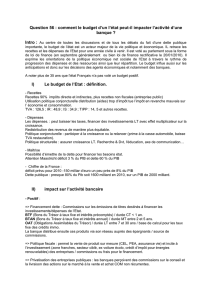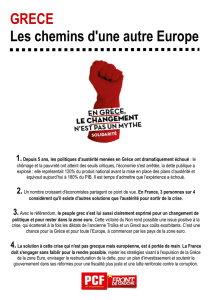Conférences C.VAUTHIER gouvernance économique mondiale

[Texte]
Cycle de conférences de l’ESC La Rochelle
2011/2012 102 rue de Coureilles 17024 La Rochelle Cedex 01
Tél 05 46 51 77 00 www.esc-larochelle.fr
1
Cycle de conférences Prépa
Une gouvernance économique mondiale est-elle
pertinente, voire nécessaire ?
Christian VAUTHIER
Diplômé de Reims Management School,
Maîtrise de sciences économiques Université Paris Panthéon
,. Professeur de Chaire Supérieure en Economie-Management
Professeur de classe préparatoire au lycée Chevrollier (Angers) de 1977 à 2008,
Suivant les principes d’Adam Smith et Ricardo, le système économique mis en place au
19
ème
siècle n’a laissé qu’une place limitée aux Etats sur le plan national, et seuls des accords
bilatéraux ont été réalisés sur le plan des échanges internationaux. Ceux-ci s’appuyaient sur le
système de l’étalon-or, système qui s’est installé de façon « naturelle », comme l’avaient enseigné
les « pères de l’économie ».
La création de l’URSS, à la suite de la Révolution de 1917, mettant en place un système
concurrent du capitalisme, les crises économiques et notamment la Grande Crise de 1929, vont
persuader les dirigeants occidentaux de la nécessité de poser les bases d’une entente internationale,
et ce dès avant la fin de la seconde Guerre Mondiale.
C’est ainsi qu’en 1944 sera créé le FMI (Fonds Monétaire International), avec la Banque
Mondiale. La Charte de la Havane de 1947 donnera naissance au GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade), ayant pour rôle de faciliter les échanges commerciaux internationaux, tandis
que l’application du plan Marshall obligera les pays européens à mettre en place l’OECE
(Organisation Européenne de Coopération Economique), afin de bénéficier de l’aide américaine.
On notera que, sur le plan politique, l’ONU (Organisation des Nations Unies) verra le jour
en 1945, en remplacement de la SDN (Société des Nations) qui, mise en place à la fin de la Grande
Guerre, fut incapable d’empêcher le second grand conflit mondial.
Quelle part ces institutions économiques ont-elles prise dans la fabuleuse croissance
économique des 30 Glorieuses ? Nul ne peut le dire exactement, mais l’on peut néanmoins affirmer
qu’elles ont contribué au développement économique des pays occidentaux pendant cette période.

[Texte]
Cycle de conférences de l’ESC La Rochelle
2011/2012 102 rue de Coureilles 17024 La Rochelle Cedex 01
Tél 05 46 51 77 00 www.esc-larochelle.fr
2
Le retour de l’inflation, la crise pétrolière, l’émergence de nouveaux pays, vont peu à peu
bouleverser l’ensemble des économies, qui vont entrer à partir des années 1970 dans ce que les
économistes appellent un « environnement instable et incertain ».
Le système monétaire international mis en place en 1944 éclatera en 1976, donnant ainsi un
rôle nouveau au FMI ; le GATT montrera ses limites et laissera la place à une nouvelle
organisation en 1992, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce).
La chute du Mur de Berlin (1992) et la disparition de l’URSS, entraînent la quasi-
disparition du système collectiviste. Le phénomène de mondialisation se poursuit, avec la
globalisation des systèmes économiques et financiers. Mais les crises économiques et financières à
répétition, démontrent l’insuffisance des institutions économiques internationales à régler les
problèmes (et encore moins à les anticiper).
Des tentatives de règlement vont se développer en réunissant directement les chefs d’Etat
ou de gouvernement, (du G6 au G20), tandis que la question des dettes souveraines au sein de
l’Europe oblige ses dirigeants à mettre en place de nouvelles réponses aux défis actuels.
Peut-on conclure à l’esquisse d’une véritable gouvernance mondiale ?
Nous examinerons tout d’abord les institutions internationales mises en place jusqu’à la fin
du siècle dernier (1). Puis, en analysant successivement les crises mondiale et européenne (2), nous
verrons les réponses données afin de déterminer si l’on peut sérieusement envisager la mise en
place d’une telle gouvernance.
1. Les institutions économiques internationales mises en place
au 20ème siècle
1.1. Le FMI et la Banque Mondiale
1.1.1 La création du FMI
La conférence de Bretton-Woods (juillet 1944) met en place le système de l’étalon de
change-or. Le nouveau SMI, en permettant aux pays de gager leur monnaie sur l’or, ou sur une
autre monnaie (par exemple le dollar…) va créer les liquidités nécessaires au développement du
commerce international, ce que ne permettait pas le seul étalon-or.
Pour que le système fonctionne, on décide que les parités entre les monnaies doivent être
stables (à l’intérieur d’une marge de fluctuation de + ou -1%). Et c’est le rôle du FMI de veiller au
respect de ces parités, en aidant les pays dont la monnaie se dévaloriserait sur les marchés des
changes, et en évitant autant que possible les changements de parités (dévaluations ou
réévaluations).
Les différentiels de croissance économique nécessiteront des réajustements de parités, la
dévaluation pouvant donner l’illusion d’un coup de fouet et permettant de relancer la machine
économique, (à condition toutefois de mettre en place les ajustements structurels nécessaires).
Le dollar prenant la place de monnaie de référence, le besoin de liquidités mondiales va être
comblé par les billets verts, provenant du déficit de la balance des paiements américaine (du aux
investissements des FMN américaines, aux dépenses militaires hors territoire US, et aux aides
diverses apportées par les USA aux pays du Tiers-Monde, notamment en Amérique Latine). Ces
dollars, bien que convertibles, vont être conservés par les détenteurs étrangers (les Banques
Centrales) : dollar « as good as gold ». Vont alors se développer les « mondo-dollars », mettant
ainsi en danger la convertibilité du dollar. Face à quelques demandes de mise en place d’un
nouveau SMI, basé sur une autre monnaie que le dollar, il n’y aura aucune réaction du FMI. Celui-
ci fonctionnant comme une société anonyme, les voix sont attribuées en fonction des apports de
chaque pays, et ceux-ci étant proportionnels aux PIB, les USA détiennent une large majorité

[Texte]
Cycle de conférences de l’ESC La Rochelle
2011/2012 102 rue de Coureilles 17024 La Rochelle Cedex 01
Tél 05 46 51 77 00 www.esc-larochelle.fr
3
relative, et ne vont pas sacrifier un système qui leur convient si bien ! (à noter que les USA
disposent encore aujourd’hui d’un véritable droit de veto).
Il faudra attendre 1969 pour la mise en place des DTS (Droits de Tirage Spéciaux), monnaie
basée sur un ensemble de monnaies, mais leur usage restera extrêmement limité, et ne remettra pas
en cause la suprématie du dollar.
Août 1971 : le président Nixon ne peut que reconnaître l’inconvertibilité du dollar,
reconnaissance qui sera suivie d’un remaniement général des parités en décembre, dans le cadre du
FMI. Après une dévaluation du dollar en février 1973, celui-ci « flottera » en mars, entraînant le
flottement général des monnaies, et l’abandon du système de parités fixes, entériné par les accords
de la Jamaïque de 1976.
1.1.2 Le nouveau rôle du FMI après 1976
N’ayant plus à faire respecter les parités désormais disparues, il permettra cependant la
réunion des ministres des finances occidentales pour limiter le flottement du dollar à la hausse
(Accords du Plazza de 1985) ou à la baisse (Accordes du Louvre de 1987). En effet, de trop
grandes variations monétaires ne sont pas propices au développement des échanges.
Mais l’essentiel de son rôle va désormais être tourné vers les pays du Tiers-Monde, dont
plusieurs pays, aux prises avec le grossissement de leur dette, vont menacer de se mettre en faillite,
et de faire ainsi exploser tout le système financier international.
Le rôle du FMI est ainsi exposé sur son site web:
« Le champ d’action du FMI : l’objectif premier du FMI est de veiller à la stabilité du
système monétaire international, en d’autres termes, le système international de paiements et de
change qui permet aux pays (et à leurs citoyens) d’échanger des biens et des services. Ceci est
essentiel pour promouvoir une croissance économique durable, accroître les niveaux de vie et faire
reculer la pauvreté. À la suite de la crise, le FMI a entrepris de clarifier et de rénover son mandat
pour l’étendre à l’ensemble des politiques macroéconomiques et financières ayant une incidence
sur la stabilité mondiale.
La surveillance des économies : afin de maintenir la stabilité et de prévenir les crises du
système monétaire international, le FMI procède à des revues de l’évolution économique et
financière à l’échelle nationale, régionale et mondiale, dans le cadre formel de sa mission de
surveillance. Le FMI prodigue des conseils à ses 187 États membres, les encourage à prendre des
mesures visant à assurer leur stabilité économique, à réduire leur vulnérabilité aux crises
économiques et financières, et à accroître les niveaux de vie. Le FMI présente à intervalles
réguliers, une évaluation des perspectives économiques dans les Perspectives de l’économie
mondiale, un état des lieux des marchés financiers dans le Rapport sur la stabilité financière dans le
monde et publie une série sur les perspectives économiques régionales.
L’assistance financière : les financements du FMI donnent aux États membres l’appui qui
leur est nécessaire pour remédier à leurs problèmes de balance des paiements. Un programme
économique appuyé par le FMI est élaboré par les autorités nationales en étroite coopération avec
les services du FMI, et les concours financiers restent subordonnés à la réalisation effective du
programme. Pour épauler les pays face à la crise économique mondiale, le FMI a renforcé sa
capacité de prêt et a décidé une refonte complète des modalités d’octroi de ses financements. Il
fournit une assistance financière aux pays à faible revenu par ses guichets de financement
concessionnel. Le FMI a doublé les limites d’accès à ses financements et accroît ses prêts aux pays
les plus pauvres du monde, à des taux d’intérêt nuls jusqu’en 2012. »
« Prêteur en dernier ressort », le FMI accorde des liquidités aux pays en difficulté, leur
permettant ainsi d’avoir recours aux banques commerciales, mais en subordonnant son aide à des

[Texte]
Cycle de conférences de l’ESC La Rochelle
2011/2012 102 rue de Coureilles 17024 La Rochelle Cedex 01
Tél 05 46 51 77 00 www.esc-larochelle.fr
4
« ajustements structurels » drastiques : moins de subventions, moins d’aides aux défavorisés,
augmentation des impôts, le tout devant permettre un rééquilibrage du budget, ainsi que de la
balance commerciale, et de celle des paiements.
Là où il intervient, le FMI, avec l’aide d’autres organisations internationales octroyant des
prêts (comme la Banque mondiale), négocie donc des plans dits d’ajustement structurel. Ils
consistent généralement à améliorer les conditions de production et d’offre via la promotion des
mécanismes du marché. Parmi les mesures concrètes souvent exigées on trouve, l’ouverture du
pays aux capitaux étrangers et au commerce international, la libéralisation du marché du travail et
la réduction du poids de l’État, c’est-à-dire la privatisation de nombreuses entreprises.
L’économiste américain John Williamson a regroupé l’ensemble de ces idées sous le terme de
« consensus de Washington », en soulignant qu’elles sont partagées par la plupart des grandes
organisations internationales (Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation
mondiale du commerce…) dont la plupart ont leur siège à Washington.
Appliquant ainsi les méthodes des monétaristes (Friedman), les « Chicago boys » vont se
faire une réputation calamiteuse auprès de nombreuses populations du Tiers-Monde, qui les
accueilleront souvent à coups de cailloux…
1.1.3 Et aujourd’hui ?
Depuis 1976, le rôle du FMI consiste en premier lieu à soutenir les pays connaissant des
difficultés financières. Lorsqu’un pays est confronté à une crise financière, le FMI lui octroie des
prêts afin de garantir sa solvabilité et d’empêcher l’éclatement d’une crise financière semblable à
celle qui frappa les États-Unis en 1929.
Le FMI est en ce sens, le responsable de dernier ressort de la liquidité du système financier
international, pour éviter le blocage des échanges et la contagion à tout le système (risque
systémique) de problèmes momentanés de solvabilité d'un pays ou d'une banque centrale donnés.
Joseph Stiglitz, « prix Nobel d’économie » en 2001 a souvent critiqué la politique du FMI,
notamment dans son ouvrage paru en 2002, « La grande Désillusion ». Il met en cause les
politiques d’ajustement trop drastiques, qui pénalisent surtout les populations pauvres des pays
aidés. En 1998, le président de la Banque Mondiale, James Wolfensohn, déclarait « qu'il
souhaiterait que les programmes de sauvetage financier attachent plus d'importance aux
préoccupations sociales (comme le chômage) et que le FMI insistait trop en revanche sur la
stabilisation des monnaies ».
Avec la crise actuelle, il est clairement mis en lumière que c’est le système financier dans
son ensemble qui en a été le responsable : mise en place des subprimes, émission de titres
« pourris » pour se débarrasser des défauts de paiement, spéculation à outrance, multiplication des
produits financiers…
Le FMI vient en aide aux pays mis en difficulté à l’occasion de cette crise financière : c’est
ainsi qu’il a sauvé l’Islande de la faillite, en lui prêtant deux milliards de dollars à l’automne 2008.
Avec des ressources triplées fin 2008, le FMI dispose désormais de plus de mille milliards de
dollars. Il a pu proposer son aide à la Grèce en 2010. Ce qui permettait à Dominique Strauss-Kahn
d’affirmer fin 2009 : « le FMI a contribué à sauver le monde de la plus grande crise qu’il ait jamais
connue ».
Mais il n’a pas pour rôle de remettre de l’ordre dans le système bancaire…
Mais surtout, le FMI semble bien impuissant dans ce que l’on appelle aujourd’hui « la
guerre des monnaies » :

[Texte]
Cycle de conférences de l’ESC La Rochelle
2011/2012 102 rue de Coureilles 17024 La Rochelle Cedex 01
Tél 05 46 51 77 00 www.esc-larochelle.fr
5
* le yuan chinois est manifestement sous-évalué, ce qui facilite l’exportation des produits
chinois vers le monde entier, en attendant que le marché intérieur chinois puisse prendre la relève
des exportations en tant que moteur de croissance
* le dollar américain est en baisse (taux d’intérêt quasi nuls, utilisation de la « planche à
billets »), ce qui permet de compenser l’atonie de la consommation intérieure
* l’euro est à un niveau très élevé, ce qui peut attirer les capitaux étrangers, mais qui à court
terme est une entrave aux exportations des produits européens
1.1.4 La Banque Mondiale
L'élargissement du champ d'action du FMI l’a conduit à interférer avec les compétences de
la Banque mondiale et pose la question de la concurrence (et/ou complémentarité) entre les deux
organisations.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la création des deux institutions financières
internationales, FMI (Fonds monétaire international) et Banque mondiale
,
est née d'une double
préoccupation : ne pas voir se répéter les crises monétaires des années 30 et la chute des échanges
mondiaux qui en a découlé, rôle dévolu au FMI, et reconstruire l'Europe, pour la Banque mondiale.
Le système adopté lors de la conférence financière et monétaire tenue à Bretton Woods est alors
conçu de manière complémentaire : veiller à l'équilibre des balances de paiement et fournir des
crédits à court terme revient au FMI, financer la reconstruction et le développement par des prêts à
long terme à la Banque mondiale. Les ressources du FMI sont essentiellement constituées par la
mise en commun des devises des États membres alors que la Banque Mondiale recourt à des
emprunts.
Un pays doit obligatoirement être membre du FMI pour adhérer à la Banque mondiale. En 1988, un
accord entre le Fonds et la Banque a été conclu, conditionnant strictement les prêts de la Banque à
un accord entre le pays emprunteur et le Fonds.
Le partage des tâches entre les deux organisations intergouvernementales sera toutefois toujours
soumis à certaines incertitudes.
Enfin, le partage des pouvoirs est dévolu aux Etats-Unis et à l'Europe : traditionnellement, le
directeur général du FMI est un Européen, et le président de la Banque mondiale, un Américain.
Situation que les pays du Sud, se considérant comme concernés au premier chef, commencent à
contester.
1.2 L’organisation des échanges commerciaux internationaux
Adam Smith avait montré dans son principal ouvrage (Causes de la richesse des nations –
1776) comment la division du travail pouvait favoriser ce que l’on appellerait aujourd’hui la
productivité et la croissance économique. David Ricardo, puis John Stuart Mill, avec leurs théories
des avantages absolus ou relatifs, ont démontré que la division internationale du travail (la DIT)
était elle aussi facteur de croissance, chaque pays ayant intérêt à se spécialiser dans les productions
où il détenait le plus fort avantage, ou dans les productions où il était le moins désavantagé. La
théorie classique des échanges internationaux sera complétée à partir des années 1970 par la
« nouvelle théorie des échanges internationaux », qui mettra en avant d’autres facteurs, et qui
renforcera les adeptes du libre échange.
Comment le développement des échanges a-t-il été favorisé, faut-il à tout prix favoriser le
libre échange ?
1.2.1 Le rôle du GATT après la seconde guerre mondiale
En 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la charte de l'Organisation des Nations
unies (ONU) fut signée à San Francisco. Tirant les leçons de l'impuissance de la Société des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%