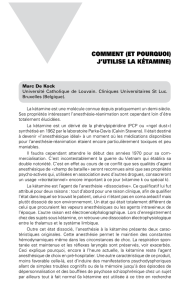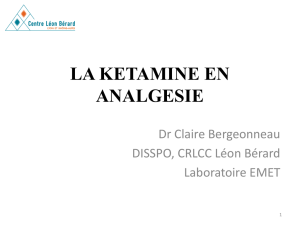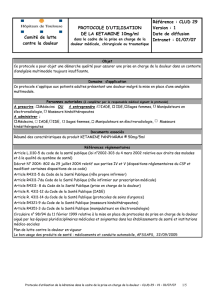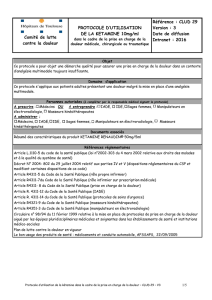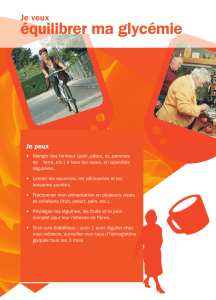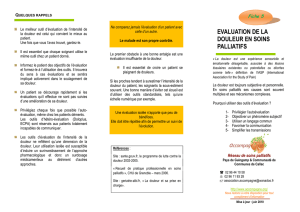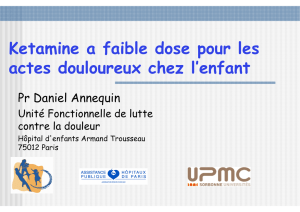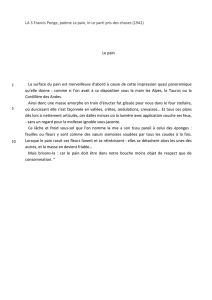Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature

SYNTHÈSE
Médecine palliative
277
N° 6 – Décembre 2004
Med Pal 2004; 3: 277-284
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature
Sébastien Salas, Véronique Tuzzolino, Florence Duffaud, Cédric Mercier, Eric Dudoit, Roger Favre, Service d’Oncologie Médicale, Hôpital de la Timone, Marseille.
Summary
Use of ketamine in palliative care: review of the literature
Over the last ten years, ketamine has been found to be a useful
antalgesic agent. Given at doses below those used in anesthesi-
ology, ketamine increases the antalgesic effect of opioids. Ket-
amine belongs to the family of N-methyl-D-asparatate (NMDA)
receptor antagonists. Its implication in neuropathic pain has
been demonstrated. The drug can be used as an adjuvant for
opioids in patients with refractory cancer pain. The purpose of
this review of the literature is to provide a summary of current
knowledge on the use of this anti-NMDA agent in palliative
care: indications, efficacy, administration routes, dosage, ad-
verse effects, complications. At the present time, the level of
proof is insufficient to confirm the formal efficacy of ketamine
in palliative care. Studies should be conducted to establish a
consensus necessary for widespread use of ketamine in this in-
dication.
Key-words:
ketamine, palliative care, neuropathic pain, review of
the literature.
Résumé
La kétamine a montré depuis ces dix dernières années son inté-
rêt comme
antalgique
. À des doses inférieures à celles utilisées
en anesthésiologie, la kétamine augmente l’antalgie induite par
les opioïdes. Elle appartient à la famille des antagonistes des
récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Son implication dans
les douleurs neuropathiques a été démontrée. Il s’agit d’un trai-
tement adjuvant aux opioïdes dans la prise en charge des dou-
leurs cancéreuses réfractaires. Cette revue de la littérature a pour
but de déterminer l’état actuel des connaissances concernant
l’utilisation de cet anti-NMDA dans le domaine des soins pallia-
tifs : indications, efficacité, voies d’administration, posologies,
effets secondaires, complications. Actuellement, il n’existe pas
de niveau de preuve suffisant pour pouvoir affirmer de façon
formelle l’efficacité de la kétamine en soins palliatifs. Des études
amenant à des consensus nous paraissent indispensables pour
permettre la diffusion de cette pratique.
Mots clés :
kétamine, soins palliatifs, douleurs neuropathiques,
revue de la littérature.
Introduction
La kétamine, produit connu depuis une trentaine d’an-
nées, a été très largement utilisée en anesthésiologie vé-
térinaire et reste un produit de référence en anesthésie
pédiatrique. Cette molécule a montré depuis ces dix der-
nières années son intérêt comme
antalgique
. À des doses
inférieures à celles utilisées en anesthésiologie, la kéta-
mine augmente l’antalgie induite par les opioïdes.
Elle est disponible en France sous forme de solution
injectable en ampoules de 5 ml à 50 mg et 250 mg, com-
mercialisées par les laboratoires Pfizer (Kétalar
®
), et en
ampoules de 50 et 250 mg, distribuées par le Laboratoire
Panpharma (Kétamine Panpharma
®
.). Il s’agit d’une molé-
cule de courte durée d’action, très liposoluble. Elle est
principalement distribuée dans les organes richement vas-
cularisés. Sa demi-vie d’action par voie intraveineuse est
de 7 à 11 minutes et sa demi-vie d’élimination est de 1 à
2 heures. Essentiellement métabolisée par le foie et en
particulier par le cytochrome P450, son principal méta-
bolite est la norkétamine qui est ensuite hydroxylée et
conjuguée avant d’être éliminée dans les urines.
La kétamine appartient à la famille des antagonistes des
récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA). Son implication
dans les douleurs neuropathiques a été démontrée par l’ex-
périmentation animale, par des essais sur volontaires sains
et de petits essais cliniques [1-5]. L’activation neuronale ré-
pétée induit une hyperexcitabilité diffusant vers les neuro-
nes voisins et réalisant une sensibilisation en tache d’huile.
Cette amplification de l’activation des neurones nociceptifs
spinaux est appelée «
wind-up
». Ce phénomène est respon-
sable de l’allodynie. Plus la douleur persiste ou s’intensifie,
et plus ce mécanisme conduit à des modifications durables
des neurones et des synapses réalisant une mémorisation
des phénomènes douloureux. Le récepteur NMDA a un rôle
important d’activation cellulaire et de phénomène de mé-
Salas S et al. Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littéra-
ture. Med Pal 2004; 3: 277-284.
Adresse pour la correspondance :
Sébastien Salas, Unité Mobile de Soutien et de Soins Palliatifs, Service d’Oncologie
Médicale du Professeur Favre, Hôpital de la Timone, 24, rue Saint-Pierre, 13385
Marseille Cedex 05.
e-mail : [email protected]

Médecine palliative
278
N° 6 – Décembre 2004
Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature
SYNTHÈSE
morisation. La kétamine, en tant qu’antagoniste des récep-
teurs NMDA, peut diminuer les effets de sensibilisation cen-
trale secondaires au «
wind-up
». C’est par ce phénomène
que les anti-NMDA seraient actifs sur l’hyperalgésie.
De plus, les récepteurs NMDA semblent jouer un rôle
dans les phénomènes de tolérance aux opioïdes [6]. La
kétamine à faible dose peut partiellement rendre réversi-
bles ces phénomènes. Son utilisation en association avec
la morphine semble donc augmenter l’antalgie au prix
d’effets secondaires modérés [7, 8].
Actuellement, la kétamine est utilisée dans quelques
pays dont les pays scandinaves, l’Angleterre, l’Italie, la
Belgique, le Japon et l’Australie.
En France, la kétamine a fait l’objet d’une autorisation
de mise sur le marché comme agent anesthésique unique,
comme inducteur d’anesthésie avant l’administration
d’autres agents anesthésiques et comme potentialisateur
d’agents anesthésiques de faible puissance. Par ailleurs, il
s’agit d’un traitement adjuvant aux
opioïdes dans la prise en charge des
douleurs cancéreuses réfractaires.
Ainsi cette indication est avancée
dans la littérature bien qu’elle ne soit
pas documentée par des essais clini-
ques de qualité, randomisés, avec un
grand nombre de patients inclus [9].
Les modalités d’administration ainsi
que les posologies de la kétamine ne
sont pas pour le moment standardi-
sées lorsque celle-ci est employée à
faible dose et comme traitement adjuvant des morphiniques
dans les douleurs cancéreuses [9].
Cette revue de la littérature a pour but de déterminer
l’état actuel des connaissances concernant l’utilisation de
cet anti-NMDA dans le domaine des soins palliatifs : in-
dications, efficacité, voies d’administration, posologies,
effets secondaires, complications.
Méthodologie
La recherche bibliographique s’est faite à partir de la
base de données
MEDLINE
sur
National Library of Me-
dicine
(
Pubmed
) et
Embase
sur l’utilisation de la kétamine
comme antalgique en soins palliatifs. Les études fonda-
mentales chez l’homme ou chez l’animal n’ont donc pas
été retenues. Les mots clés ont été
Kétamine, Kétalar, pal-
liative care
et seuls les articles en langue anglaise ont été
cités. Les articles recensés s’échelonnent entre 1990 et dé-
cembre 2003. Les patients concernés par cette revue sont
dans la majorité des cas âgés de plus de 18 ans. Il existe
cependant un compte rendu du cas d’une enfant de douze
ans.
Résultats
(tableau I)
Nous avons retrouvé 11 articles en langue anglaise.
Cependant, un seul de ces articles est publié dans une re-
vue de soins palliatifs [10]. Nous n’avons pas retrouvé
d’articles en langue française selon cette méthodologie.
Certains articles sont publiés dans des revues spécialisées
dans la prise en charge de la douleur, comme le
Journal
of Pain and Symptom management
et
Pain
[6]. On note
également des publications dans des revues de cancéro-
logie comme
l’European Journal of cancer
[2].
Un autre article est publié dans une revue d’anesthésie.
Certains auteurs se sont donc intéressés aux molécules qui
pourraient augmenter l’effet antalgique et modifier les
phénomènes de tolérance aux opioïdes.
Compte rendus de cas
La majorité des articles sont des
comptes rendus de cas
.
L’un d’eux concerne un homme porteur d’un carcinome
épidermoïde du sinus maxillaire inopérable, avec métasta-
ses osseuses crâniennes et cervicales [11]. Des opioïdes par
voie intraveineuse, transdermique et épidurale, avaient été
utilisés sans succès sur des douleurs sévères de la face. En
revanche, un épisode d’accès douloureux a pu être immé-
diatement contrôlé par l’administration de kétamine asso-
ciée à un corticoïde et de la lidocaine. Par la suite le patient
a bénéficié de perfusions de kétamine à des doses comprises
entre 100 et 200 milligrammes par heure, perfusions qui
ont permis de le soulager jusqu’à son décès. Les auteurs
concluent que cette molécule aurait une action co-analgé-
sique sur les accès douloureux des patients porteurs d’un
cancer à un stade avancé. Une lettre publiée en 2000 dans
Journal of Pain and Symptom management
rapporte l’his-
toire d’un jeune homme de 20 ans porteur d’un neurofibro-
sarcome [12]. Ce patient présente des douleurs mal calmées
malgré un traitement par opiacé, anti-inflammatoire non
stéroïdien et anticonvulsivant. Le patient étant toujours al-
gique après une perfusion épidurale de bupivacaine, mor-
phine, clonidine et fentanyl, puis de morphine, gabapantine
et dexaméthasone, un protocole de kétamine orale de 50 à
100 mg toutes les 4 heures avec des doses de secours en
sous cutanée est mis en place. Seule la perfusion sous cu-
tanée a permis une sédation des douleurs et ainsi le patient
a pu quitter l’hôpital avec une perfusion de 1,8 gramme
par 24 heures. La kétamine a été associée à un morphinique
et au midazolam. La dose initiale a été portée à 3,2 gram-
mes par 24 heures dans les jours qui ont précédé le décès.
L’importance de la voie d’administration de l’anti-NMDA
est ainsi suggérée. Un autre article publié dans une revue
d’anesthésiologie évoque une cause particulière de cépha-
Les modalités
d’administration
et les posologies
de la kétamine ne sont,
pour le moment,
pas standardisées.

Med Pal 2004; 3: 277-284
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
279
www.e2med.com/mp
SYNTHÈSE
Sébastien Salas
et al.
Tableau I : Liste des articles faisant état de l’utilisation de la kétamine en soins palliatifs.
Table I: Publications on the use of ketamine in palliative care.
Titre Année Auteurs Revue Posologie et voie
d’administration
Compte-rendus
de cas
Effective treatment of severe
cancer pain of the head using
low-dose ketamine in an opioid-
tolerant patient
1995 Clark, J.L. and
G.E. Kalan
J Pain Symptom
Manage
50 mg bolus IV suivi
de100mg/h puis 200 mg/h
en perfusion IV continue
Ketamine for cancer pain. 2000 Lloyd-
Williams, M.
J Pain Symptom
Manage
50 à 100 mg per os toutes
les 4 heures avec bolus SC
puis 1,8 g /24 h puis
3,2 g/24 h en Perfusion SC
Retro-orbital tumour--an
uncommon cause of headache in
pregnancy
2001 Roberts, L.J.
and C.R.
Goucke
Anaesth
Intensive Care
Topical ketamine in the
treatment of mucositis pain.
2003 Slatkin, N.E.
and M. Rhiner
Pain Med Bains de bouche
Long-term treatment with
ketamine in a 12-year-old girl
with severe neuropathic pain
caused by a cervical spinal tumor
2001 Klepstad, P.,
et al
J Pediatr Hematol
Oncol
Dose test de 7,5 mg IV
puis 36-410 mg/ 24 h IV
Revues
de la littérature
en cancérologie
New approaches to pain control
in patients with cancer
1997 Ahmedzai, S. Eur J Cancer
Advances in cancer pain
management
2001 McDonnell,
F.J., J.W.
Sloan, and S.R.
Hamann
Curr Pain
Headache
Ketamine as adjuvant to opioids
for cancer pain. A qualitative
systematic review
2003 Bell, R.F.,
C. Eccleston,
and E. Kalso,
J Pain Symptom
Manage
4 études : 0,5 mg/kg
2 fois/j Per os
1 mg/kg/j SC
600 mg/j IV
67,2 mg/j Intrathécal
Correspondances The need for ketamine. 2000 Lawlor, P.G.
and Y. Tarumi
J Pain Symptom
Manage
Clinical experience with oral
ketamine
2000 Vielvoye-
Kerkmeer, A.P.,
M. van der
Weide, and
C. Mattern,
J Pain Symptom
Manage
2 mg 3 fois/24 h Per os
à 8 mg/ 24 h Per os
Publications
issue de revue
de soins palliatifs
Ketamine and problems
with advanced palliative care
in the community setting
2000 Baumrucker,
S.J.
Am J Hosp
Palliat Care,

Médecine palliative
280
N° 6 – Décembre 2004
Utilisation de la kétamine en soins palliatifs : revue de la littérature
SYNTHÈSE
lées. Une femme enceinte de 31 ans, chez laquelle on dé-
couvre une tumeur rétro-orbitaire, présente une recrudes-
cence de ses symptômes au décours du troisième trimestre
de grossesse. La plupart des médicaments des douleurs neu-
ropathiques étant contre-indiquée, un traitement à base de
morphine, de paracétamol, d’amitryptilline, de kétamine as-
socié à un support psychologique est mis en place avec de
bons résultats. Les auteurs insistent sur la difficulté qu’a
représentée ce cas, compte tenu des contre-indications liées
à l’état gestationnel de la patiente [13].
Une autre étude de cas concerne un mode d’utilisation
particulier de la kétamine. Une femme de 32 ans atteinte
d’un carcinome épidermoïde de la langue a réalisé des
bains de bouche à la kétamine dans le cadre d’une mucite
radio-induite. Bien entendu, l’efficacité de cette thérapeu-
tique reste à évaluer, y compris dans le cadre d’autres étio-
logies de douleurs buccales [14].
Une observation a été rapportée chez l’enfant. Une
fillette de douze ans porteuse d’un
glioblastome responsable de douleurs
neuropathiques sévères a été calmée
par une dose test de 7,5 mg de kéta-
mine en intra veineux puis par l’as-
sociation de morphine en sous cuta-
née et de kétamine en perfusion intra
veineuse. Les doses utilisées ont été
croissantes, de 36 à 410 mg par
vingt-quatre heures. Elle a bénéficié de soixante-sept
jours de ce traitement avant de décéder. La conclusion de
cet article est qu’il s’agit d’un traitement qui peut être ef-
ficace chez l’enfant présentant des douleurs neuropathi-
ques ne répondant pas aux autres antalgiques. On peut
remarquer que la durée de ce traitement a été relativement
longue, poursuivie au domicile et s’inscrit bien dans un
contexte de soins palliatifs [15].
Essais
Aucun essai clinique n’a été mené en soins palliatifs.
L’utilisation de la kétamine dans ce domaine n’a donc pas
été validée par des études randomisées.
Revue de la littérature en cancérologie
On retrouve également dans ce travail des revues de
la littérature sur l’utilisation de la kétamine en cancéro-
logie. Ahmadzai, dans
l’European Journal of Cancer
de
juillet 1997, passe en revue les différents traitements de
la douleur cancéreuse et leurs effets secondaires : mor-
phine, méthadone, hydromorphone, patch de fentanyl,
strontium 89 et biphosphonate dans les douleurs de mé-
tastases osseuses. La kétamine à petite dose fait partie de
son arsenal thérapeutique pour traiter les douleurs réfrac-
taires et neuropathiques [16].
Un autre auteur en 2001 analyse les différents traite-
ments antalgiques en oncologie et en soins palliatifs, dont
les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la méthadone, la
kétamine et les biphosphonates, et souligne l’importance
de la balance entre les influences excitatrices et inhibitri-
ces du système nerveux central [17].
Une revue systématique de la littérature a été publiée
en septembre 2003 dans
Journal of Pain and Symptom
Management
. L’auteur, à l’aide d’une méthodologie rigou-
reuse, étudie les différents articles portant sur l’utilisation
de la kétamine comme traitement adjuvant des opioïdes
dans les douleurs réfractaires en cancérologie [9]. Son tra-
vail sur Medline, Embase, Cancerlit, The Cochrane Library
analyse quatre études randomisées. Dans ces études, la
population est définie comme présentant des douleurs
cancéreuses résistantes à la morphine ou aux anti-inflam-
matoires non stéroïdiens, des douleurs liées à la patholo-
gie cancéreuse en phase terminale ou des douleurs réfrac-
taires aux opiacés chez des patients présentant un
Karnofsky supérieur à 50 %. Un autre critère d’utilisation
de la kétamine dans ces essais est le caractère neuropa-
thique ou mixte de la douleur. Le mode d’administration
de la molécule diffère selon l’étude : orale, épidurale, in-
trathécale, sous-cutanée ou intraveineuse.
Les doses utilisées diffèrent également d’une étude à
l’autre : 0,5 mg/kg 2 fois par jour per os, 1 mg/kg/j en
sous cutanée, 600 mg/j en intraveineux et 67,2 mg/j par
voie intrathécale.
Deux essais sont des études en
cross over
[18, 19]. Sur
les quatre essais, un seul compare la kétamine à un placebo,
les trois autres comparent la kétamine à la morphine. Deux
essais sont considérés dans cette revue comme non fiables
au niveau méthodologique [20, 21]. Les deux autres con-
cluent que la kétamine permettrait de réduire l’intensité des
douleurs cancéreuses d’origine neuropathique et la con-
sommation de morphine [18, 19]. Cependant, ces études
concernent un faible effectif de patients, le type de douleur
n’est pas décrit et la stratégie de prise en charge des accès
douloureux n’est pas exposée. Pour l’auteur, il est donc né-
cessaire de faire des études contrôlées randomisées sur un
plus grand nombre de patients en homogénéisant le mode
d’administration de la kétamine.
Correspondances
On trouve également deux lettres questions-réponses.
Dans la première, qui correspond à un commentaire d’un
compte rendu de cas, Peter Lawlor rappelle l’importance
d’une prise en charge globale et multidisciplinaire et met
L’utilisation
de la kétamine
n’a donc pas été validée
par des études randomisées.

Med Pal 2004; 3: 277-284
© Masson, Paris, 2004, Tous droits réservés
281
www.e2med.com/mp
SYNTHÈSE
Sébastien Salas
et al.
en garde contre l’augmentation systématique des doses de
morphiniques comme réponse à toute douleur. L’auteur
fait remarquer également que la mise en place de proto-
coles utilisant la kétamine n’est pas une solution exclusive
et que la douleur peut avoir de multiples facettes. Dans
sa réponse, Perry G. Fine reconnaît la nécessité d’une prise
en charge globale de la douleur, mais refuse d’attribuer
les douleurs intenses à la somatisation d’une détresse psy-
chologique et trouve donc tout à fait justifiée l’introduc-
tion de petites doses de kétamine [22]. Cet échange est
assez proche des questionnements qui existent en soins
palliatifs.
Dans une autre lettre, Ans P.E.Vielvoye-Kerkmeer parle
de son expérience de l’utilisation de la kétamine orale chez
des patients cancéreux, douloureux malgré les opioïdes, ou
chez ceux qui présentent des effets secondaires morphino-
induits. Il débute à petites doses 2 mg 3 fois par jour en
augmentant progressivement si besoin à 6 puis à 8 mg 3 à
4 fois par jour. Le but est de trouver une dose efficace sans
entraîner d’effets secondaires neuropsychiques pouvant en-
traver la relation du patient avec son entourage. L’auteur
se demande si la différence des doses de kétamine utilisées
(faibles dans son expérience et élevées chez H. Hayes) pour-
rait venir de la différence de populations : patients cancé-
reux douloureux et patients douloureux chroniques non
cancéreux [23]. Dans sa réponse, Helen Hays confirme que
sa série concernait des patients présentant une douleur
chronique non cancéreuse chez lesquels la kétamine orale
a été utilisée à fortes doses et poursuivie chez 4 de ces pa-
tients. Tous ont reçu une dose test de kétamine IV de
0,4 mg/kg après un bolus de midazolam de 0,05 mg/kg
pour prévenir les effets secondaires. S’il existait une dimi-
nution des douleurs, la kétamine était passée sous forme
orale. H. Hays reprend aussi les différentes posologies de
kétamine utilisées ainsi que les différentes voies d’adminis-
tration selon les auteurs. Sa conclusion est que les patients
douloureux non cancéreux demandent une approche dif-
férente et que d’autres études doivent être faites dans les
deux populations pour cibler les doses efficaces et les effets
secondaires pour chacune d’elle.
Publication issue d’une revue
de soins palliatifs
Baumrucker, dans
American Journal of Hospice and
Palliative Care
, parle des difficultés rencontrées pour faire
accepter à la communauté médicale les avancées théra-
peutiques en soins palliatifs. Cet article est la seule publi-
cation parue dans une revue de soins palliatifs sur ce sujet.
Pour Baumrucker, la kétamine a une multitude d’in-
dications et représenterait un produit révolutionnaire en
soins palliatifs.
Toutefois, dans son institution, son utilisation est ré-
servée à l’anesthésie. Il est primordial pour l’auteur d’édu-
quer la communauté médicale sur l’utilisation de tous les
traitements qui pourraient améliorer les patients en soins
palliatifs et vaincre les résistances qui entourent la fin de
vie [10].
Discussion
Malgré les convictions de nombreux auteurs, dans
l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de
conclure de façon formelle à l’efficacité de la kétamine
en soins palliatifs. La kétamine est un antagoniste des ré-
cepteurs NMDA. De nombreux travaux pré-cliniques, chez
l’animal et le volontaire sain, ont permis de le prouver [1-
5]. Cette molécule est déjà utilisée dans les douleurs can-
céreuses dans de nombreux pays et il existe un très grand
nombre de publications sur l’utilisa-
tion de la kétamine en algologie [9].
Toutefois, il y en a peu concernant
son utilisation de façon spécifique en
soins palliatifs. Ces publications sont
en effet pour la plupart des
rapports
de cas
et il n’existe pas pour le mo-
ment d’essai clinique randomisé de
bonne qualité avec une puissance
suffisante, issu de services de soins
palliatifs. Les populations actuellement étudiées corres-
pondent à des patients, suivis dans des services de can-
cérologie qui diffèrent par leur pathologie, leur prise en
charge et leur stade. On se heurte aux difficultés d’éva-
luation sur une population hétérogène en raison de l’âge,
des pathologies très différentes et de la poly-médication.
Très souvent, ces patients présentent une insuffisance ré-
nale, hépatique, respiratoire ou des troubles des fonctions
supérieures et ne forment donc pas des groupes réellement
homogènes.
De plus, faut-il utiliser la voie orale, la voie sous-cu-
tanée, la voie intraveineuse ? Faut-il utiliser la perfusion
continue ? Les bolus sont-ils efficaces ? La posologie à
utiliser reste elle-même à discuter, même si les faibles do-
ses semblent plus souvent utilisées. Les effets secondaires
ainsi que l’efficacité ne sont également pas évalués. Si
l’action de la kétamine sur les douleurs neuropathiques
ne peut se discuter, le gain qu’elle pourrait apporter sur
le confort et la qualité de vie des malades en soins pal-
liatifs reste un mystère. Par ailleurs, une question encore
plus fondamentale persiste : quelle est l’indication exacte
de la kétamine ?
Dans notre expérience, nous l’utilisons pour les pa-
tients au stade terminal d’une pathologie cancéreuse pré-
sentant des douleurs réfractaires au traitement morphini-
La mise en place
de protocoles utilisant
la kétamine
n’est pas une solution
exclusive.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%