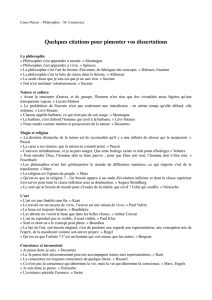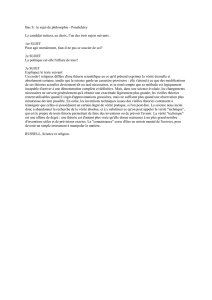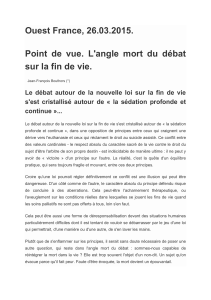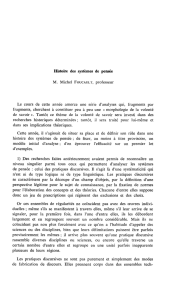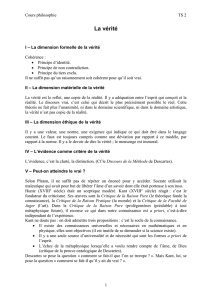L`erreur – 3 - E_Studium Thomas Aquinas

Michel Nodé-Langlois, ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de
philosophie, Professeur en Première Supérieure au lycée Pierre de Fermat à
Toulouse, nous offre une longue dissertation sur « l’erreur ». Celle-ci vient en point
d’orgue au Grand Débat passionnant du forum sur « Qu’est-ce qu’une philosophie
réaliste ? » Compte tenu de son importance, nous la publierons en trois parties.
L’erreur – 3 –
3ème Partie
On ne pourrait sans doute aller plus loin que Nietzsche dans la récusation de
cette opposition. Les sceptiques y avaient certes fortement contribué en acculant les
dogmatiques, qui prétendaient prouver le vrai pour le distinguer du faux, à prouver la
vérité de leurs preuves, s’engageant ainsi dans une régression indéfinie à laquelle il
ne pouvait être mis fin que par une pétition de principe, sauf à invoquer une évi-
dence, c’est-à-dire à ramener le vrai à quelque chose qui paraisse vrai sans qu’on
puisse le prouver, et sur quoi il n’est par suite pas étonnant que les hommes soient
en désaccord. Or, c’est précisément cette rigueur du scepticisme qui fait écrire à
Nietzsche qu’il est d’un côté “ le point de vue proprement ascétique de la pensée ”,
pour qui “ le fait de croire à la vérité est une folie ”, mais que d’un autre côté “ le
scepticisme contient lui-même en soi une foi : la foi en la logique ”1. C’est en effet en
appliquant à elles-mêmes les exigences de la démonstration, explicitées formelle-
ment depuis les Analytiques d’Aristote, que les sceptiques pouvaient mettre en évi-
dence leurs limites et, en ce sens, cette “ impuissance de prouver, invincible à tout le
dogmatisme ”2 dont parle Pascal. Or il faut beaucoup raisonner pour être sceptique
de cette manière, et raisonner, c’est se fier à la logique, mais celle-ci n’est que
“ l’esclavage dans les liens du langage ”3, comme pourrait le laisser penser Aristote
lorsque, voulant faire reconnaître à son adversaire la nécessité du principe de non-
contradiction, il écrit qu’il suffit pour cela que ce dernier “ dise quelque chose de sen-
sé pour lui et pour autrui ”4. Ne faut-il pas reconnaître alors que “ la législation du
langage donne même les premières lois de la vérité ”5, c’est-à-dire de ce qui doit être
tenu pour vrai en fonction de la langue que l’on parle. Mais l’on peut douter “ qu’on
parvienne jamais par les mots à la vérité ”, en entendant par là une vérité indépen-
dante du langage et antérieure à lui : si c’était le cas, “ il n’y aurait pas de nombreu-
ses langues ”6. Leur diversité atteste le caractère arbitraire non seulement de leurs
vocables – les signifiants – mais encore des signifiés qui font leur sens, c’est-à-dire
des concepts : le langage impose la logique, mais “ ce n’est pas logiquement qu pro-
1 Nietzsche, Le Livre du Philosophe, Ébauches, 177.
2 Pascal, Pensées, B 393.
3 Nietzsche, ibid.
4 Aristote, Métaphysique, Livre Γ, ch.4.
5 Nietzsche, Op. cit., Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral, 1.
6 Ibid.
1

cède la naissance du langage ”7, car “ le concept n’est autre que le résidu d’une mé-
taphore ”8, à savoir du transfert de dénomination par lequel des choses d’abord per-
çues comme distinctes et singulières, reçoivent ensuite le même nom. La dénomina-
tion commune dérive d’une “ omission de l’individuel et du réel ” qui fait que “ tout
concept naît de l’identification du non-identique ”9. A la base de ce que le langage fait
considérer comme vérité, il y a en fait une sorte d’erreur, la croyance que, dans son
abstraction, le concept représente quelque chose de réel : ainsi “ les vérités sont des
illusions dont on a oublié qu’elles le sont ”10. On ne saurait mieux réduire à néant
l’opposition de la vérité et de l’erreur.
Aussi bien Nietzsche élimine-t-il une condition de possibilité de celle-ci, et
cette fois non plus en un sens seulement logique ou psychologique, mais bien onto-
logique, à savoir la présupposition qu’il existe une vérité en soi intelligible, à laquelle
la pensée humaine pourrait être ou ne pas être conforme, “ comme s’il y avait dans la
nature, en dehors des feuilles, quelque chose qui serait ‘la feuille’, une sorte de
forme originelle ”, dont “ aucun exemplaire n’aurait été réussi comme la copie fidèle à
la forme originelle ”11. Il est clair que Nietzsche s’en prend ici à la conception platoni-
cienne d’un monde idéal, “ lieu intelligible ”12 dont le sensible serait une imitation cha-
que fois déficiente. Nietzsche voit là une inversion de l’anthropomorphisme qui
préside à la production des concepts, inversion non moins anthropomorphique que
ce qu’elle inverse : la définition du chameau comme un mammifère “ ne contient pas
un seul point qui soit ‘vrai en soi’, abstraction faite de l’homme ”. Aussi Nietzsche ap-
plique-t-il au réalisme idéaliste de Platon la formule même qui résumait pour ce der-
nier le relativisme de Protagoras : croire que les concepts font connaître des arché-
types intelligibles , c’est “ prendre l’homme comme mesure de toutes choses ” - c’est
“ oublier les métaphores originales de l’intuition en tant que métaphores et les pren-
dre pour les choses mêmes ”13. Si “ être véridique ”, c’est “ employer les métaphores
usuelles ”, alors “ tout le matériel à l’intérieur duquel l’homme de la vérité, le savant,
le philosophe, travaille et construit par la suite, s’il ne provient pas de Coucou-les
Nuages, ne provient pas non plus en tout cas de l’essence des choses ”14. Si le
concept n’est qu’une métaphore anthropomorphique, “ toute la légalité ” que nous
trouvons aux choses de la terre et du ciel “ coïncide au fond avec ces propriétés que
nous apportons nous-mêmes aux choses ”15. Aussi l’histoire de la philosophie est-
elle pour Nietzsche le long processus par lequel l’idée d’un “ monde-vérité ”, que Pla-
ton voulait opposer aux errances de l’opinion, “ est enfin devenu une fable ”16. La
notion même de vérité relève pour Nietzsche d’une préférence pour le mensonge, qui
consiste ici à se dissimuler son caractère illusoire. Et l’identification platonicienne du
vrai au divin aura été “ notre plus grand mensonge ”17.
Nietzsche indique toutefois la conséquence corrélative de cet effondrement du
monde vrai : “ quel monde nous est resté ? Le monde des apparences peut-être ?…
Mais non ! avec le monde-vérité nous avons aussi aboli le monde des apparen-
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Platon, République, Livre VI.
13 Nietzsche, ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Id., Le Crépuscules des Idoles.
17 Id., Le Gai Savoir, § 344.
2

ces ! ”18. Quel que soit l’illogisme qu’il professe par ailleurs, Nietzsche se montre ici
parfaitement logique. Car l’abolition du monde des apparences ne signifie pas que
plus rien n’apparaît, mais qu’il n’y a plus rien à opposer à cet apparaître pour le réfu-
ter faux ou trompeur. Il n’y a pas d’être à opposer à l’apparaître, parce que l’être lui-
même est une illusion – logique – qui relève de l’apparaître : il sauve du devenir en
projetant sur lui la fiction d’essences permanentes. Or, si l’apparence tient désormais
la place de la réalité, il semble que le discours qui l’énonce comme telle sans lui op-
poser une pseudo-réalité-en-soi soit vrai, et le discours opposé faux : c’est ainsi que
Nietzsche présente comme “ histoire d’une erreur ”19 l’abolition philosophique pro-
gressive de l’idée platonicienne de vérité. Si, de plus, la vérité sur l’apparence est
que rien n’est et que tout devient, cette dernière proposition présente elle-même
l’inconvénient d’énoncer une vérité permanente : Aristote voyait là une contradiction
du mobilisme20. Mais il n’a pas échappé à Nietzsche que le devenir n’est pas moins
un concept que l’être, et n’est en cela pas moins fictif. C’est pourquoi il souligne que
sa propre thèse selon laquelle “ il n’y a que des interprétations ” n’est elle-même
“ qu’une interprétation ”21, qui ne saurait se présenter comme vraie plutôt que
fausse. Nietzsche est de même conscient, et là aussi de manière fort logique, que sa
généalogie critique du concept aboutit à remettre en question ce qui lui a servi de
point de départ et de justification : si “ notre antithèse de l’individu et du genre est
aussi anthropomorphique et ne provient pas de l’essence des choses ”22, il n’y a pas
de sens à dire que le concept universel jette un voile d’illusion sur la singularité réelle
de ces dernières. Comment dire l’incapacité du langage à dire l’être sans prétendre
énonce par là l’être même du langage ?
La substitution nietzschéenne du concept d’interprétation à l’opposition méta-
physique de la vérité et de l’erreur peut être comprise comme une conséquence ul-
time – à un siècle de distance – de la conception kantienne de la connaissance, au-
trement appelée révolution copernicienne en philosophie. Selon Nietzsche en effet,
“ l’idée ” est “ devenue pâle, nordique, koenigsbergienne ” lorsque le “ monde-vérité ”
a été réputé “ inaccessible, indémontrable ”23. Ce fut le geste fondateur de la philo-
sophie critique que de limiter la connaissance au phénomène – ce qui apparaît – et
de déclarer inconnaissable l’au-delà nouménal du phénomène : la chose-en-soi, et
donc tout aussi bien Dieu, l’âme spirituelle, et en général l’idée d’une subsistance
immatérielle. Kant jugeait nécessaire d’affirmer l’existence de la chose-en-soi comme
“ cause non sensible (unsinnliche Ursache) ”24 du phénomène, pour éviter
“ l’absurdité qu’il y aurait manifestation (Erscheinung) sans rien qui s’y manifeste ”25.
Mais comme il est contradictoire de poser ainsi la chose-en-soi comme objet d’une
proposition nécessairement vraie, et de la déclarer en même temps inconnaissable,
les successeurs de Kant ont reconnu là une notion qui s’éliminait d’elle-même
comme “ vide total déterminé seulement comme un au-delà ”, pure “ négation ” de
toute “ pensée déterminée ”26. La contradiction de la chose-en-soi, donc tout aussi
bien de la notion kantienne de phénomène, est ainsi le moment décisif de l’abolition
18 Id., Le Crépuscules des Idoles, Comment le "monde-vérité" devint enfin une fable, 6.
19 Ibid.
20 Aristote, Métaphysique, Livre Γ, ch.8.
21 Nietzsche, Par-delà Bien et Mal, § 22.
22 Id., Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra-moral, 1.
23 Id., Le Crépuscules des Idoles, Comment le "monde-vérité" devint enfin une fable, 3.
24 Kant, Critique de la Raison pure, De l'idéalisme transcendantal comme clef de la solution de la dialectique
cosmologique.
25 Op. cit.,Préface B, pp. XXVI-XXVII.
26 Hegel, Encyclopédie, § 44 R.
3

du “ monde-vérité ” : reconnu “ inconnu ”, il est “ une idée qui ne sert plus de rien, qui
n’oblige même plus à rien – une idée devenue inutile et superflue, par conséquent
une idée réfutée ”27. Nietzsche voit lucidement qu’un tel geste philosophique, inaugu-
ré par l’idéalisme allemand, est tout autant “ le chant du coq du positivisme ”28.
Ce dernier n’a en effet retenu du kantisme que ce qu’il contenait encore
d’empirisme, à savoir la thèse selon laquelle il n’y aurait de vérité connaissable que
là où est possible une vérification par le moyen d’une expérience, qui suppose tou-
jours la perception sensible de l’objet à connaître. Kant pensait que c’est seulement
en référence à “ l’expérience possible ” que l’opposition du vrai et du faux peut avoir
une pertinence, celle-là étant le seul moyen de faire le départ entre eux, ce qui per-
met à la physique d’être une science, quand la métaphysique, elle, ne saurait l’être :
il n’y aurait de vérité ou d’erreur possibles que comme conformité ou non-conformité
du jugement à une donnée empirique. Celle-ci ne saurait pourtant être assimilée à
une perception brute. Car en tant que telle, la sensation n’est pour Kant qu’une im-
pression qui n’a qu’une signification subjective, comme telle “ aveugle ”29. Elle
n’acquiert la valeur d’un critère de connaissance que dans la mesure où
l’entendement lui applique (Anwendung) ses concepts et ses principes a priori
d’analyse explicative. Le paradoxe est ici que ce qui fait de la sensation autre chose
qu’une “ apparence (Schein) ” subjective, mais bien un phénomène, c’est-à-dire la
manifestation (Erscheinung) de quelque chose – qui se manifeste sans être mani-
feste -, c’est un principe formel d’intelligibilité qui ne vient pas de ladite chose à la
conscience du sujet, mais qui est au contraire conféré par celle-ci à ce qui est censé
manifester celle-là : ce n’est pas par elle-même que la sensation donne un objet à
connaître, mais seulement dans la mesure où elle peut venir s’inscrire dans les ca-
dres a priori de l’entendement : celui-ci “ ne puise pas ses lois a priori dans la nature
mais les lui prescrit ”30. C’est donc l’entendement humain qui est censé être le prin-
cipe non de l’existence, mais de l’intelligibilité de ses objets. Kant conçoit donc bien
la connaissance comme une Sinngebung, une donation de sens, si l’on entend par là
l’intelligibilité que l’entendement confère à ce que nous appelons les choses – cho-
ses qui ne sont telles que pour nous, bien que nous nous autorisions de cette intelli-
gibilité construite par notre entendement pour affirmer avoir rapport à une chose qui
existe en soi. On voit que pareille conception de la connaissance contient l’essentiel
de ce qui définira la notion nietzschéenne d’interprétation. Et Nietzsche va au bout
de sa logique en disant que, derrière une telle “ interprétation ”, on ne peut supposer
aucun “ texte ”31 qui pourrait lui servir de norme, l’interprétation n’ayant ici affaire à
d’autre texte qu’elle-même : il n’y a pas d’interprétation vraie, seulement de vraies
interprétations, et ces propositions interprétatives ne peuvent se donner comme
vraies.
Le nihilisme logique fait ainsi ressortir une aporie sans doute inévitable de la
philosophie critique. On peut en effet se demander comment la conception de la véri-
té qu’elle propose permet de rendre compte de la possibilité de l’erreur. Il ne s’agit
plus ici ni de la soi-disant impossibilité sophistique du jugement faux, ni de
l’incompréhensible infidélité de l’entendement à ses propres lois, mais bien de savoir
comment l’on peut se tromper si l’objet de connaissance n’a d’autre forme intelligible
que celle que l’entendement humain confère à un donné sensible qui est un pur
27 Nietzsche, ibid., 4-5.
28 Ibid.
29 Kant, Critique de la Raison pure, Logique transcendantale, Introduction, I.
30 Id., Prolégomènes, § 36.
31 Nietzsche, Par-delà Bien et Mal, § 22.
4

“ divers (Mannigfaltige) ”32 : bien que Kant se contente manifestement de transformer
en thèse ce qui n’était d’abord posé que comme une définition nominale, c’est bien
l’affirmation que la sensation, “ matière du phénomène ”33, est en elle-même amor-
phe qui permet à Kant d’inférer que tout le formel de la connaissance vient du sujet
connaissant et non pas de la chose connue. Mais on peut alors se demander com-
ment une sensation amorphe peut venir infirmer une proposition théorique, ou en
d’autres termes comment l’expérience peut instruire en réfutant des erreurs, puisque,
comme l’a souligné le falsificationnisme poppérien longtemps après Aristote34, une
expérience ne peut servir qu’à attester une fausseté, et non pas à prouver la vérité
de ce qu’on suppose pour l’expliquer. Un divers amorphe – telle la matière pre-
mière d’Aristote, ou, en termes kantiens le “ déterminable en général ”35 – est en
puissance de n’importe quelle détermination formelle. Si certaines formulations se
révèlent incompatibles avec le donné sensible, c’est que celui-ci a une forme autre
que celle qu’on voudrait lui prêter. La connaissance consiste alors à appréhender – à
recevoir – une telle forme, et non pas à l’imposer. Mais si l’entendement est réceptif
à la forme intelligible des choses, il n’est plus nécessaire de lui supposer des structu-
res a priori pour expliquer qu’il puisse connaître. Et corrélativement, il n’est pas non
plus nécessaire d’en conclure que les choses telles qu’elles sont lui échappent : le
phénomène peut être sans incohérence pensé comme manifestation d’une chose
existant en soi, qui n’est pas censée s’y dérober autant qu’elle s’y manifeste. On
échappe par là à l’incohérence du criticisme, ôtant du même coup toute nécessité à
sa dérive nihiliste.
Sans doute peut-on voir dans la pensée de l’erreur un échec majeur de
l’idéalisme philosophique moderne, dont le nihilisme nietzschéen n’a été que le der-
nier avatar, ce qui explique que Heidegger y ait vu le chaînon ultime de l’histoire de
la métaphysique36. Kant a voulu concevoir un idéalisme qui ne soit que
“ transcendantal ”37, et avait pour cela maintenu le pôle réaliste de l’existence de la
chose-en-soi productrice des sensations. Mais la soi-disant synthèse critique appa-
raît dès lors soit comme un réalisme inconséquent – selon lequel le sujet est censé
s’instruire de choses que pourtant il informe –, soit comme un idéalisme inconsé-
quent – selon lequel le sujet aurait, pour être dans le vrai, à se rapporter à quelque
chose de distinct de lui que pour autant il est condamné à ignorer. On ne voit dès
lors que deux issues à pareille inconséquence. Ou bien entrer dans la voie d’un idéa-
lisme absolu, pour lequel la chose-en-soi n’étant rien pour nous, la conscience ne
saurait la viser comme ce à quoi elle peut être ou ne pas être conforme : viser la
chose-en-soi comme un inconnaissable, c’est pour la conscience reconnaître qu’elle
ne saurait jamais avoir affaire qu’à elle-même. Ou bien revenir à un réalisme consé-
quent pour qui la connaissance consiste à rejoindre une intelligibilité des choses qui
la précède et qu’elle ne construit pas, ce qui implique qu’il n’y ait aucune “ illusion
transcendantale ”38 à dépasser les phénomènes, si leur propre intelligibilité reconduit
à un au-delà qui les fonde.
Le hégélianisme a frayé la première voie, et donne à vérifier qu’un tel idéa-
lisme ne fait pas de place à l’erreur. Hegel admet certes qu’il y a une réponse vraie et
32 Kant, Critique de la Raison pure, Esthétique transcendantale, § 1.
33 Ibid.
34 Aristote, Physique, Livre II.
35 Kant, Critique de la Raison pure, De l'amphibologie des concepts de la réflexion, 4.
36 Heidegger, Essais et conférences, Le dépassement de la métaphysique.
37 Kant, Critique de la Raison pure, Quatrième paralogisme de la psychologie rationnelle.
38 Op. cit., Dialectique transcendantale, Introduction, § 1.
5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%