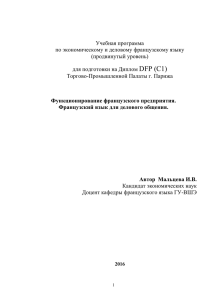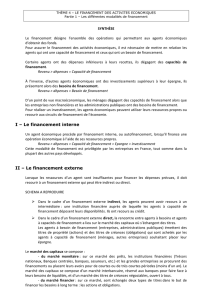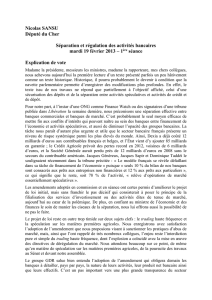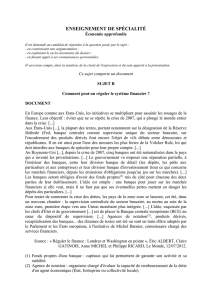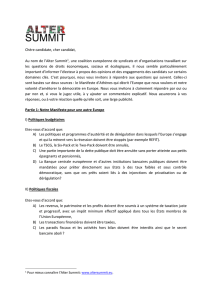Alternative – la banque capitaliste VD

1
III
e
Colloque du DEUST Travail Social
Existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ?
Quelles nouvelles finalités institutionnelles pour les banques et pour les
entreprises ?
Par Daniel Bachet
1
La crise qui débute en 2007 a montré la nécessité de faire reculer le financement de l’économie par le
marché financier et de revenir à un financement bancaire plus équilibré à partir de l’épargne. Sur les
marchés financiers, la monnaie s’échange non pas contre des biens et des services mais contre des
titres de créances ou de propriété représentant des actifs qui rapportent un revenu. La préférence des
investisseurs s’oriente vers les titres qui comportent la plus grande probabilité de générer un profit
important pour une mise de fonds initiale donnée. Ce qui compte avant tout c’est la différence de
rendement entre chaque placement possible et les placements concurrents.
Pour un opérateur dans une salle de marchés, il s’agit de dégager en fin d’année le revenu le plus élevé
possible pour le capital dont la gestion lui est confiée. Quel que soit l’employeur, que ce soit un fonds
spéculatif, une banque, un groupe industriel, une maison de titres ou une compagnie d’assurance, la
recherche du rendement maximal des fonds placés est la règle qui va structurer son comportement
professionnel au quotidien.
On sait que l’instabilité croissante des marchés est liée aux pratiques destructrices de la valeur
actionnariale et plus précisément à la norme financière qui s’est imposée à l’échelle de la planète.
Cette norme financière n’a pas été seulement dictée par les marchés financiers. Elle émane également
des groupes industriels eux-mêmes (Colletis et Lung, 2006). Face aux institutions qui expriment dans
toute leur pureté la recherche de cette norme, les banques peuvent-elles déroger à ces critères de
rentabilité qui impriment partout leur marque ?
On imagine que les conséquences seront différentes selon que ces banques renforcent, par leur
politique de crédit, la domination des marchés financiers dans la gestion des entreprises ou qu’elles
contribuent au contraire à la prise en compte du financement de ces dernières en vue de créer des
richesses (biens et services) accessibles à tous.
Une banque de l’économie sociale et solidaire comme la NEF consacre une part importante de son
activité à financer des projets innovants au plan social, démocratique ou écologique. Mais ce cas isolé
n’est pas suffisamment significatif pour réorienter les règles du jeu en vigueur sauf si de très
nombreux salariés et citoyens responsables choisissaient massivement de faire confiance aux
structures de la finance solidaire.
1
Professeur à l’Université d’Evry, chercheur au Centre Pierre Naville.

2
1. Le financement des entreprises par les banques face à la crise
Les relations entre les entreprises et les banques ont considérablement évolué depuis l’émergence du
capitalisme financier au cours des deux dernières décennies. Pendant les « Trente Glorieuses » (1945 –
1975), les banques constituaient les principaux apporteurs de ressources financières externes aux
entreprises. Le développement rapide de la finance de marché depuis les années 1980 a entraîné
d’importantes transformations des structures de financement des entreprises. Le 12 Novembre 1999, le
Congrès américain a adopté une importante loi de réforme : le Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), du
nom de ses trois principaux initiateurs. Celle-ci a pour ambition de réformer et de moderniser le
domaine des services financiers. À l’origine, l’objectif principal de cette loi était de créer une nouvelle
organisation supprimant toutes les barrières entre les banques commerciales, les sociétés de placement
et les compagnies d’assurances. Désormais les entreprises des trois secteurs peuvent s’affilier
librement et étendre leurs domaines d’activité. Ce faisant, la loi a annulé le Glass-Steagall Act de 1933
qui prévoyait la séparation des activités commerciales et d’investissement bancaire. Ses dispositions
étaient nées de l’idée selon laquelle l’empiètement des banques sur le secteur de l’investissement avait
provoqué le crash boursier de 1929 et la dépression économique qui avait suivi.
Cette déréglementation et ce décloisonnement des activités commerciales, de placement et d’assurance
a conduit à une accélération de la centralisation de l’argent qui cherchent plus que jamais à se valoriser
comme capital auprès des banques ainsi que des fonds de pension et de placements financiers.
Le flux de valeur étant restreint par les limites du mouvement effectif de la production et de la
commercialisation, la course vers de nouveaux mécanismes de valorisation fictive (les innovations
financières) s’est intensifiée.
Au cours des années 2000, il s’est développé une accumulation encore plus fictive de sommes réputées
comme étant du « capital » : la titrisation. Cette dernière représente une forme de valorisation
spéculative déconnectée de l’économie réelle.
Il faut cependant rappeler que la déconnexion absolue économie financière/économie réelle est
impossible car les origines de la prospérité financière ne sont pas internes au monde de la finance.
Elles se situent dans le monde de la production et du travail où la valeur est créée. Ce sont les
institutions et les groupes sociaux détenteurs d’actifs financiers qui vont s’approprier ensuite cette
valeur sur un mode rentier.
Aux États-Unis le montage financier complexe des prêts hypothécaires subprime avait pour support
les bas salaires, la précarité des travailleurs les plus pauvres et les maisons bon marché qui ont été
saisies par les banques sans possibilité de les revendre. La fuite en avant dans le crédit et la titrisation
s’est effectuée avec pour conséquence l’envolée de l’endettement des sociétés financières dans
lesquelles des dettes mutuelles et enchevêtrées ont fini par gripper le crédit interbancaire jusqu’à la
chute de la banque Lehmann Brothers.

3
Si le financement bancaire continue de jouer un rôle certain, la part des financements de marché, par
émission de titres, n’a cessé de se développer. Prises globalement, les grandes entreprises se financent
de plus en plus en émettant des actions et des obligations. Ces financements de marché représentaient
en 2005 plus de la moitié des nouveaux financements externes des entreprises. Ce qui revient à dire
que la part des financements bancaires traditionnels, sous forme de crédits, n’a cessé de diminuer.
Il faut cependant rappeler que les marchés financiers ne sont pas un mode de financement privilégié
des grandes entreprises dans la mesure où ce qu’ils prélèvent sur ces dernières est supérieur à ce qu’ils
contribuent à financer via l’émission de nouveaux titres.
Toutefois, une distinction importante doit être faite entre les petites et moyennes entreprises (PME),
d’une part, et les grandes entreprises (plusieurs centaines ou milliers de salariés), d’autre part. Dans la
réalité, seules les grandes, et surtout les très grandes entreprises, ont directement accès au marché de
titres pour se financer. Ce qui signifie que la plupart des PME continue de trouver leurs financements
externes auprès des banques.
En fait, les PME se retrouvent doublement pénalisées. Trop petites pour aller directement sur les
marchés de capitaux, elles ne peuvent recourir qu’aux banques. Considérée comme plus risquées du
fait de leurs petites tailles, elles se voient, de plus, discriminées du fait de la règlementation qui
s’impose à ces dernières.
En revanche, les grands groupes sont moins touchés. Ils sont favorisés par la réglementation bancaire
et, de plus, ont la taille critique pour aller directement chercher leur propre source de financement sur
les marchés des capitaux.
Or, le comportement des entreprises est fortement influencé par leurs conditions de financement. C’est
vrai des grands groupes multinationaux, surveillés en « temps réel » par leurs actionnaires et leurs
bailleurs de fonds, mais c’est tout aussi vrai des PME. Les décisions les plus stratégiques de ces
dernières (à commencer par celle de créer ou non l’entreprise !) sont presque toujours le résultat d’un
entretien avec leur banquier. Aujourd’hui, ce qu’exigent les actionnaires de l’entreprise (et, plus
encore, les actionnaires de la banque qui financent l’entreprise), ce n’est pas la satisfaction de l’intérêt
général, mais un investissement qui rapporte un rendement maximal. Une banque peut préférer
financer une OPA aux États-Unis en espérant en retirer un rendement bien supérieur aux 6 % ou 8 %
que lui rapporte le crédit à l’entreprise.
Ainsi les PME rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir des crédits. Elles peuvent certes les
obtenir mais à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que ceux accordés aux grandes entreprises.
Elles sont en effet considérés comme plus exposées au risque de faillite que les grandes firmes et ne
présentent pas les garanties que les banques exigent pour accorder un crédit.
Après la crise majeure de ces trois dernières années, le consensus semble s’accorder autour d’une
meilleure réglementation du secteur bancaire voire d’une refondation du système du crédit.
Selon Patrick Artus il faut donner aux banques de bonnes incitations. Il ne sert à rien de réglementer
les banques lorsque l’excès de liquidité écrase les primes de risques sur les crédits et rend par

4
conséquent non rentables l’activité d’intermédiation traditionnelle. S’il en est ainsi, les banques se
porteront vers les activités risquées sous la pression des investisseurs. Les activités d’intermédiation
des banques qui sont utiles doivent donc être rentables et il serait irresponsable de demander aux
banques de prêter à des PME (emprunteurs risqués) sans prendre les primes de risques
correspondantes (Artus, 2010).
De son côté, André Orléan plaide pour un cloisonnement des activités financières par métiers en
distinguant par exemple l’immobilier, le crédit à la consommation et le financement des entreprises de
façon à réintroduire de la logique professionnelle dans le comportement des agents. Ce sont ces
nouvelles finalités ainsi mises en avant qui viendraient alors concurrencer la toute puissance du
rendement financier (Orléan, 2010).
Mais Frédéric Lordon va plus loin encore et propose que dorénavant, le métier de banquier devienne
« terne » et « ennuyeux » et s’inscrive de nouveau dans la mission qui est la sienne : financer le crédit
aux particuliers et aux entreprises avec des taux de rentabilité faibles et très encadrés (Lordon, 2009).
De fait, comme le montre justement Denis Durand, c’est le pilotage de l’ensemble du système
monétaire et financier qui est ici en cause en raison des exigences de rentabilisation des portefeuilles
de titres qui a détourné le crédit des projets créateurs de croissance réelle et d’emplois (Durand, 2005).
2. Vers un système socialisé du crédit sous contrôle public
On a vu avec la dernière crise financière que la récession était bien le produit direct de la violente
contraction du crédit et que les dépôts, les épargnes et les possibilités minimales de crédit devaient être
considérés comme des biens publics vitaux pour la société. Il est donc extrêmement risqué et même
inconséquent de confier l’épargne à des intérêts privés surtout lorsqu’ils sont aussi peu éclairés que les
banques engagées dans des activités de marchés financiers.
Michel Aglietta et André Orléan ont montré que tout système bancaire tentait de réaliser un
compromis institutionnalisé entre les deux modèles polaires antagonistes que sont la centralisation et
le fractionnement (Aglietta et Orléan, 1982). Dans le pôle fractionné le taux de change des monnaies
est laissé à des mécanismes de marché. C’est un système instable menacé par la déflation. Les
concessionnaires privés de l’émission monétaire peuvent surémettre du crédit en direction des
opérateurs de la finance de marché avec le résultat que l’on a connu et la crise des mauvaises dettes.
Le pôle centralisé ou Étatique est guetté quant à lui par le risque de la surémission, du surendettement
et de l’inflation. Un pôle étatique unifié de crédit peut céder à la tentation de substituer aux critères de
la sélectivité économique de crédit des critères de sélectivité politique. Le robinet du crédit monétaire
serait alors ouvert à de multiples demandes et tous les secteurs de la société convergeraient vers
« l’État-monétaire » pour lui en demander toujours plus.
Frédéric Lordon propose de dépasser cette alternative, de reconnaître le principe même de la
délégation-concession de l’émission monétaire et de la placer sous un principe de service public

5
(Lordon, 2009, op.cit.). Les concessionnaires de l’émission monétaire ne sauraient être des sociétés
privées par actions mais des organisations à profitabilités encadrées. Il serait alors possible d’envisager
pour les banques un contrôle public local par les parties prenantes que sont les salariés, les entreprises,
les associations, les collectivités locales et les représentants locaux de l’État. Ces agents et institutions
n’auraient pas le pouvoir direct sur le crédit mais auraient un pouvoir de suivi, d’orientation, de
validation et de recadrage de la stratégie bancaire. La multiplicité et l’autonomie opérationnelle des
concessionnaires de l’émission monétaire inscriraient les parties prenantes dans des formes
institutionnelles allongées relevant non plus d’un pôle unifié du crédit mais d’un système socialisé du
crédit. Il s’agirait en fait de repolitiser dans l’univers économique ce qui avait été dépolitisé par les
logiques capitalistes. Ce qui signifie clairement la remise en cause du suffrage censitaire qui a
proportionné la possibilité d’intervention des agents à leur seule capacité patrimoniale.
Dès lors que l’État apporte sa garantie dans un système où les banques opèrent à distance de l’univers
des marchés et dans le cadre d’une règle de profitabilité limitée, la question de l’insolvabilité ne risque
plus de se poser de manière aussi violente et répétitive que dans le cas de la concurrence effrénée et de
la recherche d’un profit toujours indéfiniment plus élevé.
La socialisation démocratique du secteur bancaire au niveau national mais aussi au niveau européen
devrait être imposée par les citoyens et par les peuples compte tenu de la crise économique et
financière mais aussi de l’échec flagrant de la privatisation qui s’est limitée à socialiser les pertes.
Mais il faudrait pour cela remettre en cause les structures, les objectifs, les missions de la Banque
centrale européenne et son organisation en vue de pratiquer une politique monétaire sélective. Les
crédits sélectionnés bénéficieraient de taux d’intérêt fortement réduits alors que les placements
financiers devraient être au contraire pénalisés.
Les salariés et les citoyens pourraient participer à une sélection rigoureuse, au niveau local et régional,
de projets favorables au développement et à l’emploi. Les crédits bancaires seraient alors mobilisés en
vue d’un financement sélectif de ces projets, avec l’incitation de garanties ou de bonifications d’intérêt
apportés par des fonds régionaux et par un Fonds national pour l’emploi et la formation (Durand,
2010).
La création d’un pôle bancaire socialisé et démocratisé serait ainsi de nature à réorienter l’économie
européenne vers la reconversion écologique de l’économie et la satisfaction des besoins sociaux
prioritaires. Pour cela il peut exister une pluralité de solutions : des banques privées encadrés par des
politiques publiques, un pôle public de banques nationales spécialisées, un secteur coopératif et
mutualiste, etc.
Quelles sont les conditions pour qu’une telle orientation puisse prévaloir sachant que le système
économique actuel est porté par des intérêts puissants ? Ce système est cohérent à sa manière, sait
résister et parvient même à promouvoir ses fins avec l’appui du politique. C’est donc le moment de
montrer les impasses vers lesquelles il nous conduit en proposant de redéfinir les finalités de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%