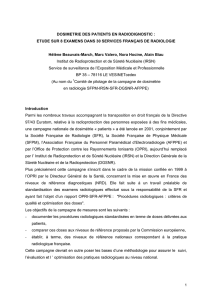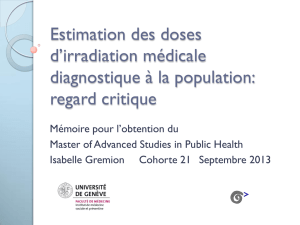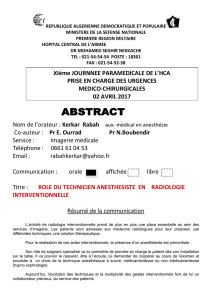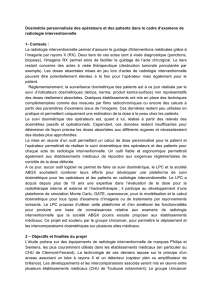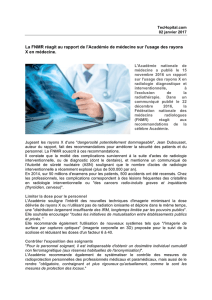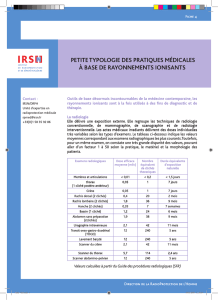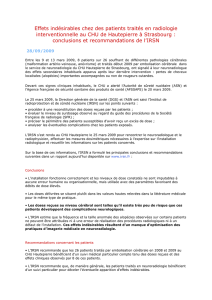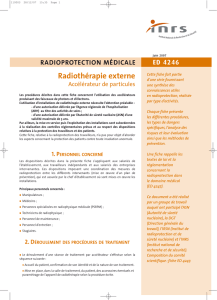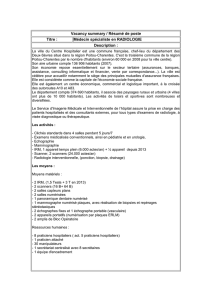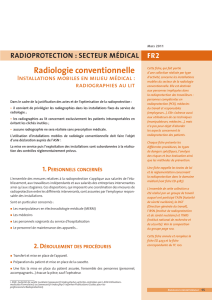document de synthèse des présentations

RESUMES DES PRESENTATIONS
1. Etude de poste en radiologie interventionnelle – Hôpitaux privés Clairval et
Résidence du Parc
Générale de santé - Résidence du Parc / M. GUILLALMON et M
elle
BULLA
Les études de poste sont difficiles à réaliser du fait de la diversité des techniques et matériels
utilisés, ainsi que du manque de coopération des services concernés.
Pour préparer la réalisation des études de postes, il est important de disposer de la liste des
installations, des procédures d’acquisition et de la répartition du personnel.
Trois différents types d’acquisition ont été utilisés :
- films dosimétriques : corps entier, extrémités (mains, chevilles) et cristallin,
- instruments de mesure instantanée. Cependant cela donne lieu à de nombreuses
difficultés car il faut se placer au milieu du bloc (peu de place, gêne des praticiens,
problèmes d’asepsie),
- simulation avec fantômes et mesures en tridimensionnel. Dans ce cas il y a une facilité de
réalisation due à l’absence de patient et de personnel, mais les opérateurs sont considérés
comme fixe et les doses résultantes sont en général surestimées.
Pour exploiter les résultats de mesure, les temps d’émission, le nombre de séries réalisées, ainsi
que les attributions et rôles des praticiens et personnels des services sont pris en compte.
Un écart de 30% entre le prévisionnel et les doses personnelles est admis.
En conclusion, on constate que les doses peuvent être importantes, surtout pour les praticiens,
notamment sur le cristallin. L’importance de porter et d’utiliser les protections radiologiques est
donc cruciale, et le port des dosimétries doit être respecté.
2. Analyse de poste en salle de radiologie interventionnelle
CHU de Montpellier (M. Routelous et M. Mackowiack)
Ce travail a été présenté par M. Mackoviack (stagiaire en master 1) et par M. Roustelous
(physicien). Le principe de leur étude est de comparer la dosimétrie des intervenants, dans
l’activité de chirurgie thoracique cardiaque et vasculaire (CTCV), obtenues soit par des calculs
(approche théorique), soit par des mesures in vivo.
Les données de base pour cette étude étaient les suivantes :
- prendre en compte l’ensemble du personnel présent lors des examens (chirurgien, chef de
clinique, médecin anesthésiste, infirmiers, IBODE, etc. …),
- répertorier les données existantes de l’ensemble des examens réalisés en 2010 (3065
examens),
- sélectionner, parmi l’ensemble de ces examens, les plus pertinents pour l’étude (le choix a
été porté sur les actes plus courants et le plus irradiants).
Une fois ces données rassemblées, l’équipe du CHRU de Montpellier a réalisé :
- une approche théorique (réalisation de mesures sur fantôme avec estimation de la
position des opérateurs vis-à-vis des faisceaux et en utilisant des constantes proches de
celles utilisées lors d’examens réels),
- des mesures in vivo (en équipant le matériel et les intervenants de dosimètre).

Ces deux méthodes ont permis de mettre en évidence que même si l’approche théorique
surestime la dosimétrie corps entier, les résultats des deux techniques restent dans les mêmes
ordres de grandeurs. Par contre, l’approche théorique atteint ses limites quand on souhaite avoir
des valeurs fiables pour la dosimétrie extrémités car l’estimation des distances (pour la position
des opérateurs) entraîne de grosses variations sur le calcul. De plus, il est délicat de multiplier les
mesures in vivo puisque cela entraîne une forte implication des intervenant au sein du bloc.
L’ensemble des données recueillies (mesures in vivo et calcul) a permis :
- de classer le personnel intervenant au bloc en catégorie B,
- de proposer des axes d’optimisation de la dosimétrie en :
o ajoutant des lunettes plombées aux médecins,
o ajoutant des bas volets plombés,
o mettant en place des journées d’information pour rappeler les bonnes pratiques
en radioprotection (écrans, distances, etc. …).
3. Retour d’expérience sur la dosimétrie des extrémités
AP-HM / M. FARMAN
Bardia FARMAN, physicien médical, a présenté le travail que les personnes compétentes en
radioprotection (PCR) de l’AP-HM ont effectué en radiologie interventionnelle sur la dosimétrie
extrémités des médecins.
L’objectif de l’étude était de faire une estimation des expositions annuelles des médecins des
différents secteurs (médecins radiologues et gastro-entérologues). L’étude concernait plusieurs
actes : neuroradiologie, cathétérisme, angiographie. Pour chacune de celles-ci, des analyses de
postes concernant les extrémités ont été réalisées avec des matériels différents : dosimètres TLD
bagues, poignet et front.
Analyses de poste en neuroradiologie
L’étude réalisée pour cette activité a révélé que les neuroradiologues sont très intéressés par la
radioprotection et que cela se ressent dans les pratiques. En effet, les PCR ont noté, au vu des
doses recueillies, une réelle optimisation de l’utilisation des EPC (équipements de protection
collectifs) et des EPI (équipements de protection individuels). Elles ont également relevé que lors
des actes interventionnels, la voie fémorale était privilégiée. De ce fait, l’émetteur de
rayonnements ionisants est éloigné de la tête du patient. Les PCR ont cependant noté que la
diminution des doses relevées au niveau des extrémités était également du au fait que pour les
actes de neuroradiologie, les médecins sont plus éloignés de l’émetteur que pour certaines autres
spécialités. Ils ont également relevé un port irrégulier de la dosimétrie par bague.
En extrapolant les résultats, les PCR ont abouti à un classement en catégorie B des opérateurs.
Analyses de poste pour les actes de cathétérismes
L’étude a été réalisée sur deux semaines avec une fréquence de deux demi-journées par semaine.
Les mesures ont été réalisées pour un médecin gastro-entérologue, un assistant et deux
infirmières. Les doses les plus élevées ont été relevées pour le médecin. La dose reçue au poignet
par le médecin étant largement supérieure à celle reçue pour les infirmières.
En extrapolant les résultats obtenus sur une année, les PCR ont proposé de reclasser les
infirmières en catégorie B alors qu’elles étaient initialement classées en catégorie A.

Les PCR ont noté un port irrégulier de la dosimétrie opérationnelle et de la dosimétrie poignet
par les personnels lors de cette étude.
Analyses de poste en angiographie
Afin d’attirer l’attention des opérateurs, les PCR ont d’abord mené un travail permettant de
mettre en évidence la nécessité des EPC. Ils ont réalisé des mesures derrière les paravents et hors
des paravents afin de montrer les grandes différences entre les deux types de mesure (mode
graphie et mode scopie). Des mesures ont ensuite été réalisées en positionnant des dosimètres
sous et sur les tabliers, et en utilisant des dosimètres TLD front et poignet. Des mesures ont été
réalisées derrières les lunettes plombées pour démontrer leur efficacité.
Les PCR ont noté qu’il existait une grande variabilité pour les doses reçues au cristallin et aux
extrémités. Ceci peut s’expliquer par l’influence de nombreux facteurs :
- le praticien : les pratiques différent selon les médecins,
- la nature de l’acte et la difficulté du cas pouvant entraîner la délivrance de doses élevées,
- l’utilisation imparfaite des EPC et des EPI,
- le cas des actes réalisés en urgence.
En extrapolant les doses mesurées à l’année et en prenant en compte l’ensemble des facteurs ci-
dessus, les PCR ont proposé de classer les opérateurs en catégorie A.
A la suite de cette étude, les PCR ont convenu qu’un grand nombre de facteurs devaient
être pris en compte afin de réaliser des analyses de poste pour les extrémités réalistes. En effet, il
faut avoir à l’esprit que beaucoup de facteurs influencent la dose reçue (pratiques des praticiens,
sensibilisation à la radioprotection, port irrégulier des bagues, problème de stérilisation …). Les
PCR soulignent la nécessité de porter régulièrement les moyens de dosimétrie et d’utiliser au
mieux les EPC. Le prochain objectif de ces PCR en radiologie interventionnelle est d’effectuer
des analyses de poste dans les blocs opératoires, en prenant en compte l’ensemble des contraintes
que cela engendre.
4. Mise en place de dosimètres d’extrémités de type bague : aspects ergonomie et
hygiène
IRSN – LSDOS / M. CALE
Monsieur Eric CALE, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a
effectué une présentation afin de faire partager l’expérience acquise par l’IRSN pour la mise en
place de nouveaux dosimètres extrémités de type bague en prenant en compte la problématique
de la stérilisation. En effet, celle-ci est évoquée par plusieurs services de radiologie
interventionnelle et constitue un réel frein pour la mise en place de la dosimétrie des extrémités
en routine.
Eric CALE a rappelé que l’IRSN possède un laboratoire agréé pour fournir des
dosimètres passifs. Celui-ci est l’un des plus grand laboratoire français.
Monsieur CALE a rappelé tout d’abord les différents types de dosimétrie (poitrine,
poignet, bague) disponibles au sein de l’IRSN et précisé que sur les 8200 travailleurs qui ont
bénéficié d’un suivi dosimétrique « extrémités » par l’IRSN, seuls 7.3% faisait partie d’un service
de radiologie interventionnelle.
Une étude faite par l’IRSN a montré que la dosimétrie bague est plus pertinente pour le
suivi des extrémités (par rapport à la dosimétrie poignet) car plus représentatif de l’exposition des
travailleurs. Partant de ce constat, l’IRSN a engagé des réflexions sur la dosimétrie extrémités par
bague.

Des études ont été réalisées dans des services de médecine nucléaire et de radiologie
interventionnelle. L’IRSN a identifié une grande marge de progression dans ce dernier domaine.
En effet, sur une période donnée, il y a eu deux dépassements de limite réglementaire. L’IRSN a
donc souhaité participer à l’effort de progression en radiologie interventionnelle en essayant de
produire une bague plus facile d’utilisation pour les services.
L’IRSN a proposé en 2011 une nouvelle bague dont les principales grandes avancées
restent le confort d’utilisation et les progrès en matière de stérilisation. A cet effet, deux nouveaux
protocoles de désinfection ont été mis au point pour les bagues. Ceux-ci doivent être validés par
le C.L.I.N de chaque établissement avant utilisation. Monsieur CALE signale par ailleurs que des
procédures de désinfection pour les bagues dosimétriques ont déjà été publiées dans des revues
spécialisées et que des procédures sont déjà mises en place dans certains services de radiologie
interventionnelle.
Monsieur CALE signale que l’IRSN peut accompagner les services de radiologie
interventionnelle en leur fournissant les protocoles et les nouvelles bagues.
5. Présentation de l’incident survenu au CHU d’Angers en radiologie vasculaire
CHU d’ Angers / Dr THOUVENY
L’incident est survenu sur un patient de 62 ans atteint d’une pathologie lourde, dont le
pronostic vital était engagé.
Dans un premier temps, une chirurgie est envisagée. Compte tenu de l’état général du
patient, cette chirurgie est récusée au profit d’un traitement endovasculaire. Cette intervention
engendre un temps de scopie important (environ 40 minutes) et ne s’avère pas concluante. La
même intervention avec un nouveau matériel est donc reprogrammée 6 jours plus tard. Lors de
cette seconde intervention est délivré un temps de scopie d’environ 150 minutes et des clichés en
graphie sont également faits.
Un mois après ces interventions, le patient présente des démangeaisons et des brûlures
qui évoluent rapidement vers une phlyctène. La phlyctène évolue rapidement. Cette brûlure est
classée au stade 4 des brûlures radiologiques et nécessite une surveillance rapprochée. Le
diagnostic de radiodermite est posé mi janvier soit deux mois après les interventions
radiologiques.
En conséquence, le centre hospitalier déclare l’évènement à l’autorité de sûreté nucléaire,
et demande rapidement une reconstitution dosimétrique à l’IRSN. Les experts de l’IRSN estime
qu’a été délivrée au patient, une dose à la peau de 5,2 Gy lors de la première intervention et de 15
Gy lors de la seconde, soit une dose à la peau d’environ 20 Gy sur les deux interventions. La dose
à la moelle est estimée à 6 Gy.
L’appareil de radiologie utilisé lors de ces deux interventions n’était pas équipé de système
de dosimétrie en temps réel, ni de filtration additionnelle, ce qui étaient des facteurs favorisant la
surexposition du patient.
Selon les recommandations de l’IRSN, le centre a équipé l’installation dans un premier
d’un système de PDS permettant d’indiquer la dose délivrée ainsi que d’une filtration
additionnelle. Le centre envisage dans un second temps de remplacer cet appareil.
De plus, l’IRSN recommande la mise en place de niveaux de référence ainsi que la mise
en place d’une démarche d’optimisation en collaboration avec le radiophysicien.

En conclusion, Madame THOUVENY, médecin au CHU d’Angers tient à souligner
qu’afin d’éviter la survenue de nouveaux incidents l’implication de tous les acteurs est
primordiale.
6. Retour d’expérience sur l’optimisation des doses : recommandations et exemples
IRSN – UEM / M
me
ETARD
Madame ETARD de l’unité d’expertise en radioprotection médicale de l’IRSN a présenté
un retour d’expérience sur l’optimisation des doses.
L’objectif de l’optimisation est de délivrer la dose nécessaire afin d’obtenir des images de
qualité suffisante pour réaliser l’intervention.
Les doses délivrées peuvent être réduites par action sur plusieurs paramètres comme la
géométrie (distance, positionnement du patient, orientation du faisceau), le nombre d’images
(graphie et scopie) ou encore la valeur de la dose au niveau du détecteur.
En pratique, il existe plusieurs « outils » pour optimiser les doses délivrées : les pratiques
des opérateurs et les paramètres des protocoles. Ainsi, l’optimisation nécessite un consensus des
opérateurs.
Ensuite, Madame ETARD a présenté des cas concrets d’optimisation, consultables sur sa
présentation power point.
7. Evaluation des Pratiques Professionnelles en Radiologie Interventionnelle :
Radioprotection
AP-HM /Pr. VIDAL et Dr REYRE
Plusieurs analyses ont montré que les doses reçues par les patients en radiologie
interventionnelle étaient trop élevées en regard des données issues d’autres pays européens. En
conséquence un programme de réduction des doses a été mis en place, et l’évaluation des
pratiques professionnelles par comparaison avec des données de la littérature et les
recommandations professionnelles a permis d’évaluer l’impact du programme.
Le service de radiologie est équipé d’une table d’angiographie. Le service a choisi 4
interventions pour leur caractère reproductible et le fait qu’elles concernent des parties différentes
du corps humain :
- artériographie des membres inférieurs,
- chimio-embolisation hépatique,
- embolisation bronchique,
- embolisation utérine d’hémostase.
La méthode mise en œuvre comporte plusieurs étapes :
- recueil du PDS, du temps de scopie et du nombre d’images (sur environ 160 procédures
avant le programme d’optimisation et 160 après),
- programme d’optimisation par formation du personnel (dont bonnes pratiques, scopie
utilisation pulsée, distance foyer-patient, utilisation de collimation), modification des
paramètres d’irradiation des installations (préréglage en « doses basses » à l’allumage),
utilisation de matériel dédié avec affichage des paramètres et PDS en sortie de tube,
utilisation de filtrations additionnelles.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%