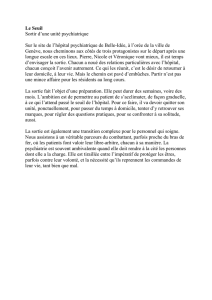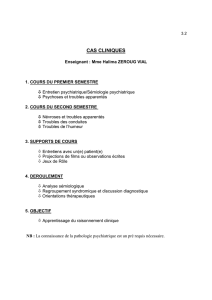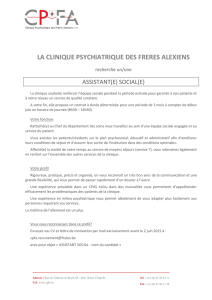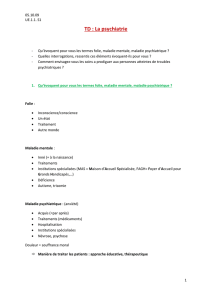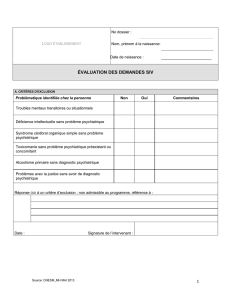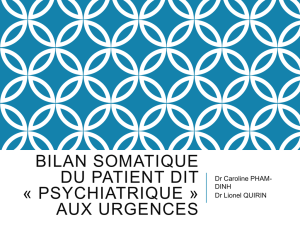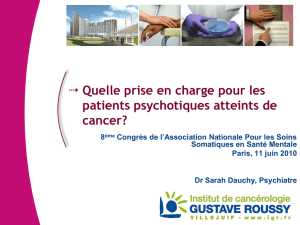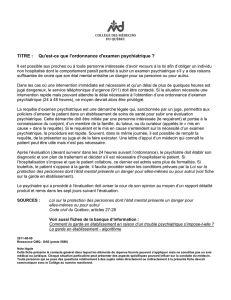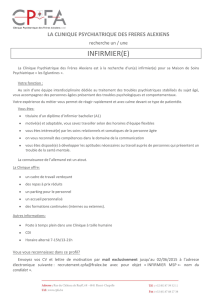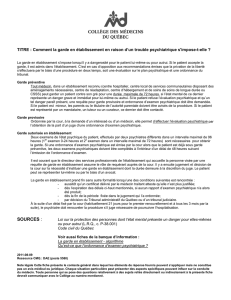Réponse à la crise. Stratégies et intentions d`intervention dans le

REPONSE A LA CRISE.
STRATEGIES ET INTENTIONS DE L'INTERVENTION
DANS LE SERVICE PSYCHIATRIQUE TERRITORIAL.
Giuseppe DELL'ACQUA, Roberto MEZZINA (1)
Certaines parties de cet article ont été publiées en Italie ("Le travail thérapeutique
dans le Service territorial", éd. Salemi, Rome, 1987), et en Grande Bretagne
("Responding to crisis, Italian style" in "Psychiatry in transition", Pluto, SNAN, London)
et dans un autre article encore ("De la psychiatrie à la santé mentale", Ed. Salemi,
Rome, 1987);
L'article qui suit, publié en: "Perspectives."- Liège - 1991, représente une ré-
élaboration et le développement, dans une forme plus élargie, des idées exposées dans
les articles précités.
1. Introduction : crises et circuit psychiatrique.
2. Service territorial intégré et complexité.
3. Intervention sur la crise entre instance de contrôle possibilité d'émancipation.
4. Modalités du contact.
5. La prise en charge.
6. L'écoute organisée, l'organisation de l'écoute.
7. La valeur-temps.
8. Le réseau social.
9. Offre thérapeutique/reproduction de la crise.
10. Crise du Service = rupture et reconstitution des équilibres Institutionnels.
11. Conclusions.
1

INTRODUCTION
CRISE ET CIRCUIT PSYCHIATRIQUE.
II est sûrement difficile de donner une définition univoque de la crise. Tout schéma de
référence se doit de tenir compte de l'organisation psychiatrique qui existe à cet endroit et à
ce moment historique particulier.
II existe une "valeur de base" relative à ces deux contingences, au-delà de laquelle les
problèmes émotionnels, psychologiques, relationnels, sociaux, c'est-à-dire les "événements
de vie", endossent les caractéristiques de la crise et deviennent objets de l'intérêt
psychiatrique.
II arrive alors que la personne en crise entre dans ce parcours, "ce circuit" où l'hôpital
psychiatrique (H.P.) représente la norme. En Italie, avant la loi de réforme psychiatrique de
1978 (Loi 180), l'hôpital psychiatrique était également le lieu d'aboutissement de ce genre de
situation.
La "valeur de base" entraînant l'entrée dans ce circuit est à chaque fois définie selon des
systèmes de reconnaissances. Cela peut être en terme de souffrance, de comportement
dérangeant ou socialement dangereux, d'état de misère et de marginalité, de crise dans les
relations familiales, de difficultés au travail, d'incompréhension de certains comportements,
d'intolérance dans l'environnement, ...
Les "Centres de crise" créés dans les pays anglo-saxons à partir des années '50 (Ponsi,
1979) tendent souvent à proposer des instruments d'intervention rapides et précoces. Ils
cherchent ainsi à offrir une solution Immédiate du problème, en maintenant le plus possible la
personne hors du circuit psychiatrique. Leur objectif principal est la diminution des entrées en
H.P.. Ces interventions thérapeutiques, par définition de courte durée, et ces Services ne
disposent pas des ressources nécessaires susceptibles d'offrir au patient en crise une
protection contre un certain nombre de risques. De plus, par leur organisation séparée, sans
liens organiques avec les autres structures assistantielles et avec le territoire, Ils ne peuvent
évaluer les "échecs éventuels" de leur Intervention. Ils finissent ainsi, de fait, par envoyer les
situations les plus "graves" aux institutions plus "lourdes" et à l'H.P.. Ce faisant, ils confirment
la "centralité" de ces deniers.
La persistance de l'H.P. comme "récepteur" des rebus de ces modèles opérationnels
garantit leur "propreté" pratique et idéologique - c'est-à-dire la possibilité d'utiliser de façon a-
critique les schémas techniques bien souvent Imperméables et sélectifs qui permettent la
détermination de spécificité, Ie classement des comportements, l'homologation de parties de
problèmes. Ils prévoient cependant une série de réponses préformées et des paramètres
définis et contrôlables à la lecture des conditions de la crise.
De manière analogue, les Services communautaires qui interviennent en aval de l'H.P.
tendent à produire des interventions spécialisées de réhabilitation et de ré-socialisatlon. Cela
se traduit concrètement par la mise sur pied d'ateliers protégés, de Centres de loisirs, de
programmes pour l'Insertion professionnelle, d'écoles de formation professionnelle, de
réponses aux problèmes de logement, de logements communautaires, d'aides économiques.
Toutes ces interventions sont fréquemment présentées de façon fragmentées et non
coordonnées. Même si ces Services ont contribué (et contribuent) à la diminution de la
population des H.P., ils ne prévoient pas non plus l'évolution des échecs éventuels. Ils se
préoccupent plutôt, équipés comme ils le sont, à affronter des besoins spécifiques, en rendant
des Services sélectifs et Imperméables les uns aux autres.
2

II arrive ainsi que, le circuit psychiatrique, axé longtemps sur la présence exclusive de
l'H.P., s'articule ces dernières décennies selon des modèles opérationnels plus complexes,
par la présence de différentes "stations". Cependant, le modèle culturel de référence ne s'est
pas modifié de façon substantielle et les nouvelles pratiques réproposent des espaces
séparés d'intervention. Elles correspondent à des offres thérapeutiques qui fragmentent la
réponse au besoin d'aide et de soutien. II ressort de cet "éclatement* une disproportion
paradoxale entre l'offre des Services, souvent "exubérants" et diversifiés, et la possibilité de
pouvoir en bénéficier. Le parcours thérapeutique qui se confirme ainsi est, dans ses passages
indéfinis, difficilement praticable par celui-là même qui en a besoin. Les trajets que doit
accomplir la personne, les renvois, les rigidités des diverses "stations" du circuit, non
seulement ne résolvent pas la crise, mais bien souvent en déterminent l'émergence.
N'étant pas capable de reconnaître le sujet comme une entité complexe, le système tend à
proposer des réductions et des simplifications progressives. C'est toujours la "crise du patient"
qui est considéré. Cela vient de l'incapacité de ce système des Services à "se mettre en crise"
face à des besoins et des demandes "exubérantes" et "impropres".
Le moment où la personne en crise devient objet d'attention peut être identifié comme le
point de simplification maximale de la relation. D'un côté, le sujet, pour se manifester, a déjà
simplifié progressivement la complexité de son existence souffrante, la réduisant à un certain
nombre de symptômes; de l'autre côté, le Service, quel qu'il soit, s'est, par effet de miroir,
équipé afin de percevoir et de reconnaître ces symptômes qui s'offrent comme modèle de
simplification ultérieure.
SERVICE TERRITORIAL INTEGRE ET COMPLEXITE.
Notre expérience nous amène à mettre en évidence, d'une part, la complexité de la
situation existentielle qui converge dans la condition de crise et, d'autre part, la complexité des
instruments et des ressources nécessaires pour l'affronter.
II est nécessaire de repartir de la simplification, comme fausse spécificité du symptôme,
afin de tenter de rétablir des conditions susceptibles de favoriser l'expression, par la crise, de
sa demande globale. Demande qui recouvre, Investit la vie et la possibilité de vivre y compris
dans le cadre d'une relation institutionnelle déterminée.
Le concept de crise en psychiatrie est né de l'intention, correcte sur le plan théorique, de
reconsidérer la maladie mentale à travers une recherche sur la souffrance existentielle du
sujet, vue comme une "unité biologique", ou "membre d'un système", ou "sujet social", en
retraçant les origines de cette souffrance et les conditionnements qu'elle a subit. Dans ce
sens, le concept de crise a représenté la tentative d'appliquer une méthodologie unitaire, non
uniformisante, de façon à trouver sa spécificité dans la singularité des problèmes posés par le
sujet, en évitant le recours à des approches et à des Interventions propres su modèle médical.
Dans l'unité de "cette" histoire, le symptôme peut alors être reconsidéré comme signifiant
d'une réalité devenue intelligible.
Notre expérience nous apprend que la reconstruction de l'histoire à travers de multiples
moments de contact et de connaissance entre le Service et la personne dans ses lieux de vie,
dans son réseau relationnel, en rapport à ses problèmes matériels et concrets, permet de
situer la crise à l'intérieur d'une série de liens qui peuvent la rendre compréhensible (pas de
l'expliquer ! ), lui donner sens et enfin lui permettre de récupérer une relation entre valeur de
santé, valeur de vie et la crise elle-même.
Dans ce sens, la "histoire'' signifie autant reconstruction du parcours affectif, social et
institutionnel de la personne que recomposition de la cassure dans son expérience de vie
représentée par la crise en action.
3

Dans notre cas, l'abandon de l'H.P. et le choix du territoire qui va de pair avec la
construction des Centres de Santé Mentale (2), comme étape du processus de dé-
institutionnalisation (Fig. 1), ont posé le problème pratique et quotidien, au-delà du caractère
théorique, de la compréhension de la complexité des parcours et des modalités dans
lesquelles s'exprime la demande psychiatrique, et à l'intérieur de celle-ci la crise.
(2) Actuellement, le circuit psychiatrique à Trieste (280.000 habitants) est composé de 7
Centres de santé mentale (C.S.M.) opérant dans autant de zones de la ville, chacune
comprenant une population d'environ 40.000 habitants. A Trieste, l'hôpital psychiatriques n'est
plus fonctionnel. II héberge un peu plus de 200 personnes, dont 40 environ sont infirmes ou
alités et 160 son hébergées en petits groupes familiaux avec une assistance paramédicale
limitée aux heures diurnes. Depuis mars 1980, a été créé, dans l'hôpital civile, le "Service
psychiatrique de diagnostic et de soins» (S.P.D.S.), mieux défini dans notre cas comme
"Service d'urgence psychiatrique" (S.U.P.) doté de 8 lits, qui remplit les fonctions de garde
psychiatrique et de "tri". Le patient envoyé par l'hôpital général est confié, après avoir reçu les
premiers traitements éventuels, au Centre territorial de référence; durant les heures nocturnes
uniquement, il peut Atre hébergé au S.U.P., pour Atre ensuite envoyé au Service territorial le
lendemain.
Dans la ville sont dispersés 21 appartements communautaires qui accueillent environ 130
personnes. Des coopératives de travail (3 jusqu'à présent) se sont constituées et sont
finalisées à l'occupation de patients et d'autres jeunes marginaux, proposant des travaux de
nettoyage, de construction, d'agriculture et la gestion des ateliers de théâtre, musique,
peinture, menuiserie, couture, enregistrement-vidéo, graphisme, loisirs. Les coopératives nées
en opposition à l'ergothérapie des asiles, associent aujourd'hui environ 200 travailleurs et
garantissent une rémunération respectant la législation du travail national.
Depuis 1980, les Services de santé mentale Interviennent également à l'intérieur de la
prison de Trieste dans le but de suivre des détenus déjà psychiatrisés ou de nouveaux
patients qui en font la demande. II leur est proposé des programmes thérapeutiques et de
réinsertion sociale, ainsi que des mesures alternatives à la détention. L'objectif prioritaire est
de prévenir les envois à l'hôpital psychiatrique judiciaire (équivalent de nos établissements de
défense sociale). Nous rappelons que dans la province de Trieste, il n'existe pas de maisons
de traitement privées et la clinique psychiatrique universitaire dispose de 40 lits. Depuis
l'entrée en vigueur de la loi 180, les T.S.O. (traitements sanitaires obligatoires) ont été
jusqu'en 1988, au nombre de 31 (3,7 par an), pris en charge dans 70% des cas à partir des
C.S.M. et dans 30% des cas par le S.U.P..
Les patients, citoyens de Trieste, envoyés dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires sont
passés de 10 en 1979 à 1 en 1985. Actuellement, seuls 3 triestins sont internés dans les
hôpitaux psychiatriques judiciaires de toute l'Italie. Une telle organisation des Services s'est
développée au cours des 15 dernières années à partir du travail de transformation de l'hôpital
psychiatrique triestin qui hébergeait, en 1979, 1.200 patients. Tout le personnel médical et
paramédical, travaillant avant au sein de l'hôpital, a été transféré progressivement, à partir de
1975, sur le territoire, en se réqualifiant et en contribuant à former la structure organisatrice
actuelle.
4

En termes concrets: le Service est limité à une aire territoriale d'intervention bien définie et
de petite taille. II s'est organisé pour pouvoir accueillir toute demande, ailleurs qualifiées de
psychiatrique, en éliminant les filtres bureaucratiques et administratifs et en favorisant les
modalités d'accès les plus variées et informelles, sans aucune intention de sélection et donc
de renvoi.
Ainsi situé, le Service de santé mentale est le point central de cette aire territoriale
clairement définie. II est le lieu d'observation privilégié, capable de développer une
observation interactive qui s'étend dans un espace fini, mais extrêmement complexe et
articulé. On y trouve tout ce qu'une population produit en terme de pathologie, de malaise, de
conflit et de perturbation sociale. II se projette de façon linéaire et constante dans le temps
suivant les histoires, les vécus personnels, l'évolution du territoire et de sa population, en
modifiant dialectiquement les réponses offertes.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%