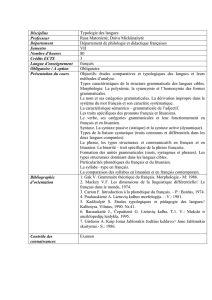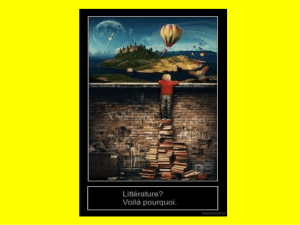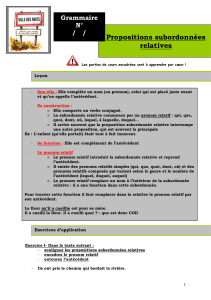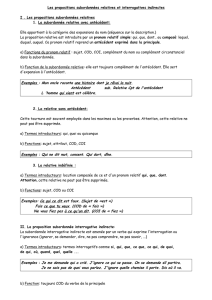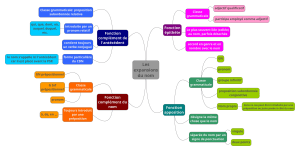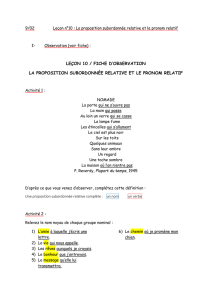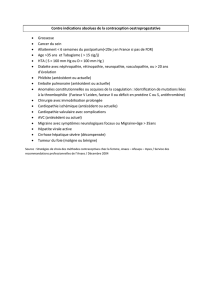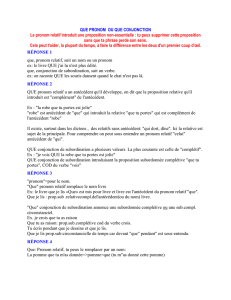Fonctionnement des phrases à la à la subordonnée relative en

50
Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative
en français et en lituanien
Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos
prancūzų ir lietuvių kalbose
Santrauka
Summary
�albot yra
Fonctionnement des phrases à laà la
subordonnée relative en français et
en lituanien
Sudėtinių prijungiamųjų
pažyminio sakinių funkcijos
prancūzų ir lietuvių kalbose
Lietuvos edukologijos universitetas
Straipsnyje nagrinėjami sudėtiniai prijungiamieji
pažyminio sakiniai prancūzų ir lietuvių kalbose. Nau-
dojantis aprašomuoju-lyginamuoju metodu tiriamos
teorinės šio reiškinio charakteristikos abiejose kal-
bose. Tiek lietuvių, tiek prancūzų kalbose šalutinio
pažyminio sakinio pagrindinis elementas yra santy-
kinis įvardis, prancūzų kalboje šie sakiniai todėl ir
vadinami santykiniais. Lietuvių kalboje – pažyminio
šalutiniais sakiniais, t.y. pagal jų funkciją. Abiejose
kalbose šalutinių pažyminio sakinių skirstymas pagal
jų referencinę prasmę (sens référentiel) sutampa.
Prancūzų lingvistikoje jie skirstomi į pažymimuosius
(déterminatives) ir paaiškinamuosius (explicatives).
Tiriant prancūzų autorių kūrinius ir jų vertimus į
lietuvių kalbą atsiranda struktūrinių skirtumų: skiriasi
atraminio žodžio pažyminių vieta pagrindiniame
sakinyje. Taip pat keičiasi sudėtinio prijungiamojo
sakinio struktūra: išnykus antrajam predikaciniam
vienetui jis virsta paprastu sakiniu. Be to, šalutinis
sakinys gali virsti ir savarankišku sakiniu. Semanti-
nių skirtumų nedaug: abiejose kalbose šalutiniai pa-
žyminio sakiniai turi ir aplinkybių (laiko, priežasties,
vietos) niuansų, kurie prancūzų kalboje yra impliciti-
niai, o lietuvių kalboje turi eksplicitinę raišką.
Skyryba prancūzų kalboje nėra tiksliai apibrėžta,
lietuvių kalboje šalutinis sakinys visada atskiriamas
kableliu.
Esminiai žodžiai:
paaiškinamasis šalutinis sakinys, implicitinis, eks-
plicitinis, skyryba.
Functions of complex attributive sentences in French and Lithuanian
The article analyses complex attributive sentences
in the French and Lithuanian languages. Theoretical
characteristics of this phenomenon in both languages
are investigated applying the descriptive-comparative
method. Both in Lithuanian and French, the main ele-
ment of the attributive clause is a relative pronoun;
therefore, in the French language these clauses are
called relative clauses. In the Lithuanian language,
according to their function, these clauses are called
attributive clauses. According to their referential
meaning (sens référentiel), the division of attributive
clauses coincides in both languages. In French linguis-
tics, they are divided into determinative (détermina-
tives) and explicative (explicatives) clauses.
The analysis of the works of French authors and
their translation into Lithuanian showed certain struc-
tural differences, i.e. the place of the antecedent’s
attributes changes in the main clause. Also, there
appear some changes in the structure of a complex
sentence: when a second predication disappears, the
sentence turns into a simple sentence; in addition,
a subordinate clause may turn into an independent
sentence. From the semantic point of view, the differ-
ences are not numerous: in both languages attributive
subordinate clauses manifest some nuances of adver-
bial clauses (time, reason, place), which are implicitly
expressed in the French language while their expres-
sion in the Lithuanian language is explicit.
The punctuation of attributive clauses is rather
lenient in French while in the Lithuanian language
a subordinate clause is always separated by a
comma.
Key words: antecedent, subordinate determinative/

žmogus ir žodis 2011 III
ISSN 1392-8600
51
�albot yra
I. Introduction
La subordonnée relative est traitée différemment
dans les diverses approches normatives notamment
les grammaires dites de référence au niveau des
typologies, mais aussi au niveau du sémantisme
des relatives. Plusieurs critères peuvent être adoptés
dans la description de ce phénomène linguistique.
Cette diversité des points de vue fait l’objet de notre
étude dans la mesure où il en résulte des divergen-
ces dans la typologie proposée par les différents
linguistes.
Le but de l’article serait de faire un aperçu ty-
pologique-descriptif des relatives en français et en
lituanien et de faire ressortir les ressemblances et les
différences du fonctionnement de ce phénomène dans
les deux langues cibles.
Notre étude sous-jacente portera sur les exemples
tirés des œuvres de Ch. Baudelaire, H. Bazin, A.
Rimbaud et leurs traductions en lituanien.
Les méthodes descriptive et comparative seront
appliquées à l’étude des phénomènes mentionnés.
II. Aperçu théorique et analyse des
relatives
Tous les linguistes afrment que les propositions
relatives sont des propositions subordonnées qui sont
introduites par un pronom relatif. Ainsi A. Hamon
(1991, 112) écrit «L’étude de la subordonnée relative
est inséparable de celle du pronom (ou de l’adjectif)
relatifs lequel la relie à la proposition dont elle dé-
pend par intermédiaire de son antécédent».
Le français dispose de deux séries de formes des
pronoms relatifs. F. Deloffre (1979, 55) indique:
- une série héréditaire, remontant au latin: qui,
que, dont, où.
- une série plus tardive formée à l’aide de l’article
déni et de l’interrogatif quel – lequel/ lesquels/
quelle/ laquelle/ lesquelles.
Selon P. Charaudeau (1992, 335) la construction
relative utilise des mots «traditionnellement appe-
lés adjectifs (ou pronoms) relatifs. Lequel est le
seul relatif à décliner les catégories de genre et de
nombre et à présenter les formes propositionnelles
contractées: lequel, duquel etc.» L. Tesnière (1969,
560) précise: «Le pronom relatif est un mot à nature
double composé de deux éléments syntaxiques fon-
dus ensemble:
- il introduit la relative dont il constitue l’opérateur
de subordination ou subordonnant,
- il a une fonction indépendante à l’intérieur de
la subordonnée».
Il remarque que la proposition subordonnée rela-
tive «a pour marquant un translatif dont la forme est
souvent symétrique de celle de l’antécédent et qu’on
appelle le subséquent».
C’est le plus souvent pour les raisons fonction-
nelles que les grammairiens ont proposé cette iden-
tication de la relative avec l’adjectif. Ces relatives
sont donc dites adjectives parce qu’elles fonction-
nent comme des adjectifs épithètes. Les relatives
adjectives possèdent un antécédent et exercent la
fonction d’épithète liée, d’épithète détachée, ou plus
rarement d’attribut. Pour distinguer les relatives des
autres subordonnées que peut contenir un syntagme
nominal on précise que les relatives adjectives «sont
assimilables à des adjectifs ou à des participes actifs»
(Touratier, 1980, 23).
La plupart des grammairiens français (Riegel,
Hamon, Arrivé) à côté des propositions relatives
nommées adjectives distinguent les relatives subs-
tantives où le pronom qui les a introduites n’a pas
d’antécédent et ce n’est donc pas anaphorique. C’est
la relative elle-même qui donne un contenu référen-
tiel au pronom relatif.
Par exemple: J’aime qui m’aime.
Qui se fait brébis, le loup le mange.
C’est par rapport au groupe nominal dont la rela-
tive est l’expansion que se pose le problème du sens
référentiel de la relative:
- elle est déterminative si elle est nécessaire à
l’identication référentielle de l’antécédent.
- la relative est explicative lorsqu’elle ne joue
aucun rôle dans l’identication référentielle de l’an-
técédent (Riegel, 1994, 483).
M. Grevisse (1993, 270) et Ch. Touratier (1980,
239–386) partagent cette opinion. La majorité des
grammairiens russes ayant étudié les relatives en
français (Steinberg, Basmanova, Référovskaïa,
Vassiliéva, Pitskova, Gak) distinguent ces deux types
sémantiques des relatives.
Sans prétendre à une analyse typologique exhaus-
tive des relatives en lituanien nous devrions présenter
les caractéristiques de ce phénomène, qu’on appelle
le plus souvent subordonnée d’épithète. De même
qu’en français les relatives sont formées à l’aide des
pronoms relatifs kuris, kuri, koks, kokia, kas qui sont
parfois remplacés par les mots conjonctifs kada, kai,
kur. Dans les phrases aux relatives le rapport séman-
tique entre les deux parties de prédication est très
proche. D’après les caractéristiques de l’antécédent
et ses rapports avec la subordonnée on distingue:
- les relatives substantives;
- les relatives pronominales (Dabartinė lietuvių
kalbos gramatika, 2005, 674).

52
Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative
en français et en lituanien
Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos
prancūzų ir lietuvių kalbose
Les relatives substantives déterminent les substan-
tifs ou les mots qui les remplacent (adjectifs, adjectifs
numéraux). «L’antécédent peut être n’importe quel
terme de proposition» (Labutis, 1998, 50). Comme
le lituanien est une langue synthétique et le substantif
ainsi que le pronom expriment la même notion et ont la
catégorie de nombre et de genre, l’accord de ces deux
éléments est le plus souvent obligatoire. Parfois les cas
de l’antécédent peuvent ne pas coïncider. Par exemple:
dainelę, kurios vakar nedainavom.
L’antécédent est à l’accusatif et le relatif au génitif.
Le pronom relatif peut être employé avec une prépo-
sition. La grammaire académique d’après le caractère
du rapport de la relative avec l’antécédent distingue
les relatives adjectives. «Les relatives adjectives
sont liées au substantif de la proposition principale
de la même manière que l’adjectif» (Lietuvių kalbos
gramatika, T. 3, 1976). Et les relatives pronominales
sont liées aux pronoms démonstratifs de la proposition
principale: šitas, kuris (celui... qui), etc. La subordon-
née pronominale parfois précède la principale. Par
exemple: Kas galvoj, tas ir kalboj.
L’analyse des phrases aux subordonées relatives
françaises et leur traduction en lituanien fait ressortir
des phénomènes identiques aussi bien que différents.
La plupart des ces phrases ont la même structure et
le même sens dans les deux langues:
Par exemple: 1. La joie calme où s’ébaudissait
mon âme avant d’avoir vu ces petits hommes avait
totalement disparu. (Baudelaire, 80)
kuriuo prieš sutikdama šiuos
(Baudelaire, 81)
2. Je suis de la race qui chantait dans le supplice.
(Rimbaud, 18)
Aš priklausau rasei, kuri giedojo kankinama.
(Rimbaud, 19)
3. que
nous voulons mimer. (Baudelaire, 12)
kuriuos
(Baudelaire, 13)
4. Il y a des choses dont je n’ai jamais aimé parler
(Camus, 12)
apie kuriuos
(Kamiu, 16)
Toutefois l’analyse des phrases aux relatives dans
les deux langues cibles a fait ressortir quelques dif-
férences structurales.
1. L’ordre des mots dans la proposition principale
où le nom-antécédent a des compléments différents:
si en français les compléments du nom le suivent, en
lituanien les compléments du nom le précèdent et la
relative suit immédiatement l’antécédent.
Par exemple: 1. L’histoire de mon amour ressem-
ble à un voyage sur une surface pure et polie comme
un miroir vertigineusement monotone, qui aurait
.... (Baudelaire, 244)
-
niu kaip veidrodis paviršiumi, kuris
mano jausmus. (Baudelaire, 245)
2. Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours
héroïque, elle fait penser à ces chevaux de grande
race que l’oeil du véritable amateur reconnaît.
(Baudelaire, 230)
rasės
žirgą, kurį (Baudelaire,
231)
2. Il y a des cas où la subordonnée relative perd
son pronom relatif et en même temps dans la phrase
il n’y a plus de deuxième prédication que L. Tes-
nière appelait «la translation du second degré» et en
lituanien cette phrase se transforme en proposition
simple.
Par exemple: 1. Tels étaient les insupportables re-
frains qui sortaient de cette bouche. (Baudelaire, 23)
liejosi iš jo bur-
nos. (Baudelaire, 239)
qui
s’étonne et qui rit à tout ce qui reluit. (Baudelaire,
174)
ats-
pindistebis, šypsosi po to. (Baudelaire, 174)
Dans le dernier exemple les trois relatives devien-
nent prédicats homogènes, exprimés par le verbe au
présent.
Dans les phrases où en lituanien il ne reste plus
de relative, la forme personnelle du verbe de la
proposition subordonnée peut se transformer en
participe présent:
Par exemple: 1. Un homme qui veut se mutiler est
bien damné, n’est-ce pas? (Baudelaire, 26)
norįs save suluošinti, tikrai pasmerktas,
ar ne? (Baudelaire, 27)
2. J’aime les nuages...les nuages qui passent...là-
(Baudelaire, 10)
Aš myliu debesis... praplaukiančius debesis...te-
nai...tenai...tuos nuostabius debesis. (Baudelaire, 11)
Le verbe de la relative en lituanien devient ad-
jectif.
Par exemple: 1. Il est une contrée qui te ressem-
ble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête.
(Baudelaire, 90)
panaši
ramu ir dora. (Baudelaire, 91)

žmogus ir žodis 2011 III
ISSN 1392-8600
53
�albot yra
2.qui me ressemble plus
que toi. (Bazin, 61)
esi labiausiai panašus (Ba-
zenas, 44)
Le participe passé remplace les formes person-
nelles du verbe de la relative.
Par exemple: 1. Mon père, qui avait fait la guerre,
ne dut avoir peur que les premiers jours. (Bazin, 60)
dalyvavęs
pirmosiomis dienomis. (Bazenas, 43)
2. ont crucifié.
(Rimbaud, 70)
nukryžiavusių. (Rim-
baud, 71)
3. Les rapports de la subordonnée relative ex-
plicative avec la proposition principale étant assez
faibles, elle «s’éloigne» de son antécédent perd son
pronom relatif et devient phrase indépéndante – la
phrase à subordination se transforme en phrase
à coordination.
Par exemple: 1. Il n’en a pour longtemps, l’abbé
chose, dont le nom ne marque pas dans ma mémoire.
(Bazin, 55)
(Bazenas, 39)
2. Elle...s’effondre dans les bras du séminariste
qui (Bazin, 56)
(Bazenas, 40)
3. Son acte de naissance était toujours orné d’une
pétale de rose, qu’avait collé sa maman. (Bazin, 87)
(Bazenas, 71)
Bien que séparées de ponctuation différente (tiret,
point, deux points) les deux parties prédicatives, des
phrases citées sont relativement indépendantes.
Il y a des cas où l’ex-relative acquiert une conjonc-
tion de coordination:
Par exemple: Templerot se souciait fort peu de
qu’il devait imaginer autoritaire,
rude, mais certainement bonne épouse et bonne
mère (Bazin, 90)
bet
(Bazenas, 68)
R.-L. Wagner et J. Pinchon (1988, 605) indiquent
que la relative-circonstancielle est séparée de son
antécédent par une pause légère et se distingue ainsi
d’une relative épithète. M. Riegel (1994, 488) consi-
dère que «les relatives explicatives ou accidentelles
peuvent apporter des nuances circonstancielles
diverses». Selon E. Référovskaïa et A.Vassiliéva
(1983, 78) les liens entre deux propositions de la
phrase «semblent plus évidents s’il y a une nuance
de cause, de conséquence, de concession».
Par exemple: -
-
heur qu’ils n’aient pu comprendre. (Rimbaud, 18)
(Rimbaud, 19) (parce qu’ils ne pouvaient pas com-
prendre – cause).
J. Dubois (1956, 263) indique que «le verbe de
la relative qui exprime la conséquence est au sub-
jonctif».
En lituanien les rapports circonstantiels peuvent
être présentés de manière explicite. (conjonction nes
= parce que).
Par exemple: Nous négligeons le port, dont les ac-
tivités sont sales et peu intellectuelles. (Bazin, 71)
nes jo veikla nešvari ir
nelabai intelektuali. (Bazenas, 71)
Le même pronom relatif dont devient l’adverbe
quand = kai et la relative exprime le temps.
Par exemple: J’aime le souvenir de ces époques
nues,
Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues.
(Baudelaire, 34)
Kai ( Bau-
delaire, 18)
Le syncrétisme de où, qui est tantôt considéré
comme adverbe (de lieu ou de temps), provoque les
interpétations différentes des subordonnées introdui-
tes par ce pronom / adverbe. Ainsi K. Sanfeld (1965)
note, que les propositions relatives introduites par où
sont essentiellement des propositions de lieu. Selon
E. Référovskaïa (1988) où rend un rapport nettement
temporel dans le cas où il est lié avec antécédent
marquant un point ou un laps de temps. «La valeur
lexicale de l’antécédent qui régit la proposition re-
lative introduite par où ne peut pas être limitée par
le lieu et le temps», afrment A. Basmanova (1986)
et N. Steinberg (1972) ce que conrme l’analyse
des relatives:
Par exemple: L’étude du beau est un duel où
l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. (Bau-
delaire, 16)
dvikova, kurioje menininkas
. (Baude-
laire, 17)
Le pronom relatif où est traduit en lituanien ku-
rioje = qui mais le nom antécédent est au locatif.
Toutefois le plus souvent où garde sa signication
de temps ou de lieu.

54
Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative
en français et en lituanien
Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos
prancūzų ir lietuvių kalbose
Par exemple : 1. Rêvais-tu de ces jours si brillants
où tu vins pour remplir l’éternelle pro-
messe. (Baudelaire, 237)
Vaidenas tau, dienų kai
(Baudelaire, 202)
2. Dans un grenier où
j’ai connu le monde. (A. Rimbaud, 98)
Palėpėj, kur
(Rimbaud, 99 )
3. Il faut vous dire que l’Ommée, dès qu’elle sort
du parc où-
serre sous le dôme de ronces...(Bazin, 110 )
Reikia jums paaiškinti, kad už parko kur
(Bazenas, 84)
Les relatives dites pronominales en lituanien
correspondraient à celles du français dont l’antécé-
dent est représenté par le pronom celui. Le pronom
démonstratif celui (celle) qui joue le rôle d’antécé-
dent est étroitement lié à la subordonnée, sans l’appui
de laquelle l’équilibre sémantique et grammatical de
la phrase serait ébranlé:
Par exemple: 1. Mais celle qui l´a élevé – non sans
efforcer, parfois, – c´est Bertille... (Bazin, 341)
toji, kuri
(Bazenas, 263)
2. ceux qui errent
solitaires... (Baudelaire, 288)
Aš dainuoju nelaimingus šunis, tuos, kurie vieniši
(Baudelaire, 289)
3. Celle que
dernier type ... (Bazin, 337)
Tasai, kurį
tik toks... (Bazenas, 260)
Le pronom démonstratif prend le genre du terme
qui lui sert de référent. Le plus souvent en lituanien la
structure des phrases mentionnées correspond à celle
du français, leurs sens ne diffère pas très nettement,
bien qu’il y ait des cas où les lois des transformations,
présentées ci-dessus puissent les modier.
La ponctuation des relatives en français n’est pas
très nettement dénie. Selon Ch. Touratier (1980,
271) la règle de ponctuation concernant les subor-
données relatives doit être nuancée: «Ne serait-il plus
juste en effet de dire que le français ne met jamais de
virgule avant une relative déterminative et tend en
mettre une devant une relative explicative».
Tandis que le lituanien sépare d’une virgule toutes
les subordonnées, les relatives y compris.
III. Conclusion
- la dénition et la classication dans les deux
langues cibles ne diffère que de quelques termes
(relative – d’épithète).
- l’analyse des textes français et de leur traduction
en lituanien a fait voir des différences structurales:
place des compléments de l’antécédent, transforma-
tion de la phrase à subordination en phrase simple et
en phrase à coordination.
- la sémantique des relatives dans les deux langues
n’est pas différente: les nuances circonstantielles sont
propres au français ainsi qu’au lituanien; ces nuances
sémantiques en lituanien parfois se manifestent de
manière explicite: conjonctions, cas des noms ou
des pronoms.
Bibliographie
Arrivé M., Gaget F., Galmiche M., 1986, La grammaire
d’aujourd’hui. – Paris: Flammarion.
Balkevičius J., 1963, .
– Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės
literatūros leidykla.
Basmanova A., Tarassova A., 1986,
. – Moscou: Vyschaja shkola.– Moscou: Vyschaja shkola. Moscou: Vyschaja shkola.
Charaudeau P., 1992, .
– Paris: Hachette. Education.: Hachette. Education.
, 2005. – Vilnius:
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
Deloffre F., 1979, . – Paris: Sèdes.
Dubois J., Jouannon R., Lagane R., 1961,
. – Paris: Librairie Larousse.– Paris: Librairie Larousse. Paris: Librairie Larousse.
Grevisse M., Goosse A., 1993,
. – Paris: Boeck Duculot. – Paris: Boeck Duculot. Paris: Boeck Duculot.
Hamon A., 1991,
logique. – Paris: Hachette. Paris: Hachette.Paris: Hachette.
Labutis V., 1998, . – Vilnius:
Vilniaus universitetas.
, III t. – Vilnius:
Mokslas, 1976.
Référovskaïa E., Vassiliéva A., 1983, Essai de grammaire
théorique. – Moscou: Prosveshchenye.
Riegel M., Pellat J., Rioul K., 1994,
. – Paris: PUF.
Sanfeld K., 1965, , vol.
II. – Genève: Proz.
Steinberg N., 1972, vol. II. Syntaxe.
– Léningrad: Prosveshchenye.
Tesnière L., 1959, . – Paris: Paris:Paris:
Librairie C. Klincksieck.
 6
6
1
/
6
100%