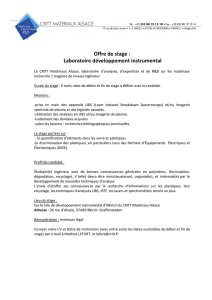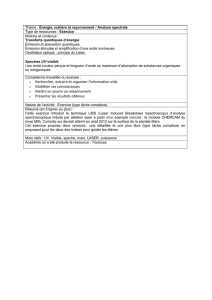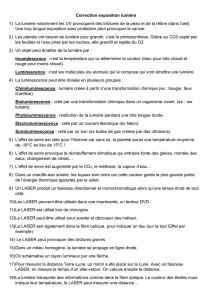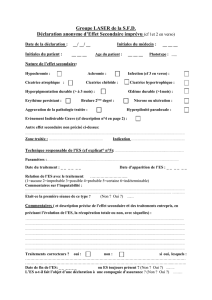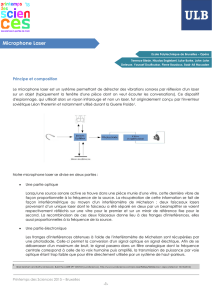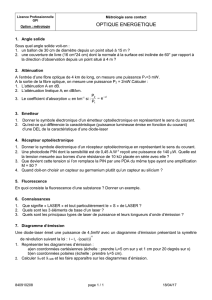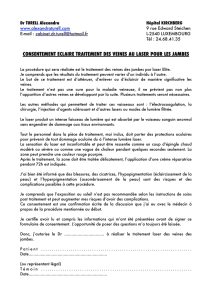La spectroscopie d`émission optique sur plasma

TECHNIQUE INSTRUMENTALE
42 SPECTRA ANALYSE n° 261 • Avril - Mai 2008
Instrument
Jean-Luc LACOUR1, ■, Denis MENUT1, ❑, Daniel L’HERMITE1, ●, Laurent SALMON1, ❍, Patrick MAUCHIEN1, ◆
1 Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay – DEN/DPC/SCP/LRSI – Bât. 391 – 91191 Gif-sur-Yvette – Tél. : 01 69 08 77 43
■ E-Mail : [email protected] – ❑ E-Mail : denis[email protected] – ● E-Mail : daniel.lhermite@cea.fr – ❍ E-Mail : laurent[email protected]
◆ E-Mail : [email protected]
La spectroscopie d’émission optique
sur plasma produit par laser pour
l’analyse élémentaire (LIBS)
RÉSUMÉ
La LIBS (acronyme anglais de Laser Induced Breakdown Spectrometry) est une technique
d’analyse chimique multi élémentaire basée sur la spectrométrie d’émission d’un plasma formé
par focalisation d’un faisceau laser pulsé sur une cible. La mesure, entièrement fondée sur
l’utilisation de rayonnements optiques, peut s’eff ectuer sans contact sur tout type de matériau,
solide, liquide ou gazeux, et permet de réaliser des analyses très rapidement (d’une dizaine
à quelques milliers de mesures par seconde) jusqu’à plusieurs mètres de distance ou des
analyses en milieu confi né au travers d’un hublot. La possibilité de focaliser fortement le laser
ouvre le champ aux analyses très localisées (microanalyse) et à la cartographie élémentaire de
surface. Cet article présente les bases de la technique ainsi que des applications illustrant ses
performances.
MOTS-CLÉS
Ablation laser, LIBS, analyse, cartographie, analyse in situ, analyse à distance.
Laser Induced Breakdown Spectrometry a tool for elemental analysis
SUMMARY
Laser Induced Breakdown Spectrometry (LIBS) is an analytical technique based on the measurement of the light
emitted from a plasma produced during interaction of a pulsed laser beam on the sample. It can be a solid, liquid
or gas. The main interest of LIBS is that the entirely optical measurement process allows real time in-situ analysis
even in a confi ned environment through a window. Moreover, focusing the laser beam on very small spot gives the
possibility of localized analysis with elemental mapping of surface. This paper presents the basics of the technique
as well as applications that illustrate its performances.
KEYWORDS
Laser ablation, LIBS, analysis, cartography, in situ analysis, stand off analysis.
I - Introduction
La possibilité d’utiliser un laser pour réaliser une
analyse chimique par spectroscopie d’émission a
été démontrée dès 1963 (1, 2) en France par Jeanine
Debras-Guedon et Nicole Liodec, peu après l’ob-
tention du premier plasma produit par laser (1, 3)
et la réalisation du premier laser (1, 4, 5) en 1960.
Le développement de la technique LIBS est resté
très longtemps dépendant des progrès réalisés sur
les lasers. Il n’a réellement pris son essor qu’à par-
tir des années 1980, avec la commercialisation de
lasers plus simples d’utilisation et plus fi ables. De-
puis, de nombreuses applications ont fait l’objet
de travaux de recherche et de publications : tri de
métaux, analyse de roches ou d’inclusions fl uides,
analyses de matières plastiques, … L’apparition
récente de sociétés industrialisant des systèmes
LIBS a amorcé une nouvelle phase en favorisant le
transfert vers l’industrie des développements ini-
tiés en laboratoire. Cette étape, tirée par le besoin,
marque un tournant et devrait amener à position-
ner la technique sur les créneaux pour lesquels ses
avantages intrinsèques sont déterminants.
La LIBS présente en eff et des caractéristiques très
intéressantes voire uniques. Technique entière-

Technique instrumentale
43
SPECTRA ANALYSE n° 261 • Avril - Mai 2008
La spectroscopie d’émission optique sur plasma produit
par laser pour l’analyse élémentaire (LIBS)
ment optique, la LIBS permet d’analyser rapide-
ment un échantillon, qu’il soit solide, liquide ou
gazeux sans nécessiter de prélèvement ou de pré-
paration préalable. Elle permet d’analyser simul-
tanément quasiment tous les éléments du tableau
périodique y compris les éléments légers et ce à
la cadence du laser. Elle est donc particulièrement
adaptée à l’analyse en temps réel, et à l’analyse en
milieu hostile (matériaux toxiques, hautes tem-
pératures, radioactifs…) pour laquelle le prélève-
ment et/ou la manipulation des échantillons est
diffi cile.
II - Principe de la LIBS
1. Un principe simple…
Réaliser une mesure en LIBS paraît simple : la
focalisation d’un faisceau laser pulsé sur le ma-
tériau à analyser avec une optique adaptée pour
atteindre un éclairement (Quantité de puissance
déposée par unité de surface, typiquement 2 à
5 GW/cm2 sont utilisés) supérieur au GW.cm-2
provoque un échauff ement brutal de la surface
éclairée et sa vaporisation sous forme d’un plasma
(fi gure 1). Les atomes et les ions éjectés et portés
dans des niveaux d’énergie excités émettent, en se
désexcitant, un spectre UV-Visible constitué de
raies atomiques, dont la longueur d’onde permet
d’identifi er les éléments présents et dont l’inten-
sité, proportionnelle au nombre d’atomes et d’ions
émetteurs, permettra de calculer leur concentra-
tion moyennant la mise en œuvre d’une méthode
d’étalonnage appropriée (fi gure 2).
2. Mais une physique complexe
Toutefois, la physique attenante est très complexe
et la maîtrise des nombreux paramètres qui ré-
gissent l’interaction laser-matière conditionne au
fi nal la qualité et la fi abilité des mesures.
La formation du plasma transitoire en expansion
rapide constitué d’ions, d’atomes et d’électrons
portés à très haute température (plusieurs milliers
de kelvin) dépend de nombreux paramètres, liés
au laser (durée d’impulsion, énergie, éclairement,
…), au système de focalisation, à l’atmosphère
(pression, type de gaz, …), à la nature de l’échan-
tillon. En début de vie (quelques centaines de na-
nosecondes) du plasma, le rayonnement lumineux
émis est essentiellement constitué d’un fond con-
tinu (continuum dû au rayonnement de corps noir
et à la recombinaison ions-électrons). Au cours du
refroidissement qui suit, le fond continu décroit
rapidement ce qui permet de détecter les raies
d’émission caractéristiques, provenant de la dé-
sexcitation des atomes et ions. L’équation présen-
tée dans l’Encadré I (voir page suivante) montre les
diff érents paramètres dont dépend l’intensité I des
raies d’émission. Elle est proportionnelle au facteur
instrumental F et au nombre d’espèces émettrices
Cs*N, N étant la quantité de matière vaporisée.
Elle dépend également de la température du plas-
ma (T) et des caractéristiques propres à chaque
raie des éléments (Aki, gk, Eki, λki, Us). L’intensité de
raies diminue au cours du temps au fur et à mesure
que le plasma se refroidit, de sorte que le rapport
signal sur fond est optimal pour un certain retard
après l’impulsion laser et pour une certaine durée
de mesure qu’il conviendra d’optimiser en fonc-
tion de la confi guration expérimentale. La Figure 3
illustre la dépendance temporelle de l’émission lu-
mineuse du plasma.
Figure 1
Formation du plasma.
Figure 2
Etalonnage du magnésium.
Figure 3
Evolution temporelle du signal du plasma.

TECHNIQUE INSTRUMENTALE
44 SPECTRA ANALYSE n° 261 • Avril - Mai 2008
III - Instrumentation et analyse
des données
Un dispositif expérimental d’analyse par LIBS est
constitué d’un laser pulsé, d’un dispositif optique per-
mettant la focalisation du laser et la collecte de la lu-
mière, d’un spectromètre optique équipé d’un détec-
teur et d’un générateur de retard (fi gure 4). Les lasers
solides de type « Nd:YAG » (Nd:YAG : Néodyme,
Yttrium Aluminium Garnet, il s’agit d’un cris-
tal d’aluminium Yttrium dopé au néodyme), les
couplages par fi bres optiques, les spectromètres
à échelle permettant l’exploitation simultanée de
la totalité du spectre sont à l’heure actuelle cou-
ramment utilisés. Pour la détection on peut utili-
ser une caméra CCD intensifi ée, le déclenchement
de l’intensifi cateur étant piloté par le générateur de
retard, synchronisé avec chaque tir laser. Les diff é-
rents paramètres du dispositif LIBS (éclairement
laser, fréquence de tir, délai de déclenchement de la
porte de mesure, gains de l’intensifi cateur, …) sont
optimisés en fonction du besoin (analyse locali-
sée ou pas, type de matériau, nombre d’éléments
à analyser simultanément, …). Des équipements
commerciaux LIBS complets sont aujourd’hui dis-
ponibles auprès d’une petite dizaine de sociétés ;
Applied Photonics (Skipton, Royaume-Uni), Ener-
gy Research Corporation (Danbury, Etats-Unis),
Foster & Freeman (Evesham, Royaume-Uni),
Kigre (Hilton Head, Etats-Unis), Ocean Optics
(Dunedin, Etats-Unis), Pharma laser (Boucher-
ville, Canada) et Ivea, une société française basée
à Gif-sur-Yvette et lauréate en 2005 du concours
OSEO ANVAR.
L’intensité I des raies d’émission dépend de la
quantité de matière vaporisée et de la température
du plasma (encadré I) qui varient avec la confi gu-
ration expérimentale et la matrice du matériau
étudié. Pour réaliser des mesures quantitatives, il
faut donc d’une part fi xer les conditions de me-
sure, mais également disposer d’échantillons re-
présentatifs pour la réalisation d’une droite d’éta-
lonnage. Réalisable en laboratoire, cet étalonnage
peut se révéler diffi cile, voire impossible, pour les
mesures de terrain avec une reproductibilité des
conditions de mesures insuffi sante et où il n’est
parfois plus possible de disposer des échantillons
étalons (matériaux analysés non connus a priori).
De nombreuses recherches relatives à des métho-
des tant expérimentales que théoriques sont me-
nées, notamment au CEA Saclay, pour lever ou
réduire cette contrainte.
La méthode la plus simple, largement utilisée par
ailleurs, consiste à normaliser l’intensité de la raie
de l’élément à analyser par celle d’un élément de
référence, généralement celui de la matrice. Cette
méthode simple, connue sous le nom d’étalonnage
interne, permet de compenser l’eff et du nombre
d’atomes vaporisés (N) qui dépend du faisceau
laser, du système de focalisation, des propriétés
thermophysiques du matériau ainsi que le facteur
instrumental (F). Lorsque la fenêtre spectrale du
détecteur permet d’accéder aux raies d’émission
optique de l’ensemble des éléments majoritaires
du matériau, un facteur correctif peut être appli-
qué pour que la somme des concentrations relati-
ves soit égale à 100 %. Ces méthodes, qui restent
des méthodes relatives, ne permettent cependant
pas de s’aff ranchir complètement d’un étalonnage.
Une approche connue sous le nom de « calibra-
tion free » (CF) a été proposée en 1999 (6). Basée
sur un modèle physique (Saha-Boltzmann) qui
permet de déterminer la densité électronique et
la température d’excitation du plasma, elle uti-
lise les données spectroscopiques disponibles
dans des tables, et nécessite une normalisation à
100 % pour s’aff ranchir du facteur instrumental.
Figure 4
Montage LIBS type,
Spectre et identifi cation
des éléments. Plasmas
formés à pression réduite
sur diff érents matériaux.
Iki : Intensité du signal à la longueur d’onde λki
CS : Fraction de l’espèce à mesurer
N : Nombre total d’atomes émetteurs
Aki : Probabilité de transition
gk : Niveau de dégénérescence
λki : Longueur d’onde émise
US() : Fonction de partition de l’espèce mesurée
Ek : Energie du niveau supérieur
k : Constante de Boltzmann
T : Température du plasma
F : Facteur instrumental
)(.
.
.....
)(
TU
eg
ANCFhcI
Ski
Tk
E
k
kiSki
k
λ
−
=
Encadré I
Paramètres infl uençant
l’intensité des raies
d’émission.

Technique instrumentale
45
SPECTRA ANALYSE n° 261 • Avril - Mai 2008
La spectroscopie d’émission optique sur plasma produit
par laser pour l’analyse élémentaire (LIBS)
Le résultat est cependant très dépendant de la
précision avec laquelle les paramètres physiques
(Us, Aik, gk) sont connus ainsi que de l’épaisseur opti-
que du plasma qui réduit l’intensité des raies d’émis-
sion du plasma pour les éléments à forte concentra-
tion dans le plasma.
Enfi n, la chimiométrie et les méthodes qu’elle met
en œuvre (analyse en composante principale, moin-
dres carrés partiels,…) (fi gure 5) constituent un outil
particulièrement utile en LIBS pour la classifi cation
et la reconnaissance de matériaux (nuance d’alliage,
pigments dans les œuvres d’arts, roche et minéraux
pour l’exploration planétaire, …) (7).
IV - Quelques applications
De part sa polyvalence, la LIBS est développée pour
des applications très diff érentes. Nous nous limite-
rons ici aux domaines pour lesquels son utilisation
semble la plus intéressante : l’analyse in situ en temps
réel et la microanalyse.
1. Analyses localisées et cartographies :
Microsonde LIBS
Un grand nombre de secteurs scientifi ques et indus-
triels (science des matériaux, géologie, biochimie…)
ont besoin de réaliser des analyses localisées d’un
échantillon, voire des cartographies, décrivant la dis-
tribution de la concentration des éléments à la surface
du matériau. En combinant un microscope optique
pour focaliser le rayonnement laser et le déplace-
ment micrométrique de l’échantillon entre chaque
tir, la LIBS permet d’obtenir une cartographie multi-
élémentaire quantitative sans nécessité de placer
l’échantillon sous pression réduite (particulièrement
utile par exemple pour les échantillons hydratés),
d’analyser indiff éremment des matériaux conduc-
teurs électriques ou isolants et ce très rapidement (20
points par secondes ou plus) (fi gure 6).
Les cartographies sont réalisées avec une résolution
de moins de 20 microns (jusqu’à 3 μm au CEA Sa-
clay soit moins d’une centaine de pico-grammes de
matière (8)). Cette technique innovante de microana-
lyse a été par exemple appliquée par le CEA Saclay
à l’étude de la diff usion de radionucléides dans l’argi-
lite du Callovo-Oxfordien, une roche envisagée pour
le stockage des déchets nucléaires de haute activité.
L’analyse simultanée des traceurs et des principaux
éléments constituant l’argilite, réalisée avec une réso-
lution latérale de 5 microns (9), a permis de localiser
le front de diff usion du traceur et de corréler les zones
de rétention avec la minéralogie locale du matériau.
Une modélisation inverse des profi ls de diff usion ex-
périmentaux a ensuite permis de déterminer les coef-
fi cients de partage relatif et de diff usion eff ectifs du
traceur. De plus, grâce à la résolution latérale et à la
sensibilité de détection de cette technique, des distan-
ces de migration de quelques millimètres sont suffi -
santes, ce qui permet de réduire considérablement
la durée des expériences de traçage (Figure 7).
Figure 5
Identifi cation de roche
par LIBS à l’aide de
l’analyse en composante
principale (ACP). Le
calcaire (limestone)
est clairement séparé,
l’axe PC 1 représentant
principalement l’eff et du
calcium.
Figure 6
Béton chargé au titane
(Résolution 10 μm).
Figure 7
Profi l de diff usion de l’Eu dans l’argilite du Callovo-Oxfordien. Les fl uctuations correspondent à des zones
de rétention sur des grains de minéraux.

TECHNIQUE INSTRUMENTALE
46 SPECTRA ANALYSE n° 261 • Avril - Mai 2008
2. Analyses de liquides par LIBS
La LIBS, technique « tout optique », permet
d’analyser in-situ des liquides à très hautes tem-
pératures (métaux ou sels fondus par exemple)
sans faire de prélèvement. La mesure est alors
effectuée à la surface du liquide placé dans un
four ou sur une coulée. Un autre exemple pour
lequel la LIBS peut s’avérer particulièrement in-
téressante est le cas d’analyses de liquides dans
des tuyauteries sous pression, y compris sous
haute température. L’utilisation du « tout opti-
que » permet d’accéder au milieu à analyser à
travers un hublot à la condition que la solution
soit transparente à la fois aux longueurs d’onde
du laser et de l’émission du plasma (ce qui est
par exemple le cas de l’eau). Cependant, dans
ce cas la densité du liquide nécessite d’utiliser
deux tirs laser synchronisés pour obtenir un si-
gnal (10-11). Le premier tir laser crée un volume
dans lequel le plasma formé par le deuxième tir
va pouvoir se développer (figure 8). Les perfor-
mances atteintes sont alors assez proches de
celles obtenues sur les solides et il est possible
de mesurer in-situ des concentrations de l’or-
dre de la ppm (Na : < 0,1 ppm, Ni : < 10 ppm) à
des pressions de l’ordre de 150 à 200 bars).
3. Analyse de terrain, pistolet LIBS
Généralement, la tête laser est intégrée dans
la tête d’analyse LIBS, ce qui pénalise énor-
mément la portabilité et l’encombrement, or,
l’analyse de terrain nécessite un appareil léger
et portatif. Une des solutions est de déporter la
tête laser de la tête d’analyse et de transporter
le faisceau laser au moyen d’une fibre optique
(figure 9). La difficulté est de faire transiter des
impulsions laser à forte puissance crête dans
une fibre optique sans la détériorer. Typique-
ment le seuil de dommage d’une fibre optique
est de 1 GW/cm². Malgré cette forte contrainte,
il a été possible de réaliser des systèmes LIBS
intégralement fibrés.
L’OFILIBS (pour Optical Fiber LIBS), commer-
cialisé par la société IVEA sous licence CEA
(figure 9), permet de réaliser des analyses dans
un rayon de quelques dizaines de mètres. Le
système est robuste car dépourvu de pièce
mobile. Il peut être porté à la main ou par un
bras télémanipulateur pour des applications
nucléaires. Les limites de détection obtenues
sont proches de celles obtenues avec un sys-
tème LIBS non fibré (1,5 ppm de Mg dans une
matrice Aluminium avec l’OFILIBS contre
0,8 ppm avec un système non fibré).
4. Exploration spatiale
L’exploration spatiale constitue un nouveau
domaine qui vient de s’ouvrir pour la LIBS. Sa
capacité à faire de la mesure à distance, à iden-
tifier les matériaux (Figure 5) et sa polyvalence
en font un outil de choix pour équiper les ro-
bots commandés à distance, ou « rovers », uti-
lisés pour l’exploration planétaire. C’est ce que
va permettre l’instrument ChemCam (NDR :
Le lecteur intéressé par ce sujet trouvera des
informations complémentaires aux adres-
ses suivantes : http://mars.jpl.nasa.gov/msl/ ;
http://chemcam.cesr.fr/ ; http://libs.lanl.gov/)
équipant le rover de la mission MSL (Mars
Science Laboratory, départ prévu pour la fin de
l’année 2009) de la NASA (figure 10) destiné à
analyser les roches martiennes. Ce sera le seul
instrument équipant le rover à pouvoir réaliser
des analyses à distance. Ici le grand intérêt est
de pouvoir, d’une part déterminer rapidement
Figure 9
Résultats avec un système LIBS entièrement fi bré. Une mesure est la moyenne de
20 points. En photo ; la tête d’ablation du prototype OFILIBS.
Figure 8
Formation d’une bulle par un premier tir laser, puis du plasma avec un second tir.
 6
6
1
/
6
100%