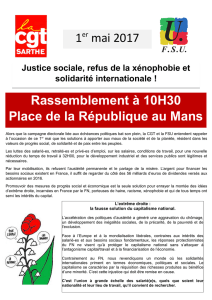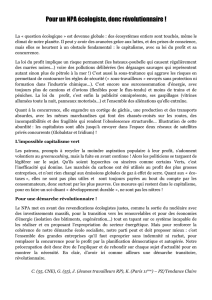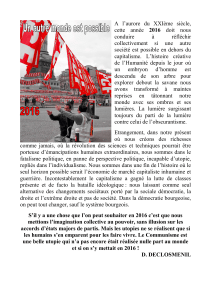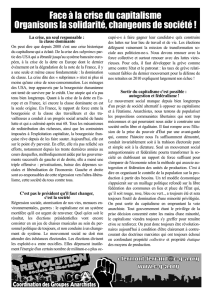La critique et la crise du capitalisme global

1
LA CRITIQUE ET LA CRISE DU CAPITALISME GLOBAL
Flávio Bezerra de Farias1
Introduction
Il s’agit ici de faire la critique de certaines approches économicistes de
la crise du capitalisme global qui se sont plus ou moins laissées influencer
par la thèse de la primauté des forces productives sur les rapports de
production, dans le cadre de la catégorie marxienne du mode de production
capitaliste. Ces approches s’éloignent de celle-ci dans la mesure où elles
soulignent la nature motrice tant des innovations financières du capitalisme
patrimonial que des technologies de l’information et de la communication du
capitalisme cognitif, au préjudice de la catégorie lutte de classes dans la
dynamique du capitalisme libéral contemporain. À partir de la configuration
historiciste régime d’accumulation, ces économistes prennent des points de
vue différents et se rapportent à la cohérence ou à la crise soit du
capitalisme global, lorsqu’ils deviennent réformistes (AGLIETTA et BERREBI,
2007; AGLIETTA, 2008), soit de la globalisation du capital, quand ils se font
radicaux (JOHSUA, 2006; 2009).
Pourtant, en tant que prolongement de la « crise de la nouvelle
économie », la « grande crise » actuelle « débouche à l’évidence sur un
autre monde dont nous ne pouvons pour l’instant que deviner les
contours. » (JOHSUA, 2009, p.126). Au lieu de mettre en place les « plans
de sauvetage » pour entrainer « la privatisation des profits et la
socialisation des pertes », la solution provisoire de la « grande crise du XXIe
siècle » exige, d’abord, « contrôler les finances » (Idem, p. 121 a 126).
Cependant, « en s’approfondissant, la crise elle-même montrera qu’on ne
peut s’en tenir à l’aspect financier, qu’il faut tout autant remodeler
l’économie réelle », sous la forme « d’un nouveau modèle de
développement », avec « planification » et « intervention » de l’État, dans
contexte de réforme et démocratisation des institutions internationales (p.
127 a 129). Pourtant, il s’agit plus de croire à la répétition de l’histoire des
formes capitalistes que d’affirmer la possibilité d’une grande transformation
1 Docteur d’État ès Sciences Économiques (Paris XIII). Professeur à l’Université
Fédérale du Maranhão (Brésil). flavio.bezerra1903@terra.com.br

2
sociale et historique, pour l’abolition de l’état de choses présent, en accord
avec les anticipations concrètes marxiennes.
Bien au contraire, tout en enfonçant le clou réformiste, le dépassement
positif de la grande crise du capitalisme global implique essentiellement la
modification tant dans les conditions structurelles du régime d’accumulation
que dans la nature de la régulation étatique et contractuelle néolibérale
(AGLIETTA, 2008, p.124). À plus long terme, il s’agit
« [...] de la fin du modèle de croissance fondé sur la montée inexorable de
l’endettement qui a été observé dans les vingt dernières années. Cette
période exceptionnelle a été due à la conjonction d’une gouvernance
d’entreprise tournée exclusivement vers la création de valeur pour
l’actionnaire en Occident qui a élargi démesurément les inégalités de revenus
et à une extension de la mondialisation après l’effondrement de l’URSS et la
montée des pays émergents qui a créé un marché du travail beaucoup plus
vaste avec un excès global de main d’œuvre. Parce que les évolutions des
salaires réels et de la productivité ont été déconnectées, la croissance dans
les pays développés, surtout dans les pays anglo-saxons où le phénomène a
été plus accentué, est venue de la baisse de l’épargne et de la consommation
à crédit. » (Idem, p.124).
À un degré distinct, ces deux formulations éclectiques portent la
marque de l’objectivisme, de la réification technoscientifique, etc. Bref, en
tant qu’idéologies fétichistes concernant l’ensemble de formes sociales et
historiques, elles peuvent servir pour exemplifier que « quand dans la
pensée du monde, l’être cesse de jouer son rôle de contrôle, tout devient
possible et tout ce qui est possible se réalise, du moment que cela arrange
les courants économiquement, socialement, politiquement puissants de
l’époque. » (LUKÁCS, 2009, p. 328). Les deux approches unilatérales de la
« praxis », alors qu’elle « désigne la vie de l’homme dans la totalité de leurs
déterminations réelles », ignorent « que le lien effectif grâce auquel cette
exigence de totalité peut être respectée c’est le fait de la historicité elle-
même » (CHATELET, 1972, p. 215).
Au lieu d’appliquer à l’échelle mondiale l’idée générale marxienne de
primauté de la base sur la superstructure, les deux courants historicistes
contribuent à ériger une économie politique de la globalisation, de manière
étroite, en tant que « discipline scientifique spécialisée », pour tenter de
« faire de l’objectivité des processus économiques une sorte de seconde

3
nature » (LUKÁCS, 2009, p. 389), qui détermine objectivement tout le reste
de la formation socioéconomique globale. Ne pas oublier le « devenir évite
le risque d’attribuer arbitrairement a une de ces dimensions un privilège
exorbitant, et garantit, d’une certaine manière, contre le dogmatisme
entrainé nécessairement par cet arbitre. » (CHATELET, 1972, p. 215).
C’est un penchant dogmatique, et comme auparavant « cette tendance
est également devenue prédominante dans la praxis scientifique
universitaire officielle » et, paradoxalement, certains courants
habituellement critiques de l’économie politique sont devenus « toujours
plus incapables de comprendre en termes ontologiquement corrects même
des moments partiels du processus global. » (LUKÁCS, 2009, p. 314).
Ce tout est perçu en tant que simple unité de parties conflictuelles,
mais régulables d’un procès sans sujet, au sein duquel les prolétaires a
priori ne constituent pas une classe décisive. D’ailleurs, la relation entre la
crise et la philosophie de l’histoire a été mise en évidence comme suit :
« Il appartient à la nature de la crise qu’une décision soit imminente, mais
qu’elle ne soit pas encore prise. Le fait que la décision qui sera prise reste
ouverte réside aussi dans sa nature. Pourtant, l’insécurité générale d’une
situation critique est traversée par la certitude selon laquelle, sans que l’on
sache avec certitude quand et comment, la fin de l’état critique est proche. La
solution possible reste incertaine, mais la fin elle-même, la transformation des
circonstances en vigueur – menaçante, peureuse ou désirée –, c’est sûre. La
crise invoque la demande au futur historique. » (KOSELLECK, 1999, p. 111).
Cependant, une approche « matérialiste et dialectique » saurait
premièrement « qu’il y a un penchant dangereux », chez l’historicisme qui
ne reconnait que des règles et des normes en particulier, « à faire
abstraction de l’action du sujet et à prendre les lois du monde social actuel
comme définitives et éternelles » (GOLDMANN, 1980, p. 23).
Deuxièmement, que « l’histoire est caractérisée par le fait que les lois
constitutives des sociétés humaines changent elles-mêmes avec le devenir
de ces sociétés. » (Idem, p.65).
Au contraire, pour le penchant économiciste et dogmatique, même s’il
s’agit d’une grande crise, elle ne serait capable d’offrir aux prolétaires la
« possibilité objective » d’une grande transformation sociale, en accord avec
ses intérêts spécifiques et suprêmes, pour « la réalisation historique » de

4
l’anticipation communiste, « qui ne peut exister qu’entre hommes
entièrement libres, communauté qui suppose la suppression de toutes les
entraves sociales, juridiques et économiques, à la liberté individuelle, la
suppression des classes sociales et de l’exploitation. » (p.14).
Pareillement aux révisionnistes du début du XXème siècle, « au lieu de
s’appuyer sur l’évolution telle qu’elle se présente actuellement, s’y
abstraient volontairement, pour rêver. » (LÉNINE, préface de 1915,
BUKHARIN, 1969, p. 15). Au début du XXème siècle, une fois niée au premier
abord une grande transformation sociale ayant pour référence
l’internationalisme socialiste, Aglietta et Berrebi (2007, p. 401) incarnent un
« esprit cosmopolitique », devant la crise économique globale. D’ailleurs,
avec ce même esprit, « les Nations Unies et les cours pénales
internationales se sont montrées incapables de garantir au monde une paix
stable et universale, on n’oserait pas le souhaiter pleinement » - car il s’agit
plutôt d’une utopie abstraite – « mais, seulement de conditionner un petit
peu la tendance des grandes puissances à utiliser ad libitum l’exorbitante
force militaire dont elles disposent. » (ZOLO, 2007, p. 19).
Au lieu d’adopter um idéal kantian démodé, dont le principal intérêt
téorique et politique réside dans le soutient du statu quo ante, il vaut mieu
aiguiser la pointe critique contre la régulation de la mondialisation. Étant
donné que la mondialisation impérialiste de la « Triade » entraîne la
déréglementation, la privatisation et la libéralisation, il s’agit d’un oximore
banal bien caractéristique des réformistes dans leur acceptation fataliste du
capitalisme global, au même temps qu’ils rejetent l’anticipation concrète
d’un monde meilleur qui passe par le socialisme. Ainsi, au lieu de devenir
une forme cosmopolite idéaliste, la mondialisation impérialiste « se produit
dans de telles conditions et à un rythme tel, de même que par
l’intermédiaire de tels antagonismes, conflits et convulsions – non
seulement économiques, mais aussi politiques, nationaux, etc. –», que
« l’impérialisme s’éfondra fatalement » (LÉNINE, préface de 1915,
BUKHARIN, 1969, p. 15), de sorte que le capitalisme soit enfin dépassé
dans un mouvement réel qui aboli effectivement l’état de choses présent.
Par contre, l’oximore de la régulation de la mondialisation a été créé
pour soutenir idéologiquement la pertinence de la raison techniciste, devant
l’échec large et catégorique du capitalisme libéral, y inclut sa base

5
historiquement déterminé. Sous le fétichisme de la primauté des forces
productives, on ne voit d’avenir que dans un régime qui n’ambitionne pas
de « refaire l’histoire par la base, mais seulement de la changer », il s’agit
donc du « régime qui devrait être cherché, au lieu d’entrer encore une fois
dans le cycle de la révolution. » (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 273, épilogue).
Avec la crise globale, il y a la mise en cause du « privilège spécifique du
capitalisme libéral » qui consiste à « s’exonérer de ses plus spectaculaires
échecs et de se rétablir sans cesse dans la position du modèle
indépassable. » (LORDON, 2008a, p. 119-120).
À partir de sa barricade d’idées, le régulacionisme suggère une
réforme dans cette configuration de la société bourgeoise, avec un retour
cosmopolite de l’interventionnisme, pour vaincre la bataille de la nouvelle
« grande crise » - en supposant qu’elle ne conduit pas nécessairement au
contexte de dépassement du capitalisme, mais « il désigne analytiquement
l’arrivée aux limites d’un régime d’accumulation et l’ouverture d’une phase
indécise qui verra la recomposition d’une nouvelle cohérence capitaliste. »
(LORDON, 2008b, p. 203).
Par contre, dans sa barricade d’idées le marxisme doit montrer la
possibilité sociale et la necessité historique du dépassement radical de la
société bourgeoise, en particulier dans le capitalisme libéral, dans l’époque
située au-delà du fordisme et dans la globalisation, qui porte la marque de
la réification planétaire. Au sens propre, devant la chosification
régulationniste, bureaucratique et impérialiste, on souligne l’importance de
l’actualisation da la problématique du sujet collectif révolutionnaire, dans le
mouvement réel qui aboli l’état des choses présent.
La crise globale et le retour de la régulation
La crise mondiale du capitalisme met en évidence le phénomène de la
persistance objective de la division capitaliste du travail liée de manière
organique à la subjectivité de la lutte de classes, tout en donnant de la
substance aux structures étatiques gouvernementales, qui sont en train
d’être transformées dans le crucial début du XXIe siècle, dans tous les
niveaux spatiaux, des locaux aux globaux. En même temps, l’échec de
l’idéologie néolibérale stimule souvent l’imagination holistique des partisans
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%