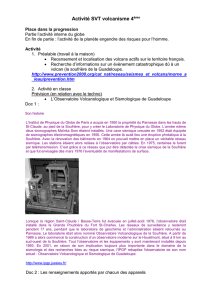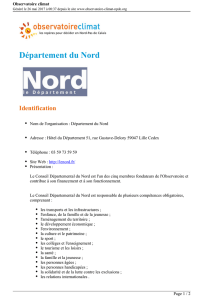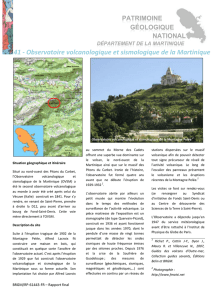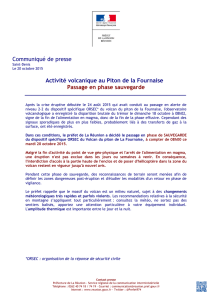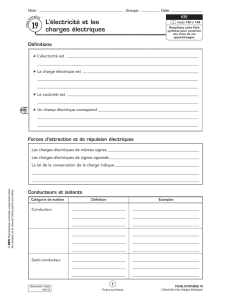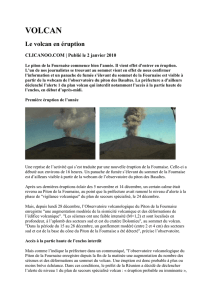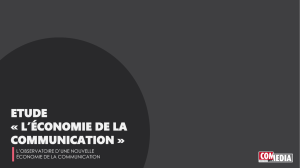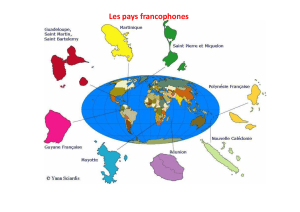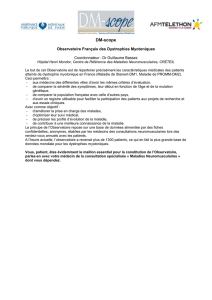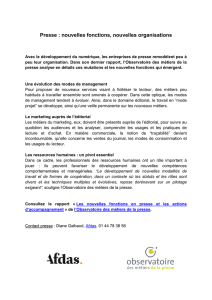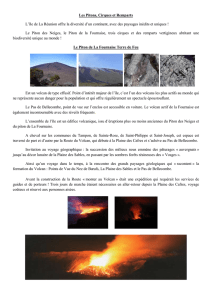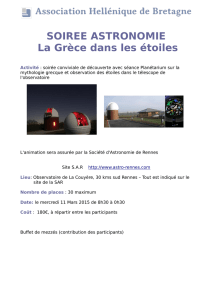Fiche pédagogique Collège/Lycée

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation
Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre
1
N°19 – OBSERVER LA TERRE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les documents suivants sont extraits du site des observatoires volcanologiques et
sismologiques de l’Institut de Physique du Globe de Paris de la Réunion, de la
Guadeloupe et de la Martinique : www.ipgp.fr/pages/0303.php
L’observatoire de la Réunion – OVPF
Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise
Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise
L’observatoire volcanologique du piton de La Fournaise fait partie de l’Institut de
Physique du Globe de Paris.
Ses missions
L’OVPF a deux missions principales : d’une part la recherche sur le fonctionnement
et l’évolution des volcans et, d’autre part, la surveillance de l’activité du piton de la
Fournaise notamment le suivi des éruptions et des coulées de laves. Le piton de la
Fournaise est probablement le volcan avec le plus grand nombre d’éruptions par an
dans le monde, dont 27 entre 1998 et 2007 et une moyenne de phase éruptive tous
les 9 mois. L’activité du piton de la Fournaise est surveillée 24h/24 par
l’observatoire volcanologique via plusieurs réseaux de surveillance et de recherche.
Si nous savons aujourd’hui prévoir les éruptions à long terme (plusieurs semaines),
il est encore impossible de prédire la date et l’heure précises. Étant donné son
intense activité, il est conseillé aux randonneurs de se renseigner au préalable, via
la presse, de l’état d’activité du volcan et de suivre les indications de l’ONF à
l’entrée du Pas-de-Bellecombe et sur le terrain. L’accès au cratère Dolomieu est
actuellement interdit par arrêté préfectoral en raison des risques d’effondrement de
ses parois.

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation
Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre
2
Son histoire
Depuis l’arrivée des premiers habitants permanents sur l’ile, des observations d’une
activité soutenue du volcan du piton de la Fournaise ont été signalées. Mais déjà au
XIIIe siècle, des marins arabes avaient rapporté des observations d’une ile à l’Est de
Madagascar où le feu jaillissait en permanence. Alfred Lacroix, en 1936, exprima le
souhait de l’installation d’un observatoire volcanologique pour l’étude du piton de la
Fournaise :
« Aucune observation instrumentale n’a été faite et il serait à souhaiter qu’un
sismographe fût installé à proximité du volcan pour enregistrer les mouvements
microsismiques qui accompagnent certainement la montée de la lave, lors des
paroxysmes. »
Seulement une quarantaine d’années plus tard, l’éruption hors enclos de 1977, qui
détruit partiellement Piton-Sainte-Rose fait avancer les choses. Les autorités, le
département, le CNRS décident de la construction d’un observatoire volcanologique
et confient sa gestion à l’Institut de Physique du Globe de Paris. L’observatoire est
opérationnel fin 1979. Il est situé à la plaine des Cafres, à 15 km à vol d’oiseau du
sommet du volcan, mais la transmission des données par radio permet une
surveillance en temps réel. Nous avons une cinquantaine de capteurs sur le massif
du piton de la Fournaise qui ont besoin d’un entretien et de réparations constantes.
Les réseaux de surveillance
Nous distinguons quatre réseaux différents avec une centaine d’instruments
installés sur le terrain :
– le réseau sismique ;
Réseau sismologique

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation
Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre
3
– le réseau des déformations avec les extensomètres, les récepteurs GPS, les
inclinomètres et les distancemètres laser ;
– les sondes radon ;
Réseau extensométrique
Réseau GPS
Réseau inclinométrique

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation
Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre
4
– le réseau magnétique.
Les réseaux fonctionnent en continu, 24h/24 et 365 jours par an. Ils sont dotés
d’environ 100 instruments pour 35 sites différents sur le massif du piton de la
Fournaise. Les instruments sont entretenus, réparés et constamment perfectionnés
par les techniciens, et le bon fonctionnement des réseaux est vérifié tous les jours
par le personnel de l’observatoire. Le flot de données enregistrées à l’observatoire
et dépouillées quotidiennement, a permis par le passé de prévoir toutes les
éruptions depuis la création de l’observatoire. L’analyse des données et les
recherches expérimentales menées à l’observatoire et à l’Institut de Physique du
Globe de Paris ont amélioré notre compréhension des mécanismes éruptifs des
volcans. En retour, ces connaissances ont servi à perfectionner les méthodes de
surveillance et les prévisions des éruptions.
L'observatoire de la Guadeloupe – OVSG
L’OVSG informe de l’activité volcanique et sismique grâce à ses bulletins mensuels
et signale les séismes ressentis en Guadeloupe ou autres évènements telluriques
particuliers dans la région par ses communiqués. L’observatoire met aussi à
disposition en temps quasi réel une photo de la Soufrière.
Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe
Ses missions
Les missions confiées à l’observatoire de Guadeloupe sont les suivantes :
1. Surveillance de l’activité volcanique de la Soufrière de Guadeloupe par le biais de
l’enregistrement de séries temporelles de données géophysiques et géochimiques
de qualité, complétées par des observations visuelles de la phénoménologie dans le
but de :
– comprendre le fonctionnement du volcan ;
– détecter un changement de comportement et l’évaluer en terme de potentiel
éruptif ;
Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, Le Houëlmont

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation
Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre
5
– informer les autorités responsables de la protection des personnes et des
biens.
2. Surveillance de la sismicité régionale (Guadeloupe et ses iles proches) liée à
l’activité tectonique de l’arc des Petites Antilles par le biais de l’enregistrement
continu de la sismicité, dans le but :
– d’avertir les autorités des caractéristiques d’un séisme ressenti et des
répliques qui peuvent y être associées ;
– d’établir sur des longues durées les caractéristiques spatiotemporelles des
sismicités régionale et locale pour contribuer à la zonation du risque
sismique.
3. Favoriser et participer aux travaux de recherche fondamentale et appliquée en
géophysique, en géochimie et en géologie concernant le volcanisme, la sismologie
et la tectonique régionale, y compris dans le cadre de coopérations régionales.
4. Contribuer à l’information préventive et à la divulgation des connaissances dans
les domaines du risque volcanique et du risque sismique, ainsi qu’à la formation en
matière de volcanologie, de géologie, de géophysique et de géochimie.
Son histoire
L’Institut de Physique du Globe de Paris a acquis en 1950 la propriété du Parnasse
dans les hauts de Saint-Claude, au pied de la Soufrière, pour y créer le Laboratoire
de Physique du Globe. L’année même, deux sismographes « Maïnka Som » étaient
installés. Une cave sismique, creusée en 1952, était équipée de sismographes
électromagnétiques en 1956. Cette année-là avait lieu une éruption phréatique à la
Soufrière. La rénovation des bâtiments en 1964 permit de mettre en place un
véritable réseau sismique. Les stations étaient alors reliées à l’observatoire par
câbles. En 1975, certaines le furent par télétransmission. C’est grâce à ce réseau
que put être détectée la crise sismique de la Soufrière et que fut envisagée dès
mars 1976 l’éventualité de manifestations de surface.
Lors de l’évacuation de la région Saint-Claude/Basse-Terre en juillet-aout 1976,
l’observatoire était installé dans la Grande Poudrière du Fort Saint-Charles. Les
réseaux de surveillance y restèrent pendant 17 ans, tandis que le laboratoire de
géochimie et l’administration s’installaient à nouveau au Parnasse. Le laboratoire
s’appelait alors observatoire volcanologique de la Soufrière. À partir de 1989, la
construction d’un observatoire moderne a débuté sur Le Houëlmont, situé à 9 km
au Sud-Ouest de la Soufrière. Tout l’observatoire et les équipements y sont
maintenant installés depuis 1993. En 2001, en raison de son implication toujours
plus importante dans le domaine de la sismologie et des recherches liées au risque
sismique, l’IPGP rebaptise l’observatoire de son nom actuel : observatoire
volcanologique et sismologique de Guadeloupe.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%