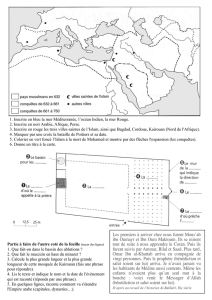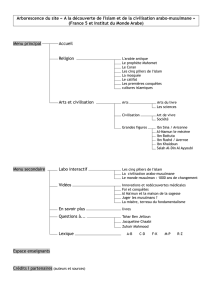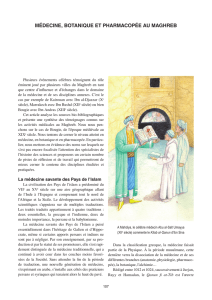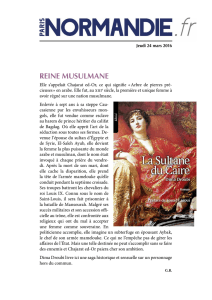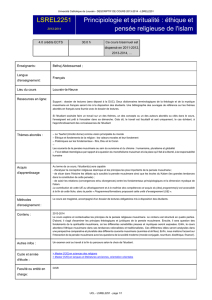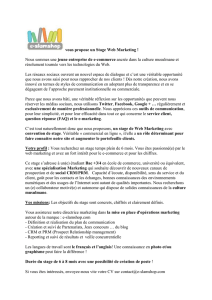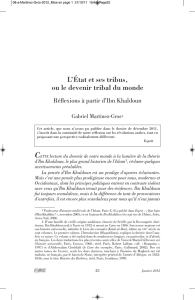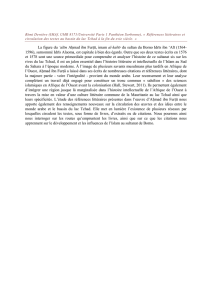Le discours sur la justice dans la pensée économique musulmane

1
Le discours sur la justice dans la pensée économique musulmane
Abderrazak Belabes(*)
Communication présentée aux Journées de l'Association Charles Gide «Justice et économie:
doctrines anciennes et nouvelles théories», avec la participation du professeur Amartya Sen, Prix
Nobel 1998, 16 et 17 juin 2011, Université Toulouse 1 Capitole.
I. Introduction
Le thème de ‘Justice et économie: doctrines anciennes et nouvelles théories’ offre
une occasion inédite de renouveler l’ouverture de l’économie vers d’autres champs de
connaissance et de redoubler d’efforts pour encourager les fécondations croisées.
La question de justice sera abordée ici en tant que pratique discursive telle qu’elle
s’énonce dans les textes référents1, la méthodologie du droit musulman, les essais
politiques et économiques classiques et la littérature contemporaine sur l’économie
musulmane. Il s’agit de savoir si la notion est abordée sous un prisme particulier et/ou si
elle se recoupe avec certaines approches contemporaines. La première partie est
consacrée à la dimension représentationnelle de la notion de justice en islam à travers ses
aspects sémantique, principiel, instrumental, déontologique, téléologique et
acquisitionnel. La seconde concerne les préoccupations de la littérature classique à
l’égard de la justice à travers les essais politiques et économiques. Enfin, la troisième
aborde la notion de justice dans la littérature contemporaine sur l’économie musulmane.
II. Aspects représentationnels
Les théories économiques, quelles qu’elles soient, sont au départ le fruit des
représentations qui structurent, à des degrés différents, la pensée de ceux qui les
formulent. En économie musulmane, ces représentations recouvrent l'aspect sémantique,
principiel, instrumental, déontologique, téléologique et acquisitionnel ayant trait à
l'acquisition de la connaissance sur la justice.
II.1. Aspect sémantique
Pour mieux comprendre ce qu'est la justice dans la pensée économique
musulmane, il convient d'abord de procéder à une investigation sémantique. Le terme
(*) Docteur en analyse et politique économiques de l’EHESS (Paris), actuellement chercheur au centre de recherche en
économie islamique, Université du Roi Abdulaziz, Djeddah, Arabie saoudite ; courriel: [email protected].sa.
1 Les textes référents sont le Coran et la Sunna qui englobe à la fois les propos, les pratiques, les approbations et les
désapprobations du prophète de l’islam. Le mot hadith signifie parole prophétique.

2
couvre une réalité multidimensionnelle qui se prête mal à une définition univoque. D'où
la nécessité de cerner les différents sens possibles en partant de divers angles d'approche.
Du point de vue étymologique, le mot arabe "‘adl", l’équivalent du français
"justice", signifie une position médiane, entre l’excès (ifrât) et la négligence (tafrît). Il
signifie également la droiture, la rectitude (istiqâma), l’équité (inçâf), l’impartialité
(hiyadiya), l’égalité (mussâwât).
Le mot 'adl est le contraire du mot "jawr" qui signifie l’injustice, l’iniquité, la
tyrannie, l’oppression.
Du point de vue de la croyance (‘aqîda), la justice constitue un attribut divin (sifa
ilâhiya)2 qui découle fondamentalement du monothéisme3.
Du point de vue juridique, la justice renvoie à l’idée d’un jugement qui converge
vers la vérité et à l’idée d’équité qui renvoie à la jouissance des droits et
l'accomplissement des devoirs.
Dans le vocabulaire des jurisconsultes (fuqaha), la justice signifie la rectitude
(istiqâma), c’est-à- dire le fait de se conformer aux commandements et d’éviter les
interdictions4. Ceci démontre la diversité des sens que recouvre le terme justice dans la
littérature musulmane.
II.2. Aspect principiel
L'intérêt de l'aspect principiel se situe dans la recherche des fondements du
principe de justice dans la tradition monothéiste. La croyance, plus ou moins assumée,
joue un rôle important dans la caractérisation d'une société, notamment sur le plan
économique. La croyance de l'économiste va le porter vers une certaine théorie plutôt que
d’autres (Rist, 2007).
Dans les religions monothéistes, la justice constitue une valeur cardinale dans le
rapport de l’homme envers son créateur, envers lui-même et les humains. Le
2 Dieu dit dans un hadith sacré (qudsi) : "Ô Mes serviteurs ! Je me suis interdit l’injustice à Moi-même, et Je vous l’ai
également interdite. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres", Al-Bukhari (n° 3150) et Muslim (n° 1062).
3 Dieu dit dans le Coran : "Nous avons effectivement envoyé Nos messagers avec des preuves évidentes, et Nous avons
révélé, par leur intermédiaire, l’Écriture et la Balance, afin que les gens établissent la justice" (Coran, 57, 25).
4 Ces différents sens ont été puisés d'Ibn Mandhour (1988, t. 9, pp. 83-84), Al-Charbassi (1981, p. 289), Hamad (1993,
pp. 193-19) et Amara (1993, pp. 368-369).

mo
n
pol
y
ind
i
L'a
p
du
d
rec
o
di
m
mu
t
le t
é
re
m
pro
g
pos
s
int
e
pri
v
qua
n
5
La
d
6
La
t
n
o
t
héisme
y
théisme (c
h
Dans
l
i
ssociables:
p
préhensio
n
d
éontologi
q
o
uvre donc
m
ensions,
s
t
uellement
s
Lorsqu
e
é
léologiqu
e
m
is en que
s
g
rès de la
s
ibilité et d
’
Cet ag
e
rprétation
t
v
ée. Dans
l
n
d il y a co
n
d
éontologie si
g
t
éléologie sign
i
(tawhîd)
m
h
irk) celui
d
l
a traditio
n
l'appréhe
n
n
et le dési
r
q
ue
5
. L'amo
une dime
n
s
ensées ap
p
s
e renforce
r
e
les condi
t
e
. La questi
o
s
tion. Elle
pensée et
’
impossibil
i
encement
é
t
éléologiqu
e
l
e droit m
u
n
flit entre l
e
g
nifie ici l’étud
e
i
fie ici l’étude
d
déo
n
appréhen
m
arque le
p
d
e l'injustic
n
musulm
a
n
sion (ra
h
r
, liés au co
m
ur lié à la
v
n
sion déon
t
p
artenir à
r
ou, au con
t
t
ions sont
o
o
n téléolog
i
reflète do
n
engage u
n
i
té.
é
pistémolo
g
e
, ne peut
j
u
sulman, l'i
n
e
s deux ent
i
Figure 1.
e
des devoirs q
u
d
es finalités.
n
tologie
sion(rahba)
p
oint cul
m
e.
a
ne, le
m
h
ba), l'am
o
m
mandem
e
v
ertu relèv
e
t
ologique
e
une mê
m
t
raire, s'ex
c
o
ptimales, l
e
i
que interv
i
n
c davanta
g
n
e réflexio
n
g
ique mon
t
j
ustifier la
n
térêt gén
é
i
tés.
Lien entre
m
u
i englobe les
o
j
us
t
télé
o
monot
h
amour(
m
m
inant de l
a
m
onothéism
e
o
ur (mah
a
e
nt (amr) e
t
e
quant à el
e
t une dim
e
m
e matric
e
c
lure (fig. 1
)
e
déontolo
g
i
ent quand
c
g
e une rég
r
n
en prof
o
t
re que la
négation
d
é
ral ne pri
m
m
onothéism
e
o
bligations et l
e
t
ice
o
logie
h
éisme
m
ahaba)
a
justice
e
e
s'appuie
a
ba) et l
e
t
l'interdicti
o
le du téléo
l
e
nsion thé
o
e
de con
n
)
.
g
ique indui
t
c
e chemine
m
r
ession de
o
ndeur sur
justice s
o
d
’un droit t
e
m
e sur l'int
é
e
et justice
e
s interdictions.
déonto
désir(ra
e
t, inverse
m
sur trois
e
désir (
r
on (nahy),
r
l
ogique
6
. L
a
o
logique. C
e
n
aissance,
t
de façon
n
m
ent est p
e
la pratiqu
e
les condi
t
o
ciale, issu
e
e
l que la
p
é
rêt perso
n
logie
ghba)
3
m
ent, le
piliers
r
aghba).
r
elèvent
a
justice
e
s deux
peuvent
n
aturelle
e
u à peu
e
qu’un
t
ions de
e
d’une
p
ropriété
n
nel que
3

4
II.3. Aspect instrumental
Dans la littérature sur l’économie musulmane, l’instrument phare de la justice
sociale est la zakât. En langue arabe, le mot zakât signifie purification, accroissement et
bénédiction. Du point de vue conventionnel, la notion de zakât a un sens spécifique en
tant que droit accordé à certaines catégories de personnes se trouvant dans le besoin et un
sens général qui englobe toute forme de redistribution répondant à des besoins humains
réels (Ibn Taymiya7, 1998, t. 28, p. 200).
A travers le mécanisme de zakât, l’économie musulmane reconnaît le droit de
propriété du fait que nul ne peut donner ce qu'il ne possède pas et la liberté économique
du fait que celui qui acquitte la zakât dispose de ses biens à sa guise. La zakât engage, par
ailleurs, le rôle de l'Etat qui veille à sa collecte et sa distribution8 (fig. 2). Une économie
libre n’est pas une économie où chaque agent ferait tout ce qu’il lui plairait. C’est un
système au sein duquel la liberté est garantie tant qu’elle n’enfreint pas les normes. D’où
la célèbre formule du droit musulman des contrats : en matière de transactions
(mu’âmalât), la règle est la permission (ibâha).
Figure 2. Relation entre zakât, propriété privée, liberté économique et action de l'Etat
Les théoriciens de l'économie musulmane justifient la zakât de la manière
suivante: les biens de cette terre appartiennent à Dieu, l'homme en est dépositaire
7Ahmed Ibn Taymiya célèbre jurisconsulte apparenté à l'école hanbalite né en 1263 à Haran, au sud-est de la Turquie,
et décédé en 1328 à la prison de Damas.
8Dans le monde musulman contemporain, la zakât est laissée à la discrétion des croyants, sauf dans quelques pays où
l’État s'efforce de remplir ce rôle. Le manque de confiance des gouvernés à l'égard des gouvernants à cause de la
corruption pousse les croyants à distribuer directement la zakât aux nécessiteux sans passer par l'instance étatique
compétente.
zakât
propriété
privée
actionde
l'Etat
libérté
économique

5
(khalîfa). A cet effet, il est appelé simultanément à fructifier ces biens de manière
optimale et à en affecter une partie pour les ayants droit. La zakât constitue un acte de
remerciement pour les biens accordés mais aussi un gage de pérennité de ces biens9.
Soumis à cette dernière, les biens accumulés font l'objet d'une baisse continue sauf s'ils
sont investis à un taux de rendement au moins égal au quotient Z/1 – Z où Z désigne le
taux de zakât qui varie selon la nature du bien. La valeur finale nette (VFN) des biens
s'ils ne sont investis se calcule de la manière suivante:
VFN B 1
Avec
B: biens tangibles fructifiables accumulés durant une année lunaire après avoir
atteint un certain seuil
T : nombre d'années
II.4. Aspect déontologique
La justice est une vertu (fadhîla), c’est-à-dire une disposition habituelle et un
comportement permanent qui interviennent de manière endogène dans le processus et non
après de façon exogène pour en atténuer la sévérité. En droit musulman, la justice
s’exprime par des devoirs qui portent vers le bien en dépit des obstacles rencontrés. Le
devoir (c) induit des actes (a) qui se placent d'emblée dans le temporel (t):
, ,
La référence textuelle à la thématique de justice associe le spirituel et le temporel.
Dieu dit dans une parole prophétique sacrée (hadith qudsi): "Nous avons descendu les
biens pour accomplir les prières et acquitter la zakât"10, c'est-à-dire les droits du créateur
et ceux des créatures. La justice, en accordant à chacun ce qu'il mérite au regard de la loi,
se différencie de l'égalité (mussâwât) qui consiste à donner la même chose pour tous11.
9Un hadith authentique rapporté par Muslim (n° 2588) stipule ceci: "Les biens de celui qui s'acquitte de la zakât ne
diminuent point".
10 Hadith rapporté par Ahmed (n° 21956) et authentifié par Al-Albani (n° 1639).
11 L'islam reconnaît l'égalité devant la loi ou l’égalité en droit selon laquelle tout individu doit être traité de la même
manière par la loi, voir Aboud (2008, p. 116).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%