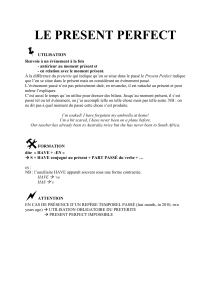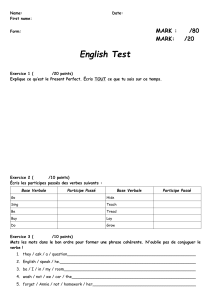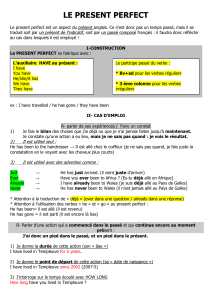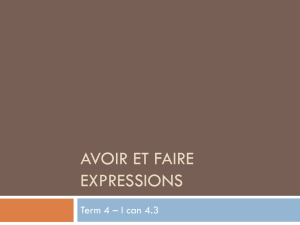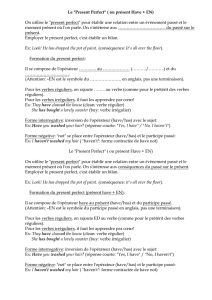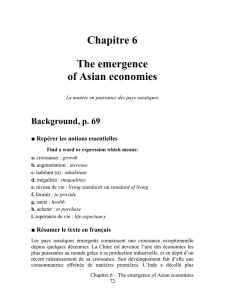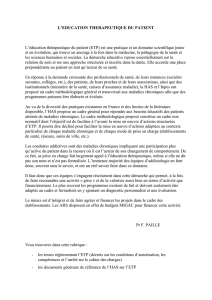Accéder à l`intégralité de la session en pdf

13
Session inaugurale
Le temps de l’économie et des sociétés :
accélérations, transitions, ruptures
L’économie mondiale a été frappée il y a cinq ans par la crise financière
la plus dévastatrice depuis les années 30. Néanmoins l’économie
mondiale a, jusqu’ici, mieux résisté que par le passé : l’industrie financière
américaine ne s’est pas effondrée, la crise de la dette européenne n’a pas
fait disparaître l’euro, les relations commerciales internationales n’ont
pas été interrompues. Cela suffit-il pour déclarer que le pire est derrière
nous ? Au cours de l’Histoire, de nombreux espoirs ont été détruits par
une opacité indéchiffrable décourageant les prévisions et décisions de
long terme. Aujourd’hui, où allons-nous ? Depuis 2008, avons-nous tout
bonnement cherché à retarder le pire ? Sommes-nous à l’aube d’un
rééquilibrage historique marqué par des ajustements difficiles à l’Ouest
et un dynamisme continu pour le « Reste » ? Allons-nous enfin sortir
du premier « grand cycle » de l’économie mondiale et entrer dans une
nouvelle phase d’ajustements structurels (probablement douloureux)
menant à un nouveau potentiel de croissance ? Autant de questions à
aborder dans une perspective de long terme et dans le but de déterminer
les sujets sur lesquels nous devons nous concentrer aujourd’hui pour
atteindre demain la troisième option : renforcer la discipline financière,
stimuler l’innovation, augmenter la flexibilité sociale tout en rendant
la solidarité plus efficace, développer la coopération internationale.
Contribution du Cercle des économistes
Jacques Mistral
Témoignages
Francis Fukuyama • Étienne Klein • Lionel Zinsou
Modérateur
Nicolas Pierron

14
Essai sur le marché,
la dynamique économique et le temps1
-DFTXHV0LVWUDO
Un récent sondage de l’institut Pew a donné une vision particulièrement
sombre de l’état d’esprit des Européens (en dehors de l’Allemagne) : moins
de 15 % de la population considère la situation économique comme « bonne » ;
dans la génération montante, plus de 75 % sont inquiets. L’Europe est-elle le
continent qui a peur de l’avenir ? La « crise » semble en effet nous envelopper de
toutes parts, c’est devenu un mot valise, on l’emploie à tout propos, au sujet des
banlieues, de l’éducation, de l’autorité, de l’hôpital, sans parler de la famille !
En tant qu’économistes, nous travaillons à la saisir sous forme de concept.
Même sans être spécialiste, on sait qu’il existe des explications concurrentes, ou
complémentaires, mettant en jeu les excès de la finance, la sous-consommation,
les délocalisations, l’épuisement du progrès technologique, le désordre des
finances publiques. Autant d’explications a posteriori ; mais ce qui est troublant,
c’est que, ex ante, la crise était imprévisible. Quant aux remèdes, on ne sait trop
à qui se fier : certains recommandent de poursuivre dans la voie de l’austérité ;
mais, quand on est au fond du trou, le bon sens suggère plutôt que l’on arrête de
creuser. Pour d’autres, la règle d’or, en matière de politique macroéconomique,
serait désormais d’être « non conventionnel » ; autant recommander d’accélérer
par temps de brouillard. Le savoir des économistes n’est plus ce qu’il était, un
savoir respecté parce qu’opérationnel, mieux, décisionnel. Oui, la crise résiste
au savoir des économistes.
1. La préparation de ce texte doit beaucoup aux échanges que j’ai eus depuis 3 ans au sein de
l’Association Paul Ricœur ; je remercie en particulier Olivier Abel et Myriam Revault d’Allonnes
dont le livre, La Crise sans fin, m’a beaucoup apporté. Je reste naturellement seul responsable de
la présente rédaction.

15
Essai sur le marché, la dynamique économique et le temps
Sous l’angle économique, social et politique, la crise a une quadruple
détermination. Il y a d’abord une réalité objective, très inégalement ressentie,
celle des emplois détruits, des restos du cœur, du chômage de longue durée. Il
y a en second lieu l’analyse que nous pouvons en faire, avec un succès inégal,
après la mise en cause des paradigmes anciens, la « nouvelle macroéconomie
classique » qui n’a jamais rien eu à dire et le modèle de marchés efficients
qui a conduit au désastre. Il y a ensuite le vécu subjectif, le parcours du
combattant que représente pour tant de jeunes l’entrée sur le marché du
travail, le chômage de masse ou, au mieux, les mobilités aléatoires en cours de
carrière, les entrepreneurs abordant les fermetures de sites avec prudence et les
décisions d’investissement avec perplexité, les futurs pensionnés considérant
avec inquiétude leurs retraites amputées. Il y a enfin des doutes envahissants
sur la capacité des institutions et des autorités politiques à définir et à mettre
en œuvre les mesures pour faire face à ces défis. La crise, on le voit, on le sait,
c’est une série de discontinuités ; quelle est leur nature ?
Il faut, comme pour toute chose, se référer aux données de l’espace et du
temps. L’économie a un lien étroit avec l’espace : la tragédie du Rana Plaza2
au Bangladesh a récemment rappelé à quel point nos conditions de vie étaient
désormais le reflet d’une géographie mondiale. Depuis deux décennies, il n’est
en effet question que de « mondialisation ». La diffusion aux pays « émergents »
d’un modèle de croissance que l’on avait cru réservé aux « pays avancés » est
certainement le phénomène le plus frappant au tournant du XXe et du XXIe
siècle. Les restructurations industrielles pèsent en effet lourdement sur les
territoires ; mais la crise, à ce jour, n’est pas une crise de la mondialisation :
nous ne sommes pas, comme dans les années trente, dans la spirale dépressive
du protectionnisme et des dévaluations compétitives. En fait, si l’économie a
bien un lien étroit avec l’espace, elle a un lien encore plus intime avec le temps.
La quintessence de l’économie, c’est la croissance, c’est-à-dire la dynamique ;
ce sont les anticipations, c’est-à-dire la projection dans le futur. Dans les pays
dits avancés, c’est bien là qu’est la rupture. Mais d’où l’économie tire-t-elle un
rapport si intime au temps ?
m<DWLOXQHDFFpOpUDWLRQGXWHPSVpFRQRPLTXH"
On parle souvent de « l’accélération » du temps économique. En fait, comme
le montrent l’anthropologie, l’histoire de l’Antiquité ou celle du Moyen-âge, la
vie dite « économique » est restée pendant la plus grande partie de l’histoire de
l’humanité, soigneusement insérée au sein des autres activités sociales : Polanyi3
en a donné une démonstration inégalée. Le don, le coquillage, le port, la foire,
2. Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, immeuble qui abritait des usines de textiles, s’effondrait sur les
quelque 3 000 travailleur, faisant des centaines de victimes.
3. Karl Polanyi (1886-1964), historien de l’économie et économistes hongrois.

16
Le temps de l’économie et des sociétés : accélérations, transitions, ruptures
le bazar n’ont pas créé « l’économie de marché » telle que nous la connaissons.
L’économie est restée fondée pendant de très longues périodes sur la répétition
de gestes pratiquement immuables, sur la perpétuation d’un circuit, par exemple
celui formalisé par les physiocrates, dont la dilatation ou la contraction étaient le
produit de chocs exogènes, récoltes, guerres, épidémies ou afflux d’or : le temps
de l’économie n’avait rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd’hui.
Accompagnant les Lumières et le progrès technologique, l’irruption du marché
généralisé est depuis la fin du XVIIIe siècle le grand moteur de la modernité. Le
marché a depuis eu ses prophètes ; il est pour Marx une force émancipatrice, il
a pour Schumpeter un potentiel illimité, il véhicule selon Robbins4 le triomphe
d’une rationalité instrumentale. Et surtout, il se faufile constamment entre les
limites qu’on entend lui imposer, il se démène pour échapper à l’emprise de la
société, il prétend ne se mouvoir que par lui-même. Le marché est, comme l’a
montré Dumont, une force auto-instituée ; serait-ce là que le bât blesse ?
Le marché bouscule en permanence les cadres sociaux qui entravent son
développement. En l’absence d’obstacle, il aurait pour terme naturel non
seulement la généralisation à la planète entière de l’économie de marché mais
également la création d’une véritable société de marché dont serait exclu tout ce
qui pourrait entraver son épanouissement ; traditions, valeurs, comportements,
tout doit lui être subordonné, même la personne, l’individu transformé
en « entrepreneur de lui-même ». Tony Judt a dressé avant sa disparition le
réquisitoire émouvant de ce que « nous avons perdu » en adhérant naïvement,
depuis un quart de siècle, au mythe du marché auto-régulateur. Autant dire,
comme l’avait affirmé Margaret Thatcher sans ambages, qu’arrivé à ce stade il
« n’y a rien qui mérite le nom de ‘société’ ». Ce n’était pas l’énoncé d’une théorie
mais l’affichage d’un programme et c’est là qu’il faut y regarder à deux fois ; car
il n’y a plus rien, non plus, qui structure alors l’écoulement du temps, la matrice
dans laquelle les « agents économiques » forment leurs projets et prennent leurs
décisions. D’un coté, le passé est révolu, il n’a pas de valeur intrinsèque et ne
fournit aucun guide pour l’action ; quant à l’avenir, nous le connaissons mal,
comme le reconnaît le bon sens populaire qui a conclu de longue date que
l’art de la prévision était plus qu’aléatoire. Entre les deux, il y a le présent,
moment essentiellement schumpetérien, créateur et destructeur, créateur ou
destructeur : en lui se cristallise, ou non, la promesse d’un avenir supérieur
qui justifie les sacrifices qu’il faut bien consentir. Mais comment traverse-t-on
le présent ?
On en arrive ainsi à la croissance et à la crise. Conformément à une métaphore
utilisée avec bonheur par exemple par Michel Aglietta, la croissance, c’est « la
flèche orientée du temps ». La croissance est le fruit des sacrifices consentis dans
4. Lionel Robbins (1898-1984) est un professeur d’université anglais qui joua un rôle clé au
département d’économie de la London School of Economics de 1929 à 1961, date à laquelle il
devient directeur du Financial Times.

17
Essai sur le marché, la dynamique économique et le temps
le passé, dont on mesure ainsi le sens, et elle fait vivre dans l’attente de progrès
à venir, le fameux « partage de (ses) fruits » ; entre les deux, le présent est pour
chacun, étudiant, salarié, chef d’entreprise, investisseur ou ministre, le moment
d’une action éclairée, posant en termes de choix rationnel les arbitrages que
commande l’ensemble des opportunités, des risques et des signaux de prix ;
bref, des choix directement en prise avec les réalités de l’heure, des choix
qui assurent la maîtrise du temps, ou au moins en donnent l’impression. La
croissance, c’est la narration communément acceptée d’un « progrès » en cours,
c’est le cadre qui façonne les anticipations et les décisions décentralisées, c’est
le ciment de ce que serait une société de marché d’où l’on aurait fait disparaître
tout autre repère.
m0DLVVRXGDLQYLHQWODFULVH
À quoi la reconnaît-on ? Les choses semblent suivre leur cours : la
rationalisation toujours plus poussée des méthodes de production et de
distribution, la diffusion des produits à une échelle toujours plus large,
l’acquisition de compétences plus pointues, l’application de recherches plus
prometteuses les unes que les autres, tout cela continue et pourtant la « reprise »
se dérobe ; tous ces projets désormais se juxtaposent sans que se dégage une
vision de l’avenir ; le présent est plongé dans l’opacité ; l’avenir fait peur. Les
sacrifices passés, ceux qui sont demandés aujourd’hui, perdent leur sens ; les
acquis de l’expérience deviennent inopérants et les risques associés au futur
qui s’annonce paraissent incommensurables ; le futur est indéterminé, pire,
indéterminable (c’est la situation « d’incertitude radicale » que décrit Keynes) ;
les « anticipations rationnelles » supposées toujours ramener l’économie à
son optimum sont réduites à une fantaisie littéraire. Le « marché », incapable
de trouver en lui-même les ressorts qui lui permettraient d’aller au-delà de
l’équilibre statique de l’offre et de la demande, pour lequel il reste imbattable,
nous aurait tout simplement trahis. La crise, c’est une situation où l’économie
de marché poussée à son terme rendrait la société incapable de se projeter dans
l’avenir.
Incapable d’établir un pont entre l’expérience du passé et l’anticipation
de l’avenir, l’économie de marché arrivée à son apogée semble ainsi ne plus
savoir quoi faire du présent. Pour rendre compte de cet état, il est utile de
recourir à une autre métaphore introduite par Hannah Arendt, celle de la
« brèche du temps ». Le plus frappant dans cette métaphore, c’est la dualité
d’interprétations qu’elle suggère. D’un côté, elle exprime bien la discontinuité,
la rupture ; c’est un peu comme la fusée explosant en vol, la « flèche du temps »
a quitté sa trajectoire notionnelle, tout semble perdu. Mais il y a aussi une toute
autre interprétation, celle que suggère Arendt. Car la « brèche », ce sont aussi
des murailles qui tombent, une colonne qui perce l’encerclement, la liberté
retrouvée. Voilà ce que nous devons surtout en retenir : le monde ancien étant
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%