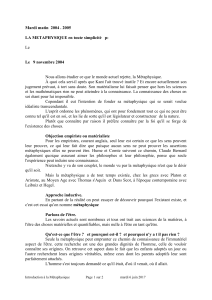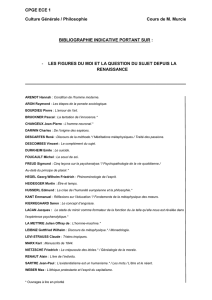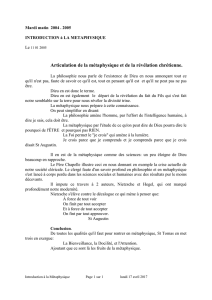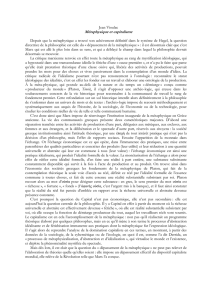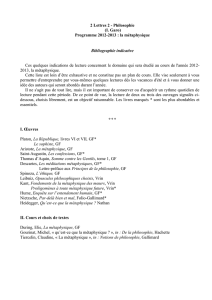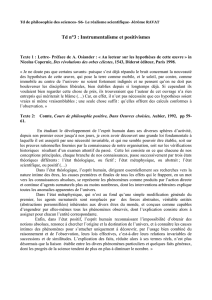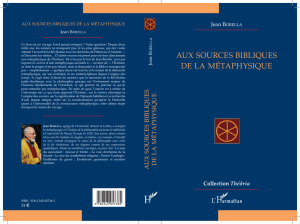introduction : sens et enjeu de la metaphysique

1
METAPHYSIQUE

2
METAPHYSIQUE...............................................................................................................................1
INTRODUCTION : SENS ET ENJEU DE LA METAPHYSIQUE...............................................................4
I° PARTIE ..........................................................................................................................................6
LA QUESTION DE LA METAPHYSIQUE .............................................................................................6
Ch I - THOMAS D’AQUIN ET L’EMERVEILLEMENT PRECRITIQUE DEVANT L’ETRE...........................6
A – L’Être et l’Étant ......................................................................................................................6
1 – l’être commun comme acte simple et plénier de tous les étants. ....................................6
2 – l’être et la subsistance .......................................................................................................8
3 – l’être, le sujet et l’essence. ................................................................................................9
B – L’être et l’intelligence ( autre épistémologique )................................................................10
C – L’être et les transcendantaux..............................................................................................12
1 – la triade des transcendantaux : Unum, Verum, Bonum. .................................................12
2 – les transcendantaux, l’étant et l’âme. .............................................................................14
3 – L’être comme Beauté ( pulchrum) ...................................................................................17
D – L’être et Dieu.......................................................................................................................17
E – Analogie ...............................................................................................................................18
Conclusion .................................................................................................................................22
Ch II - KANT ET LE PROBLEME DE LA METAPHYSIQUE .................................................................23
A – Détermination du point de vue transcendantal ou critique ...............................................23
ESTHETIQUE...................................................................................................................................25
TRANSCENDANTALE ......................................................................................................................25
ANALYTIQUE TRANSCENDANTALE ................................................................................................25
DIALECTIQUE TRANSCENDANTALE ...............................................................................................25
TABLE DES JUGEMENTS .............................................................................................................26
QUANTITE ..............................................................................................................................26
MODALITE..............................................................................................................................26
TABLE DES CATEGORIES.............................................................................................................26
QUANTITE ..............................................................................................................................26
QUALITE
RELATION .......................................................................................................26
MODALITE..............................................................................................................................26
C – La transposition critique des grands thèmes de la métaphysique......................................29
1.
La philosophie critique et l’être ....................................................................................29
2.
La philosophie transcendantale et les transcendantaux ..............................................30
3.
Le criticisme et l’analogie..............................................................................................31
D – Le criticisme comme réduction anthropologique...............................................................33
Ch III - HEGEL ET LE TRIOMPHE DIALECTIQUE DE LA NEGATIVITE................................................35
A – Le dépassement de la philosophie transcendantale...........................................................35
1. Du Moi transcendantal au Soi absolu ................................................................................35
2.
De l’unité synthétique à l’unité dialectique..................................................................35
3.
Le processus absolu du concept....................................................................................37
B – La métaphysique comme système dialectique de l’Idée absolue.......................................38
1.
Le mouvement dialectique de l’Idée absolue : du Logos à la Nature et de la Nature à
l’Esprit absolu.........................................................................................................................39
2.
Les trois syllogismes de l’Idée et la structure de la science..........................................42
C – L’intégration du point de vue critique.................................................................................44
D – Négativité absolue et oubli de la positivité originaire de l’être..........................................47

3
Ch IV - HEIDEGGER ET LA REMONTEE AU FONDEMENT DE LA METAPHYSIQUE........................50
A – la question de l’être et le « retournement ».......................................................................50
B – le dépassement de la métaphysique...................................................................................52
C – La pensée non métaphysique de l’être ...............................................................................55
D - Les apories de la pensée heideggerienne de l’être .............................................................56
1.
L’indifférenciation de l’être et la destruction de la métaphysique ..............................56
2.
L’hypostasiation de l’être-comme-tel...........................................................................57
3.
L’indifférenciation du domaine de l’étant et de l’être-là..............................................58
4.
La perte de l’héritage chrétien et le silence sur Dieu ...................................................59
II° PARTIE .......................................................................................................................................63
ESSAI DE METAPHYSIQUE SYSTEMATIQUE ...................................................................................63
Introduction : les perspectives ouvertes par la problématique....................................................63
Ch I – L’ETRE COMME FONDEMENT .............................................................................................65
A – le réalisme critique. .............................................................................................................65
B – l’être comme fondement de la pensée et de son interrogation.........................................69
C – la vérité comme unité de l’être et de la pensée .................................................................69
D – L’être et le concept..............................................................................................................70
E – L’être et la langage...............................................................................................................72
F – L’être et l’homme.................................................................................................................73
Ch II – L’ETRE EN LUI-MEME..........................................................................................................77
A – L’abstraction métaphysique................................................................................................77
B – la saisie métaphysique de l’acte d’être comme tel.............................................................78
C - La positivité de l’être............................................................................................................81
1. l’être , la raison et le néant. ...............................................................................................81
2. la plénitude originaire de l’être. ........................................................................................82
D - L’être, l’essence et la subsistence.......................................................................................83
1. la distinction réelle de l’être et de l’essence et la suressentialité de l’être. .....................83
2. La distinction de l’être et de la subsistence et la non-subsistence de l’être comme tel...84
Ch III – L’ETRE ET DIEU...................................................................................................................87
A – De l’être à Dieu : la triple différence métaphysique. .........................................................87
1.Le Je et le Tu........................................................................................................................88
2.
Les étants et l’être des étants .......................................................................................88
3.
Les étants, l’être de l’étant et Dieu...............................................................................89
Récapitulatif ( tiré de Foi et Philosophie de A. Léonard) : .....................................................92
B – la pensée divine et le néant.................................................................................................94
C - Dieu et la Création...............................................................................................................96
D - La positivité de la différence dans l’être et en Dieu. .........................................................103
CONCLUSION :
METAPHYSIQUE ET REVELATION ....................................................................106
1.
A propos de Thomas d’Aquin ......................................................................................110
2.
A propos de Kant.........................................................................................................111
3.
A propos de Hegel .......................................................................................................112
4.
A propos de Heidegger................................................................................................113
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE ....................................................................................................114
1.
Concernant la partie historico-critique.......................................................................114
2.
Concernant la partie systématique.............................................................................114

4
INTRODUCTION : SENS ET ENJEU DE LA METAPHYSIQUE
1 – la métaphysique est, comme dit Aristote, la science de l’étant en tant qu’étant et par là, il
nous faudra voir comment, la science de l’être en tant qu’être, et de Dieu en tant que source de
l’être.
2 – la métaphysique est un savoir, au même titre que toute connaissance assurée et cohérente,
mais elle est surtout une sagesse en tant qu’elle déborde la simple connaissance des
phénomènes.
3 – en tant que sagesse, la métaphysique est tournée vers un mystère ( c’est à dire vers l’être
inépuisable du réel ), vers le mystère de l’être, plutôt que vers un problème ( mesuré par notre
conceptualité ) , même si les deux dimensions du mystère et du problème sont toujours
présentes en tout savoir, mais avec des proportions différentes. Dans la mesure où, en
métaphysique, l’aspect du mystère est prépondérant, la pensée y progresse plus par intimité
croissante avec le réel que par substitution d’une solution à une autre.
4 – la métaphysique est contestée :
a – par ceux qui estiment que la pensée humaine doit demeurer en deçà de la
métaphysique, parce que cette dernière serait soit impossible, soit dépourvue de sens.
b – par ceux qui, la liant à un oubli de l’être au profit de l’étant, estiment qu’il faut la
dépasser dans une pensée authentique de l’être.
c – par ceux qui prétendent en faire l’économie , soit pour des raisons théologiques ( cf.
un certain protestantisme ), soit pour des raisons idéologiques ( cf. un certain marxisme )
5 – Contestée, la métaphysique est plus encore oubliée. Cet oubli est, pour l’essentiel, lié au
grave malentendu qui a présidé au développement du la science moderne depuis 3 siècles. En
voici les principales données :
a – la métaphysique ancienne et médiévale comportait essentiellement :
• une métaphysique, science de l’être en tant qu’être.
• une philosophie de la nature , science de l’être engagé dans le sensible ( = la
physique des anciens )
• une philosophie de l’âme , science de l’être doué de vie végétative, sensitive
ou même intellective ( = la psychologie des anciens ).
b – les anciens et les médiévaux n’ont pas développés une science des phénomènes
comme telle, distincte de la philosophie de la nature ( ou de l’âme). Tout leur savoir
expérimental était donc immédiatement incorporé à l’approche philosophique de l’être
sensible. D’où de multiples erreurs ou négligences dans l’explication ou la pseudo-explication
des phénomènes, indépendamment de la valeur métaphysique de leurs prémisses.
c- D’où le discrédit abusif jeté sur l’ensemble de la philosophie de la nature des Anciens,
et mêmes sur leur métaphysique, lors de l’avènement de la science physico-mathématique des
phénomènes.

5
d- d’où , dans un premier temps, la prétention fausse des sciences positives d’être elles-
mêmes la vraie philosophie de la nature et , dans un second temps, l’exclusion positiviste pure
et simple de toute approche philosophique de la nature, ce qui signifie un renversement total
de perspective par rapport à l’Antiquité.
e – En conséquence, chassée progressivement du domaine de la nature, la
métaphysique est tentée soit de s’inféoder aux sciences formelles ou expérimentales ( ce qui
revient pour elle à se mesurer non plus au mystère de ce qui est, mais à la problématique de la
science positive à tel moment ) soit de préserver sa dimension spirituelle propre en se réfugiant
dans l’exploration de la subjectivité.
6- Contestée et oubliée, la métaphysique est cependant une sagesse indispensable et
particulièrement urgente. En effet, sans l’attention au mystère englobant de l’être, sans le
regard métaphysique vers la profondeur du réel, l’intelligence risque de s’épuiser dans
l’exploration et l’exploitation de la surface des choses. Sous péril d’asphyxie , la pensée doit
s’ouvrir de nouveau à la sagesse et redécouvrir les objets propres de l’intelligence : l’être lui-
même, les réalités spirituelles, Dieu.
Nous procéderons en deux étapes :
1 – une partie historico-critique. nous verrons comment se pose la question
métaphysique de l’être, grâce à l’évocation de 4 grands penseurs : Thomas d'Aquin, Kant,
Hegel, Heidegger.
2 – une partie spéculative et systématique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
1
/
115
100%