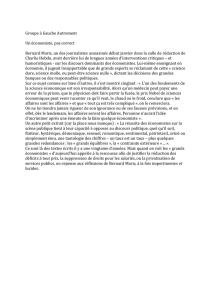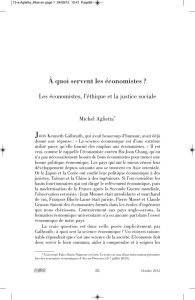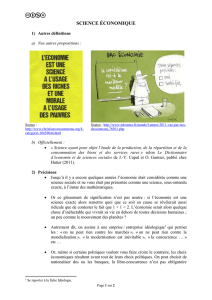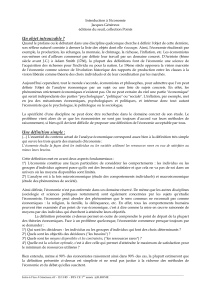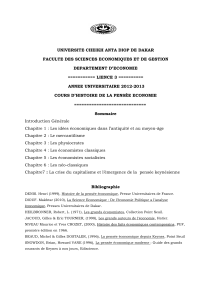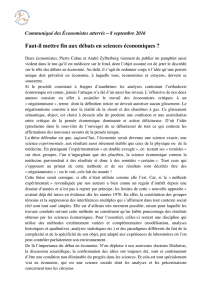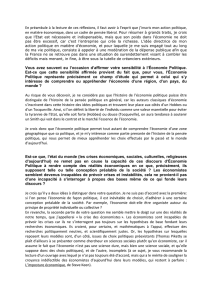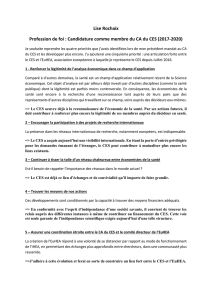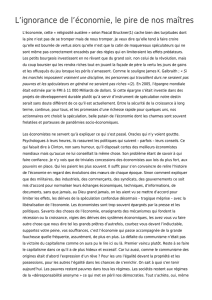Télécharger l`article - Institut de l`entreprise

La globalisation économique, qui tient
lieu aujourd’hui de projet de société,
le poids de l’économie sur les représen-
tations sociales et la définition même de
la science économique « comme science
de l’action humaine au sens le plus large
possible1», la multiplication de l’exper-
tise économique, confèrent à l’écono-
miste une place particulière dans la
société. En effet, l’économiste est à la
fois celui qui produit du savoir « écono-
mique » et des croyances2à l’intérieur
d’équipes de recherche souvent finan-
cées par des contrats avec des entrepri-
ses, celui qui éclaire et légitime les choix
des institutions nationales ou internatio-
nales, l’expert salarié des grandes socié-
tés ou encore l’expert qui s’exprime
dans les mass media pour expliquer les
mouvements économiques. Bien sûr ces
places requièrent des postures différen-
tes. Néanmoins, elles s’appuient toutes
et se construisent sur la référence expli-
cite ou implicite à la science économi-
que comme science caractérisée par la
neutralité axiologique et politique,
comme science de l’administration des
moyens rares.
102 Sociétal N° 50 g4etrimestre 2005
4LIVRES ET IDÉES
4CONJONCTURES
4REPÈRES ET TENDANCES 4DOSSIER
L’économie est-elle une
science ? Les économistes
sont-ils au-dessus de
toute responsabilité ?
GENEVIÈVE AZAM *, DOMINIQUE PLIHON *
LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉCONOMISTE
* Membres du conseil scientifique d’Attac ; professeurs d’économie, respectivement aux Universités
de Toulouse-Montmirail et de Paris-Nord..
La théorie économique néo-classique s’est imposée
comme le mode dominant de référence tant de l’ensei-
gnement de l’économie que de la justification des politi-
ques économiques. Sa force est d’avoir adopté un mode
de présentation et un mode de raisonnement qui, inspirés
de la mécanique classique de Newton et Lagrange, lui
donnent une apparence scientifique. Mais sa faiblesse est
de ne pas aller jusqu’au bout de la démarche des physi-
ciens. En effet, ceux-ci fondent leur acceptation d’un
résultat sur l’expérience. Les partisans de la théorie néo-
classique en revanche, quand la réalité infirme leur point
de vue, tendent à considérer que la réalité doit se modi-
fier pour se conformer aux hypothèses de leur modèle.
Leur démarche n’est plus la recherche de la compréhen-
sion mais la définition d’une norme sans cesse affirmée et
en pratique totalement inaccessible. Par exemple, l’échec
du FMI en Russie, dans les premières années post-com-
munistes, dont la traduction a été la débâcle financière de
1998, a été vécu par cette organisation comme la preuve
que la Russie avait encore du chemin à faire sur la voie
d’une gestion scientifique de l’économie et non comme le
constat des limites des politiques préconisées par elle. 1. Pascal Salin, 1991, Macroéconomie, p.11, PUF,
Paris.
2. Frédéric Lebaron, 2000, La Croyance économique,
Les économistes entre science et politique, p. 93, Seuil,
Paris.

Ainsi, alors que les économistes sont
convoqués comme experts par les insti-
tutions publiques, nationales et interna-
tionales, alors qu’ils concourent à la
décision et aux choix, leur responsabilité
n’est jamais engagée dans l’évaluation
des conséquences économiques, socia-
les, écologiques, politiques, des décisions
et des choix qu’ils ont préconisés.
Et pourtant, les conséquences induites
par des choix élaborés par des cercles
d’économistes peuvent se révéler catas-
trophiques, sur le plan social, écologique
ou encore politique.
Les crises financières des deux dernières
décennies en sont une illustration : les
économistes sont toujours en retard
d’une crise. Il y a eu quatre générations
successives de modèles de crises finan-
cières et de change depuis les années 70,
élaborées par les meilleurs économistes,
tel Paul Krugman. Le nombre de publica-
tions académiques sur ce thème a suivi
une évolution parallèle à celle des cri-
ses3. Pourtant on sait aujourd’hui, grâce
aux travaux de l’historien Charles
Kindleberger, que les crises obéissent
toujours aux mêmes mécanismes, fon-
dés sur la spéculation. Il est reconnu que
l’accélération des crises pendant les
années 90, dont le coût économique et
social a été considérable pour les pays
dits « émergents », est le résultat direct
d’une libéralisation financière brutale
et non maîtrisée. Les économistes,
conseillers des gouvernements et des
organisations internationales, ont mis
du temps à comprendre que les politi-
ques de libéralisation systématique qu’ils
recommandaient étaient inadaptées aux
pays en développement et « émer -
gents », et conduisaient inévi tablement à
des catastrophes, comme
l’a montré Joseph Stiglitz, ancien vice-
président de la Banque mondiale, dans
La Grande Désillusion.
De même, l’épisode de la « nouvelle éco-
nomie », dans la seconde moitié des
années 90, a entraîné des diagnostics
erronés de la part d’un grand nombre
d’économistes sur l’idée d’un nouvel âge
d’or des économies capitalistes, porté
par les nouvelles technologies, après la
chute du mur de Berlin qui symbolisait la
victoire définitive de la mondialisation
libérale. Les difficultés actuelles des
« anciennes » économies capitalistes, et
l’émergence de nouvelles puissances
venues bousculer l’ordre international,
jettent une lumière crue sur les analyses
euphoriques de la fin des années 90.
Pourtant la responsabilité n’est jamais
posée, alors que les conséquences des
politiques qu’ils inspirent peuvent s’avé-
rer dramatiques sur le plan social et
écologique.
Nous nous proposons d’analyser com-
ment la croyance en une science neutre
dissout la responsabilité éthique et poli-
tique des économistes dans la construc-
tion de la pensée dominante et dans les
choix économiques qui engagent pour-
tant l’avenir des sociétés.
LE STATUT
DES ÉCONOMISTES ET DE
LA SCIENCE ÉCONOMIQUE
Avec du recul, on constate qu’il y a
eu deux étapes essentielles dans la
constitution du « savoir économique »
au cours desquelles les économistes
n’ont pas eu la même démarche face à la
société.
DEL’ÉCONOMIE POLITIQUE
À LA SCIENCE ÉCONOMIQUE
L’analyse économique s’est développée
en tant que corpus théorique lorsque le
capitalisme a émergé progressivement
de l’économie féodale à partir XVIIesiè-
cle et lorsque la recherche de la
richesse, après avoir été tenue pour une
passion perverse, se trouve réhabilitée
avec le début de la sécularisation de la
société. Alors que dans les « sciences
dures », les chercheurs veulent com-
prendre la nature pour la transformer,
l’objet de l’économie est d’agir sur les
hommes et les rapports sociaux. Ceci
pose nécessairement la question du
pouvoir et des groupes sociaux.
C’est pourquoi l’analyse économique
s’est d’abord constituée en tant qu’éco-
nomie politique. Les grands courants
successifs de l’analyse économique, jus-
qu’à la rupture néo-classique, se sont
construits dans les représentations
dominantes de la société. Ne revendi-
quant pas l’autonomie de leur discipline,
soucieux de l’intérêt général ou de
l’équilibre « naturel » de la société, ils se
sont trouvés en congruence avec les
intérêts des groupes sociaux dominants,
ou perçus comme tels, à chaque étape
de l’histoire du capitalisme naissant. Le
mercantilisme (XVIIesiècle), qui s’inté-
resse aux bienfaits du commerce exté-
rieur et de l’accumulation des métaux
précieux, s’inscrit dans le cadre des
monarchies conquérantes et de la cons-
truction des États ; il est une théorisa-
tion de la richesse conforme aux
intérêts du roi et de la noblesse. La
théorie physiocratique (XVIIIesiècle) se
développe ensuite comme un ensemble
structuré d’arguments qui confortent la
position des propriétaires fonciers de
l’Ancien Régime. Le fameux tableau éco-
nomique de François Quesnay, qui est
la première représentation globale de
l’économie, est fondé sur l’idée que
seule la terre produit de la valeur nette
ou surplus, justifiant ainsi que ce surplus
revienne aux propriétaires de la terre.
Après la chute de l’Ancien Régime,
l’école classique a pour cadre d’analyse
le capitalisme industriel qui s’est imposé
avec l’émergence de deux classes fonda-
mentales, la bourgeoisie qui a pris le
pouvoir, et la classe ouvrière. L’économie
politique fait un grand bond en avant
avec l’école classique qui se décompose
en deux courants, d’une part le courant
libéral dont les grandes figures sont
Adam Smith (1723-1790) et David
Ricardo (1772-1823), et d’autre part le
courant marxiste. La construction théo-
rique des économistes classiques libé-
raux porte les intérêts de la bourgeoisie
face à ceux de la noblesse déclinante.
Elle est très élaborée, avec au centre une
théorie de la répartition des revenus,
fondée sur une théorie de la valeur-
travail, ainsi qu’une analyse du com-
merce international. Karl Marx
103
Sociétal N° 50 g4etrimestre 2005
L’ÉCONOMIE EST-ELLE UNE SCIENCE ?
3. « Les crises financières », Robert Boyer,
Mario Dehove et Dominique Plihon, Rapport
pour le Conseil d’Analyse économique, La
Documentation française, 2004.

(1818-1883) s’inspire des éléments de
base de la théorie classique libérale
(notamment la notion de valeur travail)
qu’il transforme pour développer une
théorie du capitalisme comme système
d’exploitation et d’aliénation de la classe
ouvrière.
Ainsi, les premiers grands courants de
pensée constitutifs du savoir économi-
que s’inscrivent dans une démarche qui
leur donne une dimension politique et
une contingence historique irréducti-
bles. Ces approches sont fondées sur
des postulats politiques et philosophi-
ques différents, de telle sorte qu’il
n’existe pas de critère scientifique pour
les départager. Il en est ainsi de la
fameuse théorie ricardienne des avan-
tages comparatifs, considérée comme
une des grandes avancées de la théorie
économique. Celle-ci, souvent encore en
toile de fond dans le corpus de la pensée
libérale, est largement remise en cause
du fait des caractéristiques contempo-
raines du commerce international qui
diffèrent des postulats de Ricardo,
notamment la mobilité des facteurs de
production et le développement des
échanges intra-branches de produits
similaires.
LA THÉORIE NÉOCLASSIQUE
OU LA CROYANCE EN UNE SCIENCE
ÉCONOMIQUE UNIVERSELLE
La théorie néoclassique constitue une
rupture dans la pensée économique car
elle est construite sur le modèle de la
physique mécanique et elle a une pré-
tention à la neutralité et à l’universa-
lisme. Cette théorie se veut a-historique
et a-politique. Le paradigme central
(rationalité – maximisation – équilibre),
qui constitue la base unificatrice et inté-
gratrice de la théorie néoclassique, est
considéré comme inaliénable. Ainsi, le
modèle d’équilibre général développé
par Léon Walras, pierre angulaire de
cette théorie, est largement utilisé
aujourd’hui comme un instrument d’ana-
lyse à des fins de politique économique,
alors même que les hypothèses qui le
sous-tendent sont largement contredi-
tes par la réalité. Même lorsqu’il est
reconnu que la rationalité des agents
économiques est imparfaite, et que l’ave-
nir est incertain, ce qui remet en cause
les résultats fondamentaux de ces
modèles, les économistes continuent de
les utiliser, le plus souvent sans recul cri-
tique. De même, la théorie de l’efficience
des marchés financiers, fondée sur les
postulats néoclassiques, reste la réfé-
rence alors qu’il a été démontré par les
théoriciens keynésiens et un grand nom-
bre de travaux empiriques que celle-ci
est largement irréaliste. Cette posture
des économistes orthodoxes résulte des
postulats méthodologiques qui sous-
tendent la théorie néoclassique. La
cohérence externe (le réalisme des
hypothèses) est considérée comme
seconde par rapport à la cohérence
interne (logique), comme l’illustre ce
jugement de Milton Friedman :
« C’est une idée fausse que de vouloir tester
les postulats (ou hypothèses de base). Non
seulement il n’est pas nécessaire que les
hypothèses de base soient réalistes, mais il
est avantageux qu’elles ne le soient pas4.»
Depuis la fin des années 60, la « science
économique » ne prétend plus seule-
ment expliquer l’action économique, elle
applique sa méthodologie à la totalité de
l’action sociale et imprègne l’ensemble
des sciences sociales. Le mouvement,
déjà amorcé auparavant avant de se glo-
baliser, était ainsi appréhendé par Joan
Robinson :
«Aujourd’hui, les prétentions des économis-
tes ont impressionné les autres représen-
tants d’autres branches des études sociales,
qui singent les économistes singeant les
physiciens5.»
Ce fut l’entreprise menée par Théodore
Schultz et Gary Becker avec la théorie
du capital humain : ainsi, l’amour, la reli-
gion, le sport entrent dans la logique du
choix rationnel, selon laquelle, l’individu
rationnel, seul sujet reconnu, ne veut
qu’une chose majeure : maximiser son
gain et minimiser son effort. Jusque-là et
avec des nuances, beaucoup des grands
économistes faisaient encore de l’action
économique un sous-ensemble du sys-
tème social. Les lignes majeures du
programme de Gary Becker avaient déjà
été formulées par exemple par Lionel
Robbins ou encore par Ludwig von
Mises qui cherchaient à fonder « une
théorie générale de l’agir humain6.» La
reconnaissance et la domination de
cette approche sont indissociables de la
victoire politique et idéologique du néo-
libéralisme, reconnu comme d’autant
plus légitime qu’il s’énonce au nom de la
science7. L’économie, comme science du
comportement et pure technique du
calcul généralisé et universalisé, produi-
rait des résultats neutres, l’économie se
dit science et non plus politique.
L’attribu tion du prix Nobel en 1992 à
Gary Becker couronne ce mouvement.
L’indi vidu comme tel, universel, abstrait
et asocial, en prise avec des besoins illi-
mités, est l’unique source de construc-
tion des sociétés : ici l’individualisme
n’est plus méthodologique mais devient
ontologique et même biologique. Cer -
tes, nombre d’économistes sont éloignés
des théories socio-biologiques présen-
tes dans la théorie de Gary Becker, mais
il n’en reste pas moins que la théorie du
capital humain imprègne les orientations
de nombre d’institutions internatio nales
qui ouvrent des programmes dans
de nombreux pays et qui reviennent à
considérer les humains comme des
« ressources ».
Ces postures scientifiques ont pour
effet de diluer la responsabilité de
l’économiste
L’EFFACEMENT
DE LA QUESTION POLITIQUE
ET LA RESPONSABILITÉ
DES ÉCONOMISTES
Si, dans sa visée scientifique, la théorie
économique n’est pas unifiée par
l’étude d’un objet social, en revanche,
dans sa forme dominante et hégémoni-
que, elle est unifiée par des principes
méthodologiques fondés sur l’indivi -
dualisme méthodologique. Dans ce
contexte, la société comme réalité sui
104 Sociétal N° 50 g4etrimestre 2005
4LIVRES ET IDÉES
4CONJONCTURES
4REPÈRES ET TENDANCES 4DOSSIER
LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉCONOMISTE
4. La Méthodologie de l’économie positive, 1953.
5. Joan Robinson, 1970, Freedom and Necessity,
p.120, Allen and Unwin, London.
6. Mises L. von, 1985, L’Action humaine, Traité
d’économie, PUF, Paris. (Première édition, 1949).
7. René Passet, L’Illusion néo-libérale, Fayard,
2000.

generis, au-delà de l’accord des subjectivi-
tés individuelles, n’existe pas. Il n’y a donc
pas, a priori, de responsabilité vis-à-vis
d’elle. Si les préconisations économiques
produisent des catastrophes, c’est du fait
de défaillances des acteurs, d’effets per-
vers8, de défaut d’information ou de
défauts de rationalité, du fait des limita-
tions cognitives des acteurs. Il devient
ainsi plus aisé de comprendre que, si les
politiques dites de « lutte contre la pau -
vreté dans le monde » ne fonctionnent
pas, ces politiques ne seront jamais mises
en cause car finalement la responsabilité
en incombe aux acteurs en général dans
leur mise en œuvre de ces politiques,
et plus particulièrement aux pauvres
eux-mêmes. Voilà pourquoi les écono -
mistes qui inspirent les orien tations de
la Banque mondiale ont-ils pu préconiser
le « consen sus de Washington » et les
politiques d’ajustement structurel qui ont
conduit à des crises sociales dans les pays
du Sud d’une gravité telle que la termino-
logie est abandonnée. Ces mêmes écono-
mistes recommandent aujourd’hui des
politiques de « lutte contre la pauvreté »
qui ne sont qu’un nouvel habillage sous la
formule du nécessaire empowerment.
Alors que, dans la tradition de G. Becker,
les économistes prétendent pouvoir
expliquer l’action sociale dans la logique
du choix individuel rationnel, l’affirma-
tion du caractère scientifique pur de la
théorie les exonère de toute responsa-
bilité. De ce fait toute considération
éthique et politique est rejetée dans la
métaphysique ou encore du côté de
tentations totalitaires. En effet, selon
Frederic Hayek qui occupe une place
centrale dans le renouvellement des
représentations et croyances économi-
ques, le garant de la liberté est la recon-
naissance par les hommes d’or dres
sociaux spontanés, produits de leurs
actions, mais non de leurs desseins, selon
la tradition des Lumières écossaises. De
ce fait, on n’a pas à se soucier de la
cohésion sociale, la place du pouvoir est
laissée vacante, et le marché permet d’é-
vacuer toute tentative de transfor -
mation de l’ordre social, assimilée à un
délire de toute-puissance et à une forme
de totalitarisme. L’opacité du social est
garante de la liberté. La justice ne
concerne que les conduites personnelles
et l’expression « justice sociale » est pri-
vée de sens, à moins de revenir à des
formes de pensée qui, selon cette vision,
font de l’action collective et volontaire
des outils de transformation sociale por-
teurs d’ordres totalitaires. Dans ce cadre
de croyance, aujourd’hui dominant avec
de multiples variantes, poser la respon-
sabilité des économistes est impensable,
voire suspect.
Le renouvellement de l’intérêt pour les
institutions à l’intérieur de la théorie
économique ne contredit pas cette pos-
ture dans la mesure où, contrairement au
vieil institutionnalisme, avec le néo-insti-
tutionnalisme, les institutions sont le pro-
duit du choix des agents, elles sont une
création humaine à un moment donné.
Conformément aux principes d’une phi-
losophie pragmatique, la société écono-
mique est le résultat d’arrangements
volontaires produits par des agents
rationnels (même si la rationalité est limi-
tée, incomplète) qui varient avec les cir-
constances. Contrairement à la grande
tradition de l’économie politique, la régu-
lation de la société globale ne se pose
donc pas.
Les économistes seraient ainsi au-dessus
de tout soupçon. Et pourtant, est-ce au
nom de la neutralité scientifique que l’im-
plication de Milton Friedman dans la défi-
nition de la politique économique au
Chili sous le général Pinochet, et l’expéri-
mentation en grandeur nature de ce qui
deviendra le modèle néo-libéral domi-
nant, peuvent être évaluées ? Que dire de
son influence auprès de la Russie dans la
définition du programme de la transition
à l’économie de marché en cent jours !
En effet, tout comme les économistes
du FMI et ceux proches de l’administra-
tion américaine d’alors, il défendait la
« thérapie de choc » pour la transition
à l’économie de marché. Quand cette
« thérapie » eut produit tous ses effets, la
crise financière a éclaté en 1998. Le FMI
et la Banque mondiale ont alors massive-
ment prêté à la Russie, malgré la corrup-
tion et malgré l’interdiction théorique de
prêts aux États corrompus, largement
appliquée pour de petits États, par exem-
ple pour le Kenya qui s’est vu refuser un
prêt à ce moment-là. Trois semaines
après l’octroi de nouveaux crédits, la
Russie annonçait une suspension unilaté-
rale des paiements et une dévaluation du
rouble. Ces mesures n’ont fait que gon-
fler les avoirs des oligarques russes en
Suisse ou à Chypre, déjà alimentés par les
résultats des privatisations, et conforter
le pouvoir de Boris Eltsine, soutenu par
les gouvernements occidentaux. Le résul-
tat de la thérapie de choc est édifiant :
baisse du PIB, hausse de la pauvreté et
des inégalités, effondrement des classes
moyennes. Comme l’écrit Joseph Stiglitz :
«On a rarement vu un écart aussi gigan-
tesque entre les attentes et la réalité que
dans la transition du communisme au mar-
ché. On était sûr que la combinaison priva-
tisation-libéralisation-décentralisation allait
vite conduire, peut-être après une période
brève de transition, à une immense aug-
mentation de la production9.»
Michel Camdessus, alors directeur du
FMI, n’a jamais désavoué les présupposés
économiques qui avaient guidé les politi-
ques dont il avait la responsabilité.
Pourtant, dans le cas concret de la
Russie, le déni de la nécessaire prise en
compte des conditions sociales des poli-
tiques économiques et l’euphorie de la
toute-puissance du marché se sont
apparentés à une caution donnée à une
corruption manifeste.
Quels que soient les résultats immédiats,
les institutions financières internationales
et les économistes qui les inspirent igno-
rent les effets immédiats de leurs mesu-
res sur un pays, car les effets pervers
sont analysés comme passage obligé,
comme épreuve d’assainissement, pour
un processus à long terme visant au
« développement humain ». Où sont les
interrogations des économistes à propos
de la famine au Niger, longtemps niée et
maintenant traitée comme catastrophe
naturelle ? Les conditions climatiques
ou les invasions de criquets, bien réelles,
sont loin en effet d’en être les seules
causes. Selon les critères des institutions
105
Sociétal N° 50 g4etrimestre 2005
L’ÉCONOMIE EST-ELLE UNE SCIENCE ?
8. A.O.Hirschman, Deux siècles de rhétorique
réactionnaire, Fayard, 1991.
9. J.E. Stiglitz, La Grande Désillusion, p.202, Fayard,
2002.

financières internationales, le Niger est
un bon élève. Engagé depuis 1996 dans
l’initiative PPTE (pays pauvres très
endettés), ses résultats « économiques »
devraient l’autoriser, depuis avril 2004, à
une réduction de dette. Mais pour arri-
ver à cela, le Niger a dû passer toutes les
étapes imposées par le FMI et la Banque
mondiale : réduction drastique des bud-
gets sociaux et des subventions aux pro-
duits de base ; augmentation de la TVA ;
privatisations ; libéralisation commerciale
et mise en concurrence déloyale des
producteurs locaux avec des sociétés
transnationales. La famine peut-elle être
considérée comme un assainissement
nécessaire, un passage obligé pour attein-
dre le « développement humain » ? La fin
justifierait-elle les moyens ?
Face aux désastres écologiques, déjà là
et à venir, qu’ont à nous dire les écono-
mistes orthodoxes ? Passons sur l’hypo-
thèse de gratuité des biens naturels, sur
l’oubli de la nécessaire comptabilisation
de la ponction non réversible sur le
patrimoine naturel. Mais que dire aujour-
d’hui de la perpétuation de la croyance
en l’infinité de la Nature capable de se
régénérer naturellement ou avec des
procédés techniques, de la croyance en
la possible substitution infinie du capital
naturel par du capital artificiel, de la délé-
gation au marché du soin de réguler les
équilibres écologiques ? Le calcul écono-
mique est fondé sur un raisonnement
sur le présent à partir de l’avenir avec
l’hypothèse éminemment contestable de
la réversibilité des décisions et des résul-
tats. Or la mise en évidence de l’irréver-
sibilité de certaines décisions, qui
engagent l’avenir de l’humanité, oblige à
poser la question de la responsabilité et
à réintroduire la dimension éthique et
politique dans les choix économiques.
Parmi de nombreux exemples, citons
celui du Brésil, encouragé à développer
la culture du soja et l’élevage du bétail
pour l’exportation, au détriment de la
forêt amazonienne. La CFI, Corporation
financière internationale, une des institu-
tions faisant partie du groupe Banque
mondiale, a accordé deux prêts à la plus
grande compagnie agro-industrielle de
soja du pays, le groupe Amaggi, au mépris
de l’écosystème du Brésil et du monde,
au mépris des peuples indigènes qui
viennent grossir la masse des pau vres
que par ailleurs la Banque mondiale s’est
donné pour objectif de réduire.
Les économistes qui ont inspiré et légi-
timé ces politiques au nom de la rationa-
lité et de l’efficience portent de fait une
responsabilité écrasante dès lors qu’ils
s’acharnent dans leurs erreurs et perpé-
tuent des modèles qui ont fait la preuve
de leur échec, car ils sont les experts, ou
ils inspirent les experts, qui concourent
à la décision. Et pourtant, tant qu’ils ont
respecté le dogme de l’institution pour
laquelle ils travaillent, ils ne seront pas
inquiétés, d’autant que ce sont eux le
plus souvent qui définissent les critères
de l’évaluation. À quelques exceptions
près, leur mutisme trouve certainement
sa source dans le fait que le raisonne-
ment économique repose sur de grands
équilibres construits à partir des com-
portements individuels abstraits, et non
sur les populations qui subissent ces
programmes. La réduction du monde à
un seul principe, le principe d’efficience
économique, apparaît aujourd’hui morti-
fère pour l’humanité. Qu’ont à dire les
économistes qui étudient « scientifique-
ment » le marché du travail, qui préconi-
sent sa dérèglementation, pour qui
l’injonction au travail fait office de mot
d’ordre de mobilisation générale pour la
« guerre économique », alors que le
droit au travail lui-même, comme droit
fondamental de la personne humaine,
comme fondement de sa dignité, est
remis en cause ? De même la convoca-
tion de la scientificité des décisions en
matière de droits de propriété peut-elle
exonérer les théoriciens et experts du
fait que, pour des raisons économiques
parfaitement pensées, on ne peut distri-
buer des médicaments de lutte contre le
sida dans les pays du Sud ?
CONCLUSION
La responsabilité des théoriciens de
l’économie, des experts qui
concourent aux décisions et diffusent la
pensée, ne peut être répudiée au nom
de la scientificité de leurs affirmations.
Les choix politiques sont largement
sur déterminés ou annihilés par l’invoca-
tion de contraintes économiques, for-
mulées à partir des présupposés de la
pensée dominante. Dans des sociétés
devenues sociétés économiques, l’éco-
nomique tend à primer sur le politique
ou à l’englober. La force de légitimation
des préconisations des économistes
par l’invocation d’une « science écono-
mique » pure ne peut plus suffire.
À l’intérieur de la science physique,
qui, dans sa version newtonienne et
lagrangienne, continue majoritairement
à servir de modèle à la « science éco-
nomique » contemporaine, les cher-
cheurs ont remis en cause leur
conception de la physique « méca -
nique », ont exploré des voies nouvelles
qui ont permis des avancées scientifi-
ques considérables dans le domaine de
la physique quantique par exemple. Par
ailleurs, aux échelles macroscopiques,
plus proches des problèmes de l’écono-
mie, les physiciens ont mis en lumière
des phénomènes d’instabilité ou de
bifurcation qui remettent en cause les
naïvetés déterministes de la mécanique
classique. Il est donc apparemment
paradoxal que les théoriciens de l’éco-
nomie pure ne se questionnent pas
eux-mêmes sur les fondements scienti-
fiques de leur démarche, en particulier
sur la séparation entre l’objet d’étude
et l’observateur, largement remise en
cause par la physique quantique. Sans
nul doute, une telle démarche suppose-
rait, comme c’est le cas dans les scien-
ces physiques, d’accepter un réel
changement de paradigme, plutôt que
de sophistiquer à l’infini le paradigme
walrasien. Cela supposerait également
la reconnaissance du statut particulier
de la science économique comme
science sociale, inextricablement posi-
tive et normative, et un abandon de
position dominante en vue d’une réou-
verture des savoirs. g
106 Sociétal N° 50 g4etrimestre 2005
4LIVRES ET IDÉES
4CONJONCTURES
4REPÈRES ET TENDANCES 4DOSSIER
LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉCONOMISTE
1
/
5
100%