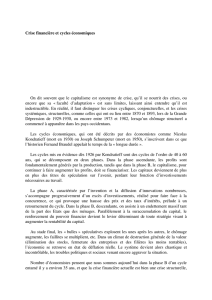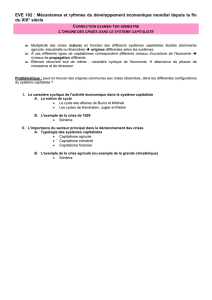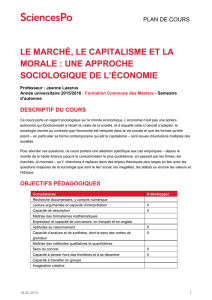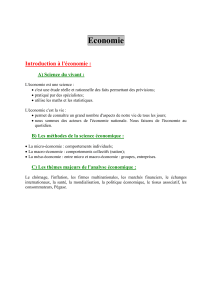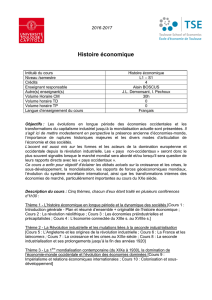L`idéologie sécuritaire du capitalisme : la « gouvernance »

1 THIERRY POUCH
Article paru dans la revue L’Homme et la Société
Numéro 154-2005
L’idéologie sécuritaire du capitalisme : la
« gouvernance »
Thierry Pouch*
es vingt dernières années du vingtième siècle auront été celles
de l’affirmation d’un ordre mondial centré sur la finance. Une
finance globalisée. Dans toutes leurs ambitions, leurs projets,
leurs stratégies économiques, les hommes furent, à partir de là,
sommés de s’en remettre au marché, à ses indicateurs de performance, à
l’efficacité supposée de ses mécanismes d’allocation du capital puisque,
très tôt, les forces sociales qui étaient parvenues à se débarrasser de
l’interventionnisme étatique, les avaient convaincus que la globalisation
financière constituait une « aventure obligée »1.
La période écoulée est suffisamment longue pour pouvoir prendre la
mesure du rôle décisif joué par l’État dans la formation de cette finance
globalisée. Si le terrain avait été préparé depuis longtemps, c’est-à-dire
dès le lendemain de la guerre, par des économistes acharnés et déterminés
à porter le discrédit sur les politiques étatiques d’intervention jugées
inefficaces au regard de l’équilibre spontané du marché, l’acte fondateur
de la globalisation financière s’est situé aux débuts de la décennie quatre-
vingt, lorsque l’Administration républicaine américaine et les
conservateurs anglais, sous l’impulsion de R. Reagan et de M. Thatcher,
persuadèrent les sociétés que, désormais, le profit dicterait les codes de
conduite de chacun d’entre nous. Par un formidable travail de persuasion,
l’ensemble de ces forces sociales, économiques et financières, mais aussi
politiques, intellectuelles, pour l’occasion alliées, réussit à imprégner les
esprits de cette idée selon laquelle la sécurité économique, fondée
antérieurement sur l’intervention de l’État et sur une articulation de
* Université de Marne La Vallée, Laboratoire Organisation et Efficacité de la
Production et Atelier de Recherches Théoriques François Perroux. E-Mail :
1 J’ai bénéficié, lors d’une première version de ce travail, des critiques et suggestions
particulièrement pertinentes adressées par Michel Kail, Richard Sobel et Jean-Pierre
Garnier. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
L

GOUVERNANCE 2
l’économique et du social, constituait une entrave à leur enrichissement, à
leur croissance économique et, par voie de conséquence, à la production
de richesses, signe fondamental au travers duquel pouvait, depuis plus de
deux siècles, s’évaluer le progrès général des sociétés humaines. Libérés
de toutes les formes de contraintes, de réglementations et des systèmes
idéologiques, les flux mondiaux de capitaux ne pouvaient qu’installer,
disait-on, les économies sur un sentier de croissance durable et stable, tout
en garantissant la maximisation des bénéfices à ceux qui y seraient, d’une
manière ou d’une autre, impliqués. L’économie financiarisée pouvait
fonctionner sur le mode du « enrichissez-vous », lancé autrefois par
Guizot.
Mais, l’économie mondiale s’est dérobée. Ces gigantesques flux de
capitaux qui animent depuis plus de vingt ans cette économie mondiale,
n’ont pas réduit les écarts de richesses entre les pôles industrialisés et les
autres régions du monde. Au contraire, ils les ont accentués. On a offert
au capitalisme des degrés de liberté supplémentaires pour surmonter une
crise de rentabilité dont il éprouve quelque difficulté à sortir, mais on a
dé-structuré des sociétés entières en les sommant d’intégrer cette
économie mondiale. Ces flux n’ont pas non plus installé les sociétés sur
un sentier de croissance stable et durable ni permis la baisse du nombre de
sans-emploi.
A pu surgir alors une première menace. Celle de la contestation, dont
on a vu qu’elle pouvait parfois intimider, mais intimider seulement, les
détenteurs de capitaux, les institutions internationales, les gouvernements.
Seattle 1999, Gênes 2001, Cancún 2003. Les grèves de l’automne 1995
en France ont même été perçues comme un, sinon le, point de départ de
cette contestation. Quoi que l’on pense de ce que l’on qualifie désormais
de « nouveaux mouvements sociaux », de leur absence de radicalité face à
la violence du capitalisme, il demeure que leur éclosion a provoqué une
peur chez les tenants de la globalisation financière. Les inégalités se
creusant, des réponses se forment et attisent la critique, et se traduisent
parfois en actes. Cette contestation figure depuis peu dans les
préoccupations relatives au devenir de la globalisation. Il suffit pour s’en
rendre compte de lire l’un des derniers rapports du Conseil d’Analyse
Économique, intitulé « Gouvernance mondiale », pour prendre la mesure
de l’inquiétude, voire de la peur, qui s’est emparée des experts placés
auprès du Premier Ministre de la France, les obligeant à intervenir et à
mobiliser leurs savoirs afin de proposer un ou des modes de
« gouvernance »2.
De manière pratiquement concomitante, une seconde menace s’est
révélée. La multiplication des faillites, des contre-performances, des
2 Lire P. Jacquet, J. Pisani-Ferry et L. Tubiana [2002], Gouvernance mondiale, Conseil
d’Analyse Économique, La Documentation française.

3 THIERRY POUCH
révélations de comptes falsifiés, ou, en d’autres termes, la montée de
l’instabilité financière des entreprises, a été un puissant révélateur des
crises endogènes que connaît l’entreprise. Mais là encore, il est stupéfiant
de constater que ces crises financières propres à la firme soient imputées à
un manque de transparence des comptes, à une défaillance de la
« gouvernance » d’entreprise. L’urgence d’une réflexion assorties de
propositions pour gouverner l’économie mondiale s’est amplifiée après
les attentats du 11 septembre 2001.
Que ce soit à l’échelle mondiale ou à celle de la firme, les économistes
ne ménagent plus leurs efforts pour définir, presque dans l’urgence, des
procédures visant à stabiliser à court terme et à réguler à plus long terme
la finance globalisée. Efforts pour re-posséder, s’emparer pour mieux les
réactiver, des promesses qui se sont dérobées. D’où le maître mot de
« gouvernance », mot magique qu’il va s’agir ici de décortiquer, afin d’en
saisir les fondements, mais surtout, d’en dégager les objectifs non
affichés. Notion partout présente désormais, envahissant la littérature sur
les relations internationales, les crises qui les ponctuent ou qui les
structurent. De cette « gouvernance », on escompte une capacité à
identifier les risques dont est porteuse la finance globalisée, à prévenir les
crises financières, les crises bancaires et de change, à préserver les
bienfaits du capitalisme. Ces trois fonctions de la « gouvernance »
conduisent à penser que les économistes se font parfois sismologues, vis-
à-vis desquels les populations expriment des demandes pour que leurs
savants calculs prévisionnels les préviennent des séismes.
C’est pourquoi on s’attachera dans un premier temps à localiser
l’origine de la notion de « gouvernance » et en quoi celle-ci traduit le
souci de la sécurité dans une économie ayant voulu s’affranchir de toutes
les formes d’intrusion dans les mécanismes de marché, au sens étatique
du terme. On ne s’y attardera pas bien longtemps tant est connu l’emprunt
d’une telle notion effectué par l’économie à la gestion. En revanche, on
s’arrêtera suffisamment dans un second temps sur ses fonctions, sur ce
que l’on attend d’elle en matière de sécurité économique et financière
dans un capitalisme toujours en crise et en proie à des formes
embryonnaires ou affirmées de contestation. Car, au-delà d’une recherche
de sécurité, la « gouvernance » va exercer un rôle tout à fait particulier sur
le monde social. Davantage qu’une simple sécurité des marchés
financiers, la « gouvernance » exprime la recherche d’un intérêt collectif,
un « bien public mondial » pour reprendre une terminologie très
économique. On pourra suggérer, à partir de là, une interprétation du type
de société que le capitalisme globalisé est en train de préparer au travers
de cette « gouvernance ». L’article se terminera sur une analyse de la
demande de « gouvernance », car la notion n’a acquis de légitimité que
parce qu’elle a été nourrie par les critiques des organisations non
gouvernementales. On montrera que, pour participer à l’écriture de

GOUVERNANCE 4
l’histoire de la mondialisation, ces ONG n’hésitent pas à se rendre
complices des acteurs de la mondialisation capitaliste.
Small is beautiful
L’acharnement avec lequel les économistes d’obédience monétariste
et/ou autrichienne ont œuvré pour que toute forme d’interventionnisme
étatique disparaisse du champ et de la pratique économiques, a fait voler
en éclats le système keynésien, système tant regretté aujourd’hui par une
large frange de la communauté des économistes, voire des alter-
mondialistes, et fait se propager la finance par delà les frontières3. C’est
de cette globalisation financière que l’on attendait les regains de
croissance, de nouvelles dépenses d’investissements axées sur le
développement de la cognition et de l’immatériel, la baisse du chômage,
une meilleure donc plus efficace allocation des facteurs de production, et
plus spécifiquement du capital. Bref, de cette globalisation financière
devait se dessiner une sortie de crise. Toutes les barrières sont tombées
rapidement, à commencer par cette première entaille de 1971 dans le
dispositif de pilotage des taux de change et de la circulation des capitaux
que furent les accords de Bretton-Woods signés en 1944. C’est bien parce
qu’ils incarnaient la puissance de l’État que les dispositifs de sécurité
monétaire et financière furent progressivement démantelés. Or, depuis
1971, les crises financières, bancaires et de change, voire les trois à la
fois, sont plus nombreuses que lorsque le processus de pacification des
relations monétaires et financières opérait dans l’économie mondiale
après la signature de ces accords de Bretton-Woods4. Puisqu’elles
exercent un impact réel, souvent brutal, sur les décisions d’investir et sur
la croissance et l’emploi, les crises financières, bancaires ou de change
doivent être maîtrisées rapidement avant qu’elles ne se généralisent et se
transforment en une crise mondiale qui rappellerait l’épisode des années
trente.
L’originalité de la période actuelle réside dans le risque de contagion
des crises. Un choc local peut se transformer, étant donné l’état
d’intégration de l’économie et de la finance mondiales, en crise globale
durant laquelle les comportements des agents deviennent mimétiques, se
modifient brutalement au risque de devenir irrationnels et de
compromettre la détermination des prix des actifs financiers et
3 Nous distinguons volontairement l’école de Chicago monétariste, regroupée autour de
Milton Friedman, et l’ école autrichienne, dont l’une des chefs de fil fut Friedrich A. Hayek.
Distinction d’autant plus importante que, la plupart du temps, il arrive qu’on les assimile
abusivement.
4 Un certain consensus semble se former autour de ce constat d’une progressive mais
réelle multiplication des crises financières. Lire par exemple R. Boyer, M. Dehove et D.
Plihon [2004], Les crises financières, Rapport du CAE, La Documentation française, B.
Eichengreen [2003], Capital Flows and Crises, The MIT Press, ou A. Orléan [1999], Le
pouvoir de la finance, éditions Odile Jacob.

5 THIERRY POUCH
l’allocation des capitaux. S’exprimant au travers de la notion de
« gouvernance », le besoin de sécurité dans et pour l’économie mondiale
traduit l’angoisse des marchés de voir se dévaloriser les capitaux, les
dettes ne pas être remboursées, l’intermédiation bancaire se disloquer et
compromettre ainsi le mode de financement général de l’économie et des
échanges internationaux par la multiplication de faillites et la contraction
du crédit. La multiplication des appels à une meilleure « gouvernance »
économique et financière constitue l’indice d’une panique qui s’est
emparée des économistes et des politiques. Ce qui est en jeu est la
poursuite de la production de richesses, le maintien en vie du capitalisme
et la pérennité de la démocratie5.
Mais les instruments traditionnels de la politique économique ayant été
happés, phagocytés par le processus de dérégulation et apparaissant de
moins en moins efficaces, en tout cas incapables de porter remède à
l’instabilité financière et à ses effets immédiats sur l’économie réelle, il
fallait déployer des analyses destinées à construire des procédures de
gestion, des méthodes de gouvernement destinées à prévenir les crises
financières. Dans le même temps, la nécessité de déployer de nouveaux
principes de légitimation de la mondialisation repose sur la prise de
conscience que la montée de la contestation à l’échelle mondiale prend
pour cible les principales institutions internationales à qui l’on reproche le
manque de transparence et de servir les intérêts des puissances
dominantes.
Aussi s’est-on tourné vers l’entreprise, qui a très tôt posé le problème
de sa « gouvernance », c’est-à-dire des relations internes entre toutes les
parties concernées par le devenir de l’entreprise, en l’occurrence les
propriétaires ou actionnaires et les mandataires qui ont la charge de
définir et d’appliquer des instruments pour atteindre des objectifs
conformes aux intérêts de ces détenteurs de droits de propriété sur
l’entreprise6. L’efficacité de la « gouvernance » de l’entreprise repose
alors sur l’engagement de chaque partie à respecter les contrats qui les lie
aux autres. L’idée de « gouvernance » ne se réduit pas, par conséquent, à
un clivage, à une maîtrise du rapport de force entre les actionnaires et les
gestionnaires-managers. En effet, dans la mesure où l’entreprise
recherche des instruments lui permettant de persévérer dans son être
économique et financier, les détenteurs de droits de propriété ont tout
intérêt à impliquer les autres acteurs de l’entreprise en les convainquant
que, en cas de défaillance, ils ont eux aussi, beaucoup à perdre. Toute une
chaîne d’intérêts se trouve comme sous-tendue par le devenir de
5 C’est l’un des points que développent des auteurs comme M. Aglietta et A. Rébérioux
[2004], Les Dérives du capitalisme financier , éditions Albin Michel, notamment dans le
chapitre IX.
6 Sur l’histoire de la gouvernance, lire l’ouvrage de R. Pérez [2003], La gouvernance de
l’entreprise, éditions La Découverte, coll. « Repères ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%