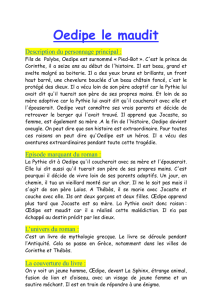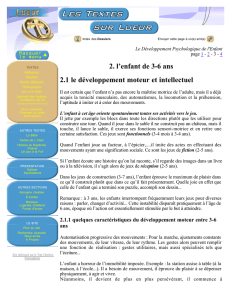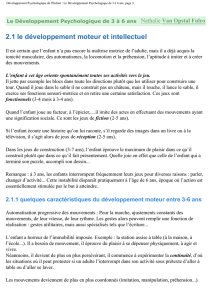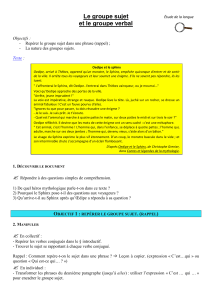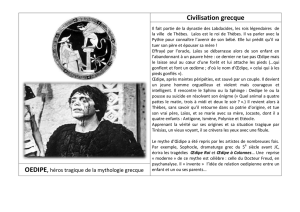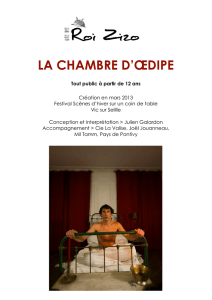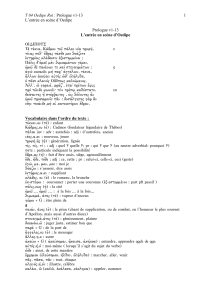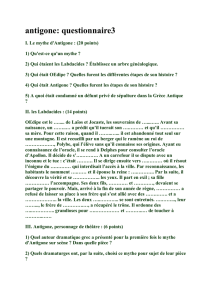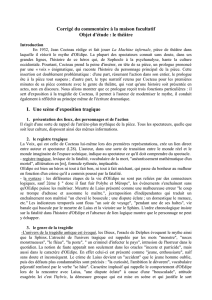dossier pedagogique - La Charge du Rhinocéros

ŒDIPE À LA FERME
D’après Sophocle
Avec Ivan Fox et Claude Semal
Avec la complicité artistique de Diane Broman
Une coproduction Charge du Rhinocéros / Théâtre du Chien Ecrasé / Ça t’as vu !
DOSSIER PEDAGOGIQUE
Œdipe avait déjà été mangé à toutes les sauces : sur la route, en complexe ou à la
royale… Claude Semal et Ivan Fox racontent à leur tour cette fabuleuse histoire avec
des marionnettes, des poulets, des poireaux, quelques ustensiles campagnards, des
chansons…
Ces joyeux iconoclastes n’oblitèrent pourtant pas la trame originelle du mythe :
l’Oracle, l’enfant adopté par le roi de Corinthe, le meurtre de Laïos, le retour à
Thèbes, l’énigme du Sphinx, la coucherie avec la mère, le châtiment… Tout y est,
mais la tragédie est retournée comme un gant. Elle devient une farce toute crue
blottie parmi les bottes de paille.
« Sophocle s’y retrouve pour l’essentiel. Semal et Fox pour le reste : le détail qui tue,
l’intonation qui fait mouche, l’irrévérence sans irrespect. Il fallait l’oser, ils l’ont
fait. » (La Libre Belgique)
« Au total, Œdipe à la Ferme comptera quelques scènes d’anthologie » (Le Soir)

I. Introduction
Oedipe avait déjà été mangé à toutes les sauces : sur la route, en complexe ou à la
royale… Claude Semal et Ivan Fox racontent à leur tour cette fabuleuse histoire avec des
poulets, des poireaux, quelques ustensiles campagnards, des chansons… Ces joyeux
iconoclastes n’oblitèrent pourtant pas la trame originelle du mythe : l’Oracle, l’enfant
adopté par le roi de Corinthe, le meurtre de Laïos, le retour à Thèbes, l’énigme du Sphinx,
la coucherie avec la mère, le châtiment…Tout y est, mais la tragédie est retournée comme
un gant. Elle devient une farce toute crue blottie parmi les bottes de paille.
Mais pourquoi donc mettre en scène une n
ème
version de ce célèbre mythe ? Non pas
dans le but de rivaliser avec les pièces du grand Tragique grec Sophocle mais afin
d’explorer certains thèmes de société auxquels nous sommes toujours confrontés à
l’heure actuelle. Considéré en effet comme l’un des récits fondateurs de notre société
occidentale, il nous permet de réfléchir sur certaines problématiques essentielles comme
l’universel tabou de l’inceste (indispensable pour la survie et l’organisation d’une société)
et de manière plus générale, l’émancipation des enfants à l’égard des adultes (et
réciproquement), qui, à défaut, peut parfois conduire à certains abus sexuels. En incise,
d’autres concepts seront abordés ; comme la démocratie, sa signification antique et
actuelle, ou encore la psychanalyse qui a donné naissance au désormais très célèbre
« complexe ». Car, qui pourrait aujourd'hui ignorer, après les travaux de Freud,
l'importance des toutes premières expériences familiales et le poids de l'inconscient dans
la construction de sa propre personnalité ?
Mais attention, n’espérez pas trouver dans « Œdipe à la ferme » de longues tirades
pédantes et ennuyeuses, ni même de profondes réflexions philosophiques ! Car comme
son titre le suggère, la pièce n’a jamais eu la prétention de rejoindre le grand répertoire
classique qu’il parodie. Le début de la pièce donne déjà le ton : sur un air de Sirtaki et
devant une série d’affiches dénichées dans quelque office du tourisme grec, nos deux
comédiens apparaissent sur scène affublés d’un carton plié en guise de jupe et d’un bas
nylon sur la tête ; déguisement qui suffira à les métamorphoser en un couple grec version
Dupond et Dupont ! S’ensuit alors des réflexions loufoques et drôles sur la difficile
invention de la démocratie, mêlées à quelques notions de Grèce antique passées à la
moulinette, qui les conduiront à nous narrer l’histoire d’Oedipe dans un univers bucolique
de bottes de paille. En effet, nos comédiens ont choisi de raconter cette histoire avec des
oeufs, des poules, des légumes et autres objets campagnards, dans la grande tradition du
Théâtre d'objets et de marionnettes. L’œuf et la poule, c'est bien sûr ici, symboliquement
parlant, la mère et l'enfant. Mais il y a plus : l’utilisation de ces animaux et objets
quotidiens en tant qu’acteurs, crée ainsi un certain décalage à l’origine de situations
poétiques et humoristiques. Poursuivant cette même volonté de démystifier le grand
théâtre classique, d'autres petites formes burlesques (qui pourront apporter un autre
éclairage sur l’histoire) seront développées parallèlement à ce récit premier.
Ainsi, diront-ils, « depuis toujours, notre démarche artistique tente de concilier l'univers
théâtral "traditionnel" (tragédie, comédie,…) avec des formes populaires (chansons et
danses dans le style music-hall, magie, théâtre d'objets et de marionnettes,...) qui, parce
qu'elles nous touchent et touchent tous les publics, nous semblent pouvoir renouer avec la
profondeur des textes théâtraux fondateurs. "Oedipe à la Ferme" raconte d'abord, avec les
moyens qui nous sont propres, une histoire et un mythe qui constituent un des récits
fondateurs de l'humanité. Derrière cette mise en scène ludique et originale, le spectateur
pourra donc à sa guise puiser des thèmes de réflexions ou tout simplement s’évader et
rire le temps d’un spectacle ».

II. Qu’est ce qu’un mythe ?
Ce terme recouvre différentes significations. Au sens commun par exemple, il s’agit d’une
représentation idéalisée d'une personne ou d'un évènement déterminant un phénomène
de croyance collective. Dans le cas qui nous occupe, le mythe désigne plutôt un récit
fabuleux relatant un évènement passé, à l'origine d'une conduite humaine actuelle.
Même si les mythes grecs nous semblent ancrés dans la très lointaine Antiquité (et à
jamais condamnés à être relégués au rang des récits légendaires), la littérature, la
sociologie et l'ethnologie ont souligné, ces vingt dernières années, l'importance des
mythes et leur rôle dans la construction d'une pensée collective, variable selon les
civilisations et l'histoire des mentalités.
Dans un régime démocratique par exemple, les mythes, parce qu’ils défendent des
valeurs partagées par un même ensemble d’individus, auraient pour mission de fédérer
les membres d’un groupe en mettant en évidence leurs points communs plutôt que leurs
différences.
A la base des idées, des religions, des manières d'être et de penser de ces sociétés,
l'ensemble des mythes forgés au cours du développement des sociétés aurait donc le
pouvoir de souder leurs membres entre eux. C’est pourquoi, on pourrait dire que les
mythologies constituent le fondement de toutes les civilisations.
Les mythes ont une fonction illustrative. En mettant en scène un personnage dans un
contexte précis, ils donnent forme à un problème que nous percevons plus ou moins
distinctement. Les mythes assument ensuite une fonction explicative : ils permettent
d'apporter des solutions aux difficultés que l'homme rencontre dans son existence. Le
mythe d'Oedipe, par exemple, met en scène les problèmes des relations familiales, en
instaurant le tabou de l'inceste comme premier élément de la structure familiale et du
groupe social.
III. Le mythe d’Oedipe
La légende d’Oedipe nous a été transmise essentiellement par la version qu’en donnent
les tragiques, spécialement dans « Oedipe Roi » et « Oedipe à Colone », de
Sophocle…C’est à ce personnage tragique qu’on se réfère le plus souvent lorsqu’on parle
du mythe d’Oedipe. C’est lui que visent en particulier l’interprétation de Freud et
l’appellation, qui en dérive, le complexe d’Oedipe.
Les origines de cette légende remontent toutefois bien avant ces tragédies du 5
ème
siècle
av. J.-C. On la retrouve notamment dans les œuvres d’Homère.
Avant d’être coulée dans le moule tragique, la légende oedipienne se rattache à un vaste
ensemble mythique, « le cycle thébain », centré sur les origines de Thèbes…En ce sens,
on ne saurait parler, strictement, d’un mythe d’Oedipe mais d’une mythologie thébaine
dont l’histoire d’ Oedipe constituerait un chaînon…

III.1. Approche littéraire, théâtrale et artistique
A. Une version antique : « Œdipe roi »
. Sophocle (496 – 406 av. J.-C.)
D’abord danseur, comédien, musicien, on se souviendra surtout de
Sophocle comme l’un des trois principaux tragiques de la Grèce
antique, à côté d’Eschyle et d’Euripide, ses contemporains. Si
Eschyle, en inventant le dialogue entre deux acteurs, est le fondateur
du théâtre tel qu'on l'entend en Occident, c'est Sophocle qui en
développe les mécanismes et en saisit les extraordinaires possibilités.
Parallèlement à sa carrière théâtrale, Sophocle occupa des hautes
fonctions politiques, militaires et mêmes religieuses. Citoyen engagé
dans la vie d’Athènes, Sophocle a connu et fréquenté tous les grands
hommes de son temps, et notamment Périclès. Ainsi, on retrouve
dans les tragédies de Sophocle l’écho de ses préoccupations civiques.
Il s'interroge sur le rôle de la raison et de la volonté dans la vie
individuelle et collective. Interpellé par cette question de la connaissance de soi, il se
demande si les fautes que l'on commet par ignorance, comme celles d'Oedipe, ne sont
pas les plus dangereuses et les plus dévastatrices. Marqué par les grands évènements
politiques et militaires de son époque (l’hégémonie d’Athènes, les années d’or du siècle de
Périclès, la montée de l’impérialisme athénien, la guerre du Péloponnèse et la défaite
d’Athènes,…), tout son théâtre se fera le reflet des douleurs athéniennes et sera traversé
par une préoccupation majeure : la survie de la Cité. Un peu comme le fera Shakespeare,
ses pièces s'ouvrent sur des cités en état de crise - la peste dans Oedipe Roi, l'incertitude
au lendemain d'une guerre civile dans Antigone - et montrent le prix du rétablissement de
l'ordre et de la paix. De son abondante production (entre 115 et 130 pièces), il ne nous
reste que sept tragédies: Ajax, Antigone, Électre, Oedipe Roi, les Trachiniennes,
Philoctète et Oedipe à Colone ; et une moitié du drame satyrique les Limiers.
. L’histoire
La date exacte de la représentation d’ « Oedipe Roi » demeure inconnue. On suppose
cependant qu’elle fut écrite après la fameuse peste d’Athènes (430-429 av. J.-C.) qui
décima la ville après la défaite d’Athènes contre Sparte dans la guerre du Péloponnèse.
C'est d'ailleurs sur une peste terrible que s'ouvre la tragédie : à Thèbes, les récoltes
pourrissent, les hommes et les troupeaux sont frappés par la mort. Oedipe règne sur cette
cité dont l’ancien roi Laïos a été mystérieusement tué lors d’un voyage. Après avoir délivré
Thèbes du terrible Sphinx qui terrorisait la cité depuis la mort de Laïos, le peuple l'avait
proclamé roi, qui aussitôt avait épousé Jocaste, la veuve de Laïos. Pour affronter cette
peste, Oedipe envoie alors Créon, le frère de Jocaste, consulter un oracle. La réponse de
l'oracle est claire : le meurtrier de Laïos est à Thèbes et les malheurs de la cité cesseront
lorsqu'il en sera chassé. Oedipe, avec détermination, décide de faire la lumière sur la mort
de Laïos. Les révélations de Jocaste, puis celles d'un messager de Corinthe où Oedipe a
grandi, puis d'un vieux berger autrefois au service de Laïos révèlent peu à peu la vérité :
Laïos était son père et il l'a tué ; Jocaste était sa mère et il l'a épousée. La cause de la
peste et des malheurs qui s'abattent sur Thèbes, c'est lui-même. La lumière de la vérité lui
est insupportable : il se crève les yeux juste après le suicide de Jocaste.

. Le genre théâtral : la tragédie
« Œdipe roi » marque une étape importance dans l’histoire du théâtre occidental. En effet,
cette oeuvre a été considérée par Aristote comme le modèle du genre. Définie comme la
tragédie idéale, elle fut donc particulièrement analysée et imitée par des écrivains de
l’antiquité et du 17
ème
siècle classique français.
Le genre tragique apparaît ainsi à la fin du 6
ème
siècle av. J.-C. Cependant, malgré la
quantité de tragédies écrites à cette époque, nous n’en avons conservé qu’une trentaine
et retenu uniquement trois grands noms : Sophocle, Euripide et Eschyle. Tout trois
puiseront dans le même fond commun mythique et voudront rendre une vision politique et
sociologique de la cité athénienne tout en essayant de véhiculer un enseignement
religieux ou civique. La tragédie apparaît d’ailleurs à un moment très précis de l’histoire de
la Grèce : l’avènement du droit dans la cité athénienne et la distanciation à l’égard des
valeurs religieuses. C’est pourquoi, si l’auteur tragique se réfère à l’histoire des légendes
et des héros, il confronte, en même temps, celle-ci à l’actualité. Le héros de la tragédie
devient un être problématique : sa conscience se trouve écartelée entre la pensée
religieuse traditionnelle et la pensée politique et juridique moderne. Ainsi, à la différence
de la société religieuse antique où l’être humain était régi par un destin décidé par les
Dieux, l’homme devient progressivement un sujet autonome responsable (juridiquement)
de ses actes. Ce conflit de valeur, dû à l’avènement du droit dans la cité grecque, se
reflétera donc dans ce genre nouveau qu’est la tragédie. Ainsi, dans « Oedipe Roi », la
question de la culpabilité d’Oedipe dans le meurtre de Laïos suscite un certain débat :
dans quelle mesure était-il réellement responsable de ses actes ? Selon Jean-Pierre
Vernant, « le moment tragique est donc celui où une distance s’est creusée au cœur de
l’expérience sociale, assez grande pour qu’entre la pensée juridique et politique d’un part,
les traditions mythiques et héroïques de l’autre, les oppositions se dessinent clairement ».
C’est pourquoi, on voit apparaître « le brusque surgissement du genre tragique à la fin du
6
ème
siècle av. J.-C. dans le moment même où le droit commence à élaborer la notion de
responsabilité en différenciant de façon encore maladroite et hésitante le crime volontaire
du crime excusable ».
La tragédie grecque est identifiable par une forme littéraire fixe : elle est écrite en vers et
selon un jeu subtil de combinaison entre des syllabes courtes et longues. La plupart du
temps, la tragédie débute par un prologue qui expose l’action et se termine par le final ou
exodos. Entre les deux, Elle est constituée d’une alternance entre des parties parlées
(épisodes) par les acteurs ou le coryphée et des parties chantées et dansées (stasima)
par le chœur qui s’accompagnait généralement de divers instruments de musique.
En moins d’un siècle cependant, ce théâtre connaît déjà plusieurs changements : la
tragédie devient plus réaliste, accordant plus d’importance à l’intrigue et aux personnages.
Sa structure continuera à évoluer fortement au point de devenir méconnaissable, tant les
auteurs rechercheront l’originalité et la surprise en innovant sans cesse tant du point de
vue dramatique que scénographique…Plusieurs siècles plus tard, ces grands récits
mythiques, véhiculés par le genre tragique, sont encore et toujours exploités…
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%