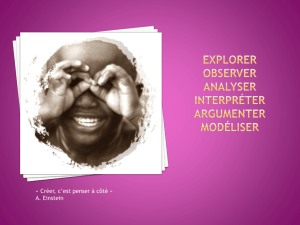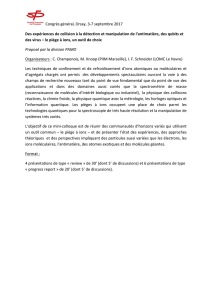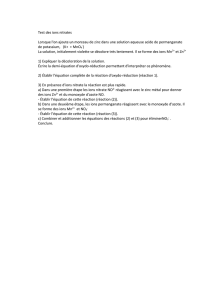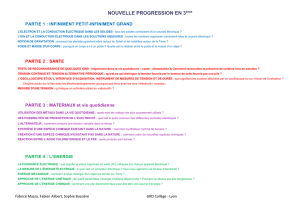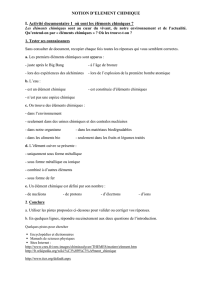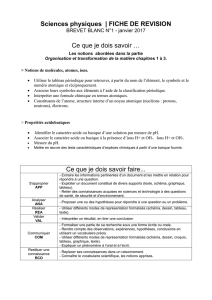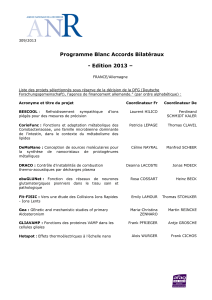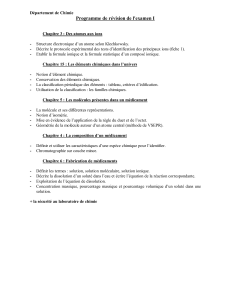Doc12_Séance4_Ions

Page 1 sur 3 Doc12_Séance4_Ions
Copyright Réseau Canopé 2014
L'hypothèse de l'existence d'espèces chargées en solution aqueuse :
les ions
Svante August Arrhenius (Свaнте Август Аррениус) a fait des études de physique et s'intéresse
très tôt à la conductibilité de solutions aqueuses, les électrolytes. Le phénomène, qui est surprenant,
avait intrigué de nombreux physiciens et chimistes (Berzélius, Faraday, Clausius, ...) : on part de
deux substances, le soluté (sel sous forme de cristaux, acide pur souvent sous forme moléculaire) et
le solvant qui est l'eau. Les deux corps sont pratiquement des isolants alors que la solution obtenue
après dissolution laisse passer le courant électrique. Et on obtient de nouveaux produits aux
électrodes.
Pour interpréter le phénomène, Arrhenius fait l'hypothèse de la dissociation des molécules neutres
électriquement en espèces chargées.
Avec le recul, on peut penser que l'idée était simple. Le fait que le courant électrique passe entre des
électrodes soumises à une différence de potentiel ne peut être expliqué que par l'existence de
charges mobiles dans la solution.
Pourtant, Arrhenius a rencontré de grandes difficultés à faire admettre son hypothèse.
Fin XIXème, début XXème siècle, les notions d'atome et de molécule, ont déjà du mal à s'imposer. Il
faut d'ailleurs reconnaître que les savants français (Berthelot, Duhem, …) sont peu réceptifs aux
idées nouvelles. Mais des réactions du même ordre ont lieu dans tous les pays. Comme pour
l'atome, après un refus initial, on était progressivement passé à une semi-reconnaissance : les ions
n'existent pas mais tout se passe comme si ..., c'est un moyen commode de raisonnement ...,
admettons provisoirement que … Cet absence d'enthousiasme est peu propice au progrès.
En outre, la période est celle du triomphe de de « l'énergétisme »1 qui, pour beaucoup, suggère une
structure continue de la matière et semble difficilement compatible avec l'existence de grains2, 3.
Et puis, à peine les molécules sont-elles admises que Arrhenius suggère de les dissocier, c'est-à-dire
de les « démolir ». C'est probablement beaucoup demander à des scientifiques un peu trop prudents.
En France, dans l'enseignement de la chimie au lycée, jusque dans les années 1950, l'existence des
ions était discutée ou admise seulement à contrecœur. On écrivait encore au début des années 1960,
75 ans après la publication des travaux d'Arrhenius, les équations chimiques « sous forme
moléculaire ». Par exemple, on considérait que « l'action de l'acide chlorhydrique sur la soude »
était correctement représentée par : NaOH + HCl → NaCl + H2O
Il est juste de dire qu'on écrivait également la forme ionique. Mais, 2 écritures, c'est une de trop.
Arrhenius a l'audace de supposer que, en solution, il existe des espèces chargées, les ions, obtenues
par dissociation des molécules (ou des cristaux) du soluté. D'autres avant lui (Faraday, Clausius, …)
avaient eu la même idée mais n'en avaient pas tiré toutes les conclusions. Le mot « ion » est dû à
Faraday qui pensait que les ions étaient produits lors de l'électrolyse. Arrhenius formule l'hypothèse
1 c'est-à-dire de la thermodynamique, au moins sous une forme un peu naïve. La « croyance » dans l'énergétisme de
Ostwald (soutenu par Ernst Mach qui était à moitié fou mais qui pouvait subjuguer même Einstein) dans les années
1895-1896 n'est évidemment pas le meilleur de son œuvre. Quand les plus grands se trompent, ils ne font pas les choses
à moitié ….
2 Planck et Einstein seront eux aussi confrontés à ce genre de difficultés mais ils les surmonteront, le premier avec de
grandes difficultés.
3 Mais Rudolf Clausius, grand spécialiste de thermodynamique, a toujours soutenu Arrhénius.

Page 2 sur 3 Doc12_Séance4_Ions
Copyright Réseau Canopé 2014
qu'ils existent même en l'absence de courant mais il doit surmonter bien des obstacles. Son directeur
de thèse, Per Teodor Cleve, chimiste reconnu, peu convaincu de la valeur des travaux de son élève,
ne voulait pas élever celui-ci au rang de docteur. Finalement, il lui a accordé la plus basse
appréciation, ce qui devait l'empêcher d'obtenir un poste dans l'enseignement supérieur. À la fois
prudent et sûr de lui, Arrhenius avait envoyé son mémoire à 3 grands physico-chimistes, Wilhelm
Ostwald (Вильгельм Фридрих Oствальд), Rudolf Clausius et Jacobus Van't Hoff. Ceux-ci ont
immédiatement reconnu ses mérites et le premier l'a invité à venir travailler à Riga dans son
laboratoire. Ce mémoire est reconnu comme pièce ayant valu à Arrhenius le prix Nobel de chimie 4.
Auprès du grand public, Svante Arrhenius n'a pas connu une gloire comparable à celles de
Copernic, Galilée, Einstein, … Mais ses travaux sont d'une très grande importance : la théorie des
ions est à la base de la chimie moderne et a notamment permis la mise au point de générateurs
électrochimiques (piles et accumulateurs) en même temps que des progrès importants dans
l'obtention de métaux d'une grande pureté par électrolyse.
Il faut également savoir que Arrhenius propose en 1884 une théorie de l'acido-basicité qui a
longtemps été enseignée en France. Il n'est pas judicieux de l'étudier car il ne faut pas tout mélanger.
De nombreuses théories ont été proposées dans les années 1920-1930 : Brønsted et Lowry,
Usanovitch (Михаил Ильич Усанович), Lux et Flood, ...5. En classe de Terminale S, le programme
impose la théorie de Brønsted qui présente notamment l'avantage de préciser le rôle du solvant
(l'eau) et peut être généralisée à d'autres solvants. Il n'est pas judicieux d'en aborder une autre en
classe de 1ère. Tout cela n'enlève rien au génie d'Arrhenius 6, 7.
Il est possible d'aborder la théorie de Brønsted en section européenne. Mais l'esprit dans lequel est
conçu ce dossier est de chercher des sujets permettant la présentation d'expériences simples et
amusantes. Ce n'est pas tout à fait ce que permet l'exposé de la théorie de Brønsted. Celle-ci est
plutôt l'interprétation de phénomènes connus.
Reprenons la conclusion de Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Svante_August_Arrhenius
Sa théorie [celle d'Arrhenius, c'est-à-dire l'apparition des ions dans l'eau par dissociation des
molécules du soluté] est d'abord mal reçue par la communauté scientifique, qui la considère comme
fausse. Elle sera cependant peu à peu acceptée pour finalement former l'une des pierres angulaires
de la chimie physique et de l’électrochimie modernes.
Suggestions
Le document 5_Séance4_les_Ions présente un questionnement possible. D'autres suggestions sont
précisées ci-dessous.
4 Ostwald est lauréat Nobel 1909. Arrhenius, qu'il a beaucoup aidé, l'est 6 ans plus tôt, en 1903.
5 Il y a aussi la théorie de Lewis qui aborde des sujets un peu différents
6 Arrhenius avait pour objectif d'expliquer les résultats obtenus avec les solutions aqueuses. Ses successeurs voulaient
généraliser et interpréter d'autres réactions. La théorie de Brønsted est plus puissante mais peut paraître plus abstraite et
plus formelle. Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir, il convient de se conformer à la lettre et à l'esprit des
programmes.
7 Les acides d'Arrhenius sont les acides qui viennent à l'esprit du non spécialiste : acides chlorhydrique, nitrique,
sulfurique, acétique, citrique, …. Brønsted propose de généraliser en introduisant la notion de couple acido-basique.
C'est ainsi que l'ion ammonium, membre du couple ion ammonium/ammoniac, devient un acide.

Page 3 sur 3 Doc12_Séance4_Ions
Copyright Réseau Canopé 2014
• Les électrolytes sont des solutions aqueuses qui laissent passer le courant et sont
décomposés par lui. L'eau pure (le solvant) et les corps dissous (soluté), pris isolément, sont
(pratiquement) des isolants. Le mélange est conducteur. Que s'est-il passé lors de la dissolution ?
• Hypothèse de l'existence de particules chargées (les ions) qui résultent d'une dissociation des
molécules du soluté (Arrhenius et Ostwald). Faraday pensait que les ions n'apparaissaient que lors
de l'électrolyse.
• Arrhenius est suédois, né près d'Uppsala où il passe ses diplômes et sera professeur avant
d'aller à Stockholm. Ostwald, Germano-Balte donc russe, à Riga, sera professeur à Dorpat (Tartu),
Riga et Leipzig. Le second fait venir le premier à Riga pour travailler à Riga. Souvenir d'une
époque où on pouvait facilement aller d'un pays à un autre et où la science n'avait pas de frontières
• Les ennuis d'Arrhenius lors de sa soutenance de thèse et les voyages à Riga (Ostwald), à
Würzburg (Kohlrausch), à Graz (Boltzmann) et à Amsterdam (van't Hoff)
• Expériences de migration d'ions, d'électrolyse ; dépôt électrolytique ; galvanoplastie
découverte par Jacobi)
• Piles et accumulateurs
• Les nouveaux composants (« lithium ion »)
• Le problème de l'opération de charge des accumulateurs
1
/
3
100%