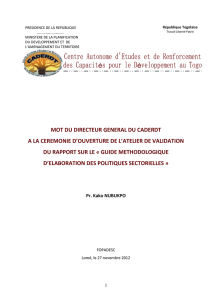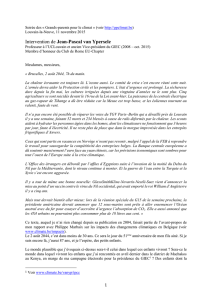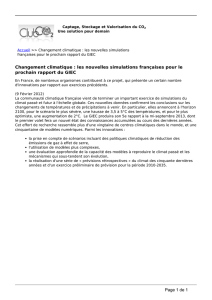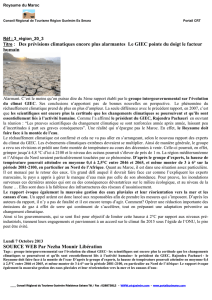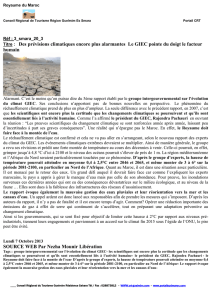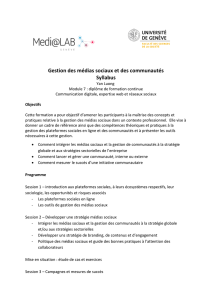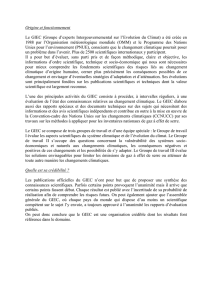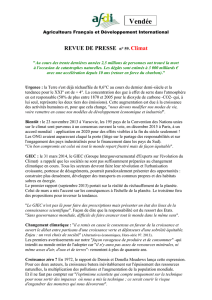avanT-ProPoS

bruylant
avanT-ProPoS
Les changements climatiques représentent aujourd’hui un défi majeur
pour nos sociétés. Rapport après rapport, le Groupe intergouverne-
mental d’experts sur le climat (GIEC), créé en 1988, a posé le diagnostic
des changements climatiques à l’échelle internationale et peu à peu
réduit la marge d’incertitude initiale. Rendu en 2007, son quatrième et
dernier rapport est le plus alarmiste. Il confirme que « le réchauffement
du système climatique est sans équivoque ». Il ajoute que « l’essentiel
de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis
le milieu du XX
e
siècle est très probablement attribuable à la hausse
des concentrations de GES anthropiques ». L’incidence des activités
humaines va au-delà de l’élévation de la température moyenne ; elle
entraîne également une élévation du niveau de la mer, des changements
de la configuration des vents, de trajectoire des tempêtes extratropi-
cales, des risques de vagues de chaleur accrus, une progression de la
sécheresse, la fréquence des épisodes de fortes précipitations, etc. Le
GIEC ajoute qu’il est « très probable » que les changements seront plus
importants au XXI
e
siècle que ceux observés pendant le XX
e
siècle. En
outre, « même si les concentrations de gaz à effet de serre étaient stabi-
lisées, le réchauffement anthropique et l’élévation du niveau de la mer
se poursuivraient pendant des siècles en raison des échelles de temps
propres aux processus et aux rétroactions climatiques ». Selon les
conclusions du GIEC, tout retard dans la réduction des émissions réduit
sensiblement les possibilités de parvenir à stabiliser les émissions à des
niveaux inférieurs et accroît le risque d’incidences plus graves des chan-
gements climatiques. Le dernier rapport d’évaluation du GIEC publié en
septembre 2013 vient confirmer l’acuité et la gravité de cet enjeu pour
nos sociétés (1).
Même si les politiques de lutte contre les changements climatiques
s’inscrivent dans ce que les politistes nomment une gouvernance « trans-
calaire » ou multilevel mettant l’accent sur les négociations internatio-
nales, mais aussi sur les multiples acteurs impliqués, publics et privés
(ONG, entreprises, organisations professionnelles), globaux, régionaux,
nationaux, locaux, et sur une diversité de processus à l’œuvre à diffé-
(1) GIEC, « Climate Change 2013 – The Physical Science Basis », Working Group I contribu-
tion to the IPCC fifth assessment report, Final draft underlying scientific-Technical Assessment,
30 September 2013, 32 p.

Viii se C te urs d’aCt iV i té s et dip lom at i e C l im ati que
bruylant
rentes échelles, du local au global et du global au local, le régime inter-
national du climat joue, en raison de la globalité même des enjeux, un
rôle central et décisif. Ce rôle est d’abord structurant : il s’agit d’assurer
la cohérence horizontalement entre les différentes politiques menées
à l’échelle internationale (commerce, développement, investissement,
finance, etc.), mais aussi verticalement en permettant l’emboîtement des
différentes échelles d’action là encore du local au global et du global au
local. Le régime international du climat devrait aussi, au-delà, jouer un
rôle dynamisant, celui d’une locomotive, faisant avancer les positions
des uns et des autres dans une dynamique de négociation, permettant de
construire un consensus international et de promouvoir des politiques
climatiques de plus en plus ambitieuses.
Lancées à Bali en 2008, les négociations d’un régime international
ambitieux et inclusif, destiné à prendre le relai des engagements très
limités pris en 1997 dans le Protocole de Kyoto, sont très difficiles.
Elles n’ont pu aboutir à Copenhague, en 2009. Le processus a timide-
ment été relancé à Durban, en 2011 ; il devrait aboutir en 2015, à Paris, à
la conclusion d’un nouvel accord lequel pourrait ainsi être en vigueur à
compter de 2020… Mais nombreuses sont les incertitudes planant sur le
processus. En particulier, si l’accord est obtenu, sera-t-il suffisamment
ambitieux au regard des préconisations des scientifiques ? Beaucoup ont
perdu confiance dans la capacité de la diplomatie onusienne à créer une
réelle dynamique en la matière.
La réflexion sur les approches sectorielles que développe ici Jean-
Christophe Burkel prend tout son sens. Lancée à Bali, comme un élément
de la feuille de route des négociateurs, la négociation sur les approches
sectorielles faisait naître alors beaucoup d’espoirs. Il faut souligner ici
le rôle moteur des entreprises dans cette nouvelle forme de coopération
internationale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En la
matière, elles avaient précédé les États. Mais de quoi s’agit-il exacte-
ment ? Et comment articuler ces approches avec le régime international
du climat ?
Derrière ce concept d’approches sectorielles, se cachent des formes
multiples d’instruments allant des réglementations internationales
sectorielles (transport aérien ou maritime), à des initiatives secto-
rielles purement volontaires visant à simplement échanger des bonnes
pratiques, en passant par une coopération technologique entre pays, ou
encore des accords sectoriels transnationaux impliquant des entreprises
opérant dans les pays industrialisés et dans les pays en développement,
ou même des politiques domestiques sectorielles couplées avec des
instruments incitatifs (No Lose Target/mécanisme de crediting secto-
riel). S’attachant à des initiatives nombreuses et disparates, Jean-Chris-

aV a nt -pro pos iX
bruylant
tophe Burkel met en évidence ce qui réunit ces approches : le fait qu’elles
partagent la même finalité soit la recherche de solutions pragmatiques,
secteur par secteur, quelles que soient les différences fondamentales
des secteurs concernés. L’auteur a du ici véritablement construire son
objet de recherche et c’est un des grands mérites de son ouvrage que de
contribuer à clarifier la notion d’approches sectorielles, dont les diffé-
rentes formes sont catégorisées et classées de manière très convain-
cante. Jean-Christophe Burkel distingue ainsi les approches sectorielles
dans le Protocole de Kyoto, les approches sectorielles volontaires, les
possibilités de concertation sectorielle institutionnalisée et les méca-
nismes sectoriels fondés sur le marché.
Il est rapidement apparu que les approches sectorielles ne pour-
raient se substituer à un accord international, pour des raisons à la
fois politiques mais également de nécessité de garantir la cohérence
entre les politiques publiques. Par ailleurs, il est largement reconnu
qu’une approche sectorielle exige un cadre clair tant sur le plan juri-
dique qu’institutionnel. Enfin, au-delà des questions liées aux fuites de
carbone et du maintien de la compétitivité, on doit s’interroger, secteur
par secteur, sur la pertinence de ce type d’instruments pour inciter à une
transition vers des modes de production faiblement carbonés. Reste la
« cerise sur le gâteau » du juriste qui est la question de savoir comment
construire ce type d’approches dans le futur accord international sur
le climat. Doit-on se contenter d’une forme d’habilitation des acteurs
sectoriels pour la mise en œuvre et d’une reconnaissance des résul-
tats pour démontrer la conformité aux engagements pris par les États ?
Faut-il – et peut-on – aller au-delà, voire jusqu’à négocier l’ensemble des
modalités de mise en œuvre, à l’instar de ce qui a été fait pour le MDP ?
Quel peut être le rôle de la coopération bilatérale ou régionale comme
outil de mise en œuvre du droit international ? Et quel peut être celui
des droits nationaux ?
Clair et pédagogique en dépit de la technicité du sujet, ce bel ouvrage
montre que le régime international est perméable aux idées nouvelles,
mais aussi qu’il oppose à leur développement de vives réticences. En
dépit de leur intérêt, la mise en œuvre effective des approches secto-
rielles pose problème. Les pays en développement résistent à leur déve-
loppement qui, dès lors, a été relativement limité jusqu’à présent.
La réflexion de Jean-Christophe Burkel sur l’articulation de ces
approches sectorielles avec le régime international du climat, celle du
soft et du hard, du volontaire et du contraignant, est particulièrement
stimulante. La question posée en termes de contribution – au moins
potentielle – de ces approches à une meilleure effectivité des politiques
environnementales revêt un intérêt majeur, qui dépasse largement le

X se C te urs d’aCt iV i té s et dip lom at i e C l im ati que
bruylant
sujet du climat. De même, cet ouvrage illustre remarquablement la crise
du multilatéralisme, plus générale, identifiable par exemple aussi bien
dans le domaine climatique que dans celui du commerce international.
La distorsion entre le besoin, l’intérêt de ces approches sectorielles et
la faiblesse des résultats en témoigne si besoin en était. On promeut
une approche sectorielle et… c’est l’État qu’on trouve bien souvent. Les
fondamentaux de la société internationale sont peu ou prou les mêmes
aujourd’hui qu’il y a un siècle. Et elle est bien mal outillée pour faire
face aux enjeux forts du monde d’aujourd’hui.
Sandrine maljean-dubois
Directrice de recherche au CNRS
Centre d’Études et de Recherches Internationales
et Communautaires (CERIC)
Université d’Aix-Marseille
1
/
4
100%