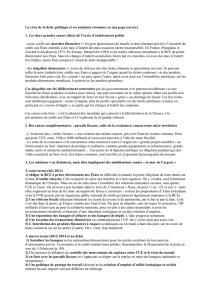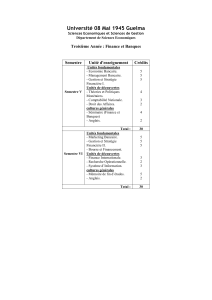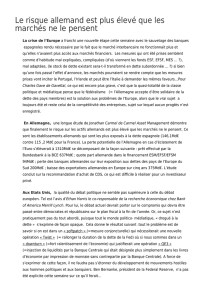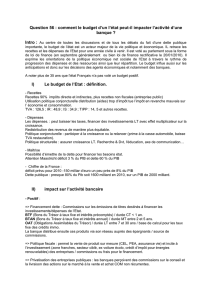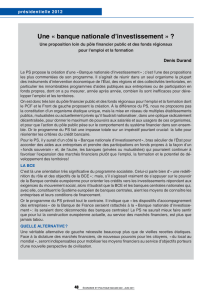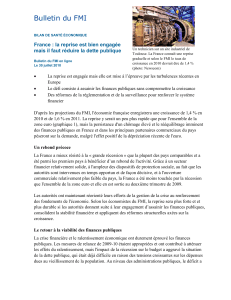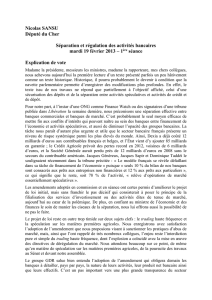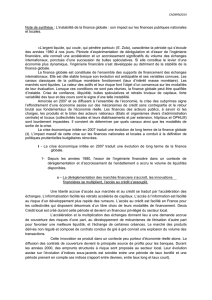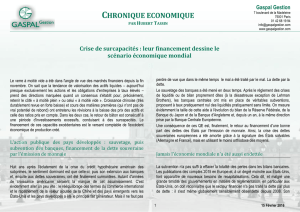Crise financière, les six étapes d`un désastre », par

Textes – articles
mai/juin 2010
-- « Crise financière, les six étapes d’un désastre », par Pierre Rimbert
-- « L’instinct de survie des peuples », par Paul Jorion
-- « Sauver les banques jusqu’à quand ? », par Frédéric Lordon
-- « Ils ont inventé la crise perpétuelle », par François Leclerc
-- « La dette publique, ou la reconquista des possédants », par Frédéric Lordon
-- « Un magistral contresens », par François Leclerc
« Crise financière, les six étapes d’un désastre », par Pierre
Rimbert
[Texte mis en ligne sur le site du Monde Diplomatique le 30 avril 2010]
L’agence de notation Standard & Poor’s a dégradé, mardi 27 avril, la dette souveraine
grecque au rang d’obligation douteuse, et abaissé celle du Portugal. Le lendemain,
l’Espagne entrait dans le collimateur – à qui le tour ?
Dans les trois cas, l’agence dit fonder son appréciation sur les perspectives
macroéconomique des pays concernés : une croissance faible ne leur permettrait pas
d’acquitter leurs engagements. Mais quels facteurs assombrissent ainsi leur horizon
économique ? On peut facilement identifier l’un d’entre eux : les coupes budgétaires
mises en œuvre sous la pression… des investisseurs et des agences de notation.
La boucle est ainsi bouclée. Avec le recul, les pièces éparses des krachs économiques à
répétition survenus ces trois dernières années composent peu à peu le thème d’un
puzzle bien connu. Son cadre : la vague de déréglementation financière des années
1980. Son nom : à crise de marché, remèdes de marché.
Première étape : en 2007 les ménages américains, dont les revenus stagnent,
notamment sous l’effet de la concurrence internationale, se trouvent dans l’incapacité
de rembourser des prêts immobiliers attribués sans souci de garantie par les banques
saisies d’ivresse. Depuis l’éclatement de la « bulle Internet » en 2000, la Réserve
fédérale américaine maintient en effet des taux d’intérêts très bas, favorisant
l’aventurisme des investisseurs.

Deuxième étape : en septembre 2008, la crise des subprime dégénère en crise bancaire,
les bilans des établissements financiers se révélant farcis de crédits immobiliers
insolvables ventilés aux quatre coins de la planète dans des produits financiers
sophistiqués. Lehman Brothers chute ; la panique gagne ; les banques cessent
d’accorder du crédit : l’économie est au bord de l’asphyxie.
Troisième étape : plutôt que de placer l’intégralité d’un secteur financier failli sous
contrôle public, les gouvernements acceptent de le renflouer en l’état. Les Etats
s’endettent hors de proportion pour sauver les banques et relancer l’économie. Mais,
après vingt ans de baisse continue de la fiscalité, les recettes ne suivent pas. Entre la fin
de l’année 2008 et le milieu de l’année 2009, la crise de la finance privée se convertit en
gonflement de la dette publique et en crise sociale. Dans les pays occidentaux, le
chômage grimpe en flèche.
Quatrième étape. Requinqués par l’afflux d’argent public et la remontée des Bourses,
stimulés par des taux d’intérêts quasi-nuls, banques et fonds d’investissements
reprennent leurs affaires ordinaires. Pendant la tourmente boursière, beaucoup ont
reporté leurs avoirs du marché actions (perçu comme incertain) vers celui des dettes
publiques (réputé sûr). Mais celles-ci enflent dangereusement et ne servent qu’un faible
taux d’intérêt. Le faire monter : telle est la conséquence de « l’attaque » spéculative sur
la dette souveraine des pays « périphériques » de l’Europe entamée après la révélation
du maquillage des déficits grecs – carambouille effectuée avec l’aide de la banque
d’affaires Goldman Sachs.
Cinquième étape. Dès lors que les puissances publiques se refusent à stopper la
spéculation par la loi et par une aide immédiate à la Grèce, un cercle vicieux
s’enclenche : il faut emprunter pour payer la dette ; réduire ses déficits pour
emprunter ; tailler dans les dépenses publiques pour réduire les déficits ; abaisser les
salaires, les prestations sociales et « réformer » les retraites pour réduire les dépenses
publiques. Autant de mesures qui appauvrissent les ménages, obscurcissent les
perspectives économiques et incitent les agences de notation à dégrader les titres de la
dette souveraine…
D’abord présentée aux Etats, la facture adressée par les banques pour le prix de leur
propre impéritie échoit alors à son destinataire final : les salariés.
Sixième étape. L’effondrement des dominos européens. Nous y sommes. Miroir de la
désunion européenne, le plan d’aide à la Grèce entériné le 11 avril tente tardivement de
concilier tous les antagonismes : l’intervention du Fonds monétaire international (FMI)
avec le sauvetage des apparences communautaires ; la mise sous tutelle d’Athènes et le
principe de souveraineté nationale ; l’intérêt bien compris des banques françaises et
allemandes, lourdement exposées à la dette grecque, et le Traité de fonctionnement de
l’Union européenne, qui interdit la solidarité financière avec un Etat membre
(articles 123 et 125) ; le montant des prêts initialement prévus (45 milliards d’euros,
dont 15 par le FMI) et les sommes désormais jugées nécessaires pour endiguer

l’activité spéculative (deux, voire trois fois supérieures) ; le modèle économique rhénan
qui comprime les salaires pour dilater les exportations, et les balances commerciales
négatives de ses voisins ; l’agenda politique de la chancelière allemande Angela Merkel,
confrontée à un important scrutin régional le 9 mai, et celui des dirigeants des pays les
plus endettés qui voient l’orage spéculatif aborder leurs rivages.
En vertu de cet arrangement, la Grèce pourra emprunter à des taux moins élevés que
ceux du marché (mais infiniment plus que ceux, pratiquement nuls, associés aux
sommes débloquées sans limite par la Banque centrale européenne en faveur
d’établissements privés en 2008 et 2009). Elle devra en contrepartie réduire de 5, voire
de 6 points, un déficit budgétaire estimé à 14 % du produit intérieur brut. Une saignée
violente, opérée prioritairement dans les budgets sociaux, mais déjà insuffisante aux
yeux Berlin. Moins de dix jours après son annonce, les cortèges hostiles se succédaient
dans les rues d’Athènes, le spectre du défaut de paiement planait sur l’Acropole, la
crise de la dette souveraine gagnait la péninsule ibérique et les rumeurs d’éclatement de
la zone euro se propageaient.
Faite d’improvisation, de crainte et de résignation face aux impositions de la finance, la
réaction des Etats, des institutions européennes et du FMI se caractérise par l’absence
de stratégie d’ensemble : on se contente de répercuter la contrainte des marchés tout
en jurant d’y résister. Elle incite les pays membres à se démarquer mutuellement dans
l’espoir d’échapper aux paris des investisseurs. Une fois les « partenaires » placés en
situation de concurrence, c’est à qui exhibera le plan d’austérité le plus drastique. A
Lisbonne comme à Athènes, à Dublin comme à Madrid, résonne un mot d’ordre
unique : « rassurer les marchés » – un an auparavant, les dirigeants du G20
promettaient de les dompter. Au fond, la dynamique réfracte involontairement la
logique réelle de l’Union européenne, promise à tous comme un espace de solidarité et
finalement livrée au dumping social, salarial, fiscal et maintenant spéculatif… D’autres
solutions s’offraient pourtant au choix des gouvernants.
Comme la mer qui se retire, la crise découvre la fragilité d’une construction qui, depuis
son origine, repose sur un pari : l’union douanière et monétaire entraînera l’union
politique et populaire. C’est peu dire qu’il est perdu.
Pierre Rimbert
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-04-30-Crise-financiere
« L’instinct de survie des peuples », par Paul Jorion
[Texte mis en ligne sur le blog de Paul Jorion le 14 mai 2010]

Un système sain présente en général une très grande capacité à supporter la présence
de parasites. Mais si ceux-ci pullulent alors, passé un certain seuil dans
l’affaiblissement, leur présence peut tuer l’animal. La mort de l’hôte n’est pas dans
l’intérêt du parasite mais comme il ne sait rien faire d’autre que d’être ce qu’il est selon
sa nature, il n’interrompt pas son effort, provoquant la perte de son hôte ainsi que la
sienne propre.
On en a eu l’illustration en 2009 : alors que l’économie était toujours dans les derniers
dessous, le secteur bancaire, sauvé par les aides étatiques, retrouvait la santé et
dispensait à nouveau ses largesses à ses dirigeants et à ses employés les plus talentueux
dans l’accumulation du profit. Largesses qui ne trahissaient pas la folie, mais ne
faisaient que refléter la proportion colossale dans laquelle ce secteur parvenait à
nouveau à détourner vers lui la richesse. Quand les politiques proposèrent de
plafonner les bonus, ils choisirent d’ignorer que ces primes indécentes n’étaient que
des commissions relativement modestes sur des sommes elles à proprement parler
pharamineuses. Quand des velléités apparurent de taxer ces profits monstrueux, les
financiers firent immédiatement savoir que toute charge ponctionnée sur leurs
opérations serait automatiquement répercutée par eux sur leurs clients. Vu l’impunité
de principe dont ils bénéficient, cela aurait sûrement été le cas.
Au cours des semaines récentes, le travail d’investigation des régulateurs et les bureaux
des procureurs d’États américains a mis toujours davantage en lumière le rôle joué par
la simple cupidité dans le déclenchement de la crise. L’économie étant devenue au fil
des années l’otage du secteur financier – et ceci, d’intention délibérée, par choix
idéologique – s’effondra dans son sillage. Les États se précipitèrent alors au secours de
ce secteur financier, en raison du risque systémique que son écroulement faisait courir.
Mais en se refusant à opérer dans les activités financières un tri entre celles utiles à
l’économie (ce que Lord Adair Turner, président de la FSA, le régulateur des marchés
britanniques appelle les transactions « socialement utiles ») et celles dont la seule
fonction est de siphonner une partie de la richesse vers les plus grosses fortunes. Les
États ayant épuisé leurs ressources, imposent ce qu’ils appellent l’« austérité » ou
(pourquoi se gêneraient-ils ?) la « rigueur », c’est-à-dire se tournent vers les classes
populaires et les classes moyennes en exigeant d’elles par un impôt non-progressif et
en opérant des coupes sombres dans les mesures de protection sociale en place, de
rembourser les sommes manquantes.
La logique en marche est implacable : une évolution a eu lieu, d’une situation où le
parasitisme de la finance était relativement tolérable à une autre où il a cessé de l’être.
Les États, et les organismes supranationaux peut-être encore davantage, au lieu de
tenter d’exterminer le parasite, se tournent au contraire vers l’animal et exigent de lui
un effort supplémentaire. Comme c’est de sa propre survie qu’il s’agit désormais, la
réaction de celui-ci est prévisible.

Imbécillité profonde des États, encouragée par les « vérités » charlatanesques de la «
science » économique, ou complicité caractérisée avec les ennemis de leurs peuples ?
Au point où l’on en est arrivé, la distinction a cessé d’être pertinente. Facteur
aggravant : ces mêmes États ne manqueront pas de considérer que les sursauts des
peuples, réaction saine de leur instinct de survie, sont excessifs et les condamneront,
sans penser à leurs erreurs et à leur propre responsabilité dans l’aggravation de la crise.
Un retour à la progressivité de l’impôt est souhaitable. Pourrait-elle seulement être
réinstaurée – ce qui paraît peu probable vu le pouvoir historique de l’argent à prévenir
un tel rééquilibrage – qu’elle ne parviendrait encore qu’à figer la concentration de la
richesse dans son état présent. Or cette concentration est telle aujourd’hui qu’aucune
économie ne peut plus fonctionner dans son cadre : les ressources font à ce point
défaut là où elles sont requises comme avances dans la production des marchandises
ou comme soutien à la consommation des ménages, que le montant des intérêts versés
compris dans le prix de tout produit ou service rend celui-ci excessif. Il faudra donc
remédier à la concentration des richesses telle qu’elle existe dans son état présent. C’est
seulement après qu’une certaine redistribution aura été opérée qu’une imposition
progressive pourra s’assurer que le processus de concentration ne reprenne une
nouvelle fois son cours mortifère. Bien sûr, ceux qui ont accumulé des fortunes
colossales s’affirmeront spoliés (le mot « liberté » sera sans aucun doute galvaudé par
eux une fois encore) et prétendront que la possession de ces sommes leur est
indispensable pour être ceux qu’ils sont à leurs propres yeux. La réponse qu’il faudra
leur opposer est que l’image qu’ils se font d’eux-mêmes importe peu puisque leur
fonction est claire désormais : ils se contentent de pomper le sang de leur hôte. Quant
à celui-ci, la dégradation généralisée du capitalisme l’a acculé à faire un choix entre sa
propre survie et celle des parasites qui l’infestent. Et ce choix, il l’a fait.
Paul Jorion
http://www.pauljorion.com/blog/?p=11617
« Sauver les banques jusqu’à quand », par Frédéric Lordon
[Texte mis en ligne sur le blog de Frédéric Lordon le 11 mai 2010]
Quoique le texte qui suit ait pour propos de développer un argument indépendant
(relativement), il est difficile de ne rien dire du plan « de stabilisation » que viennent
d’annoncer l’Union européenne et le FMI, à propos duquel se pose immanquablement
la question de savoir ce qu’il va stabiliser et pour combien de temps…
Le « plan de stabilisation », ou les risques du bootstrapping.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%