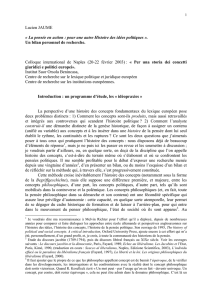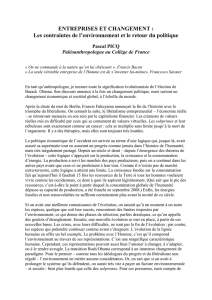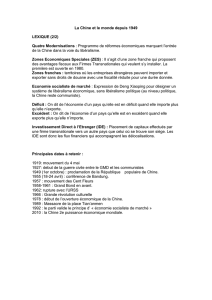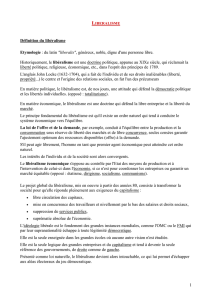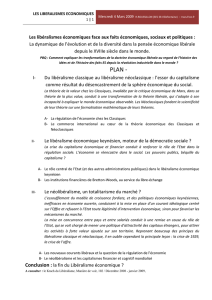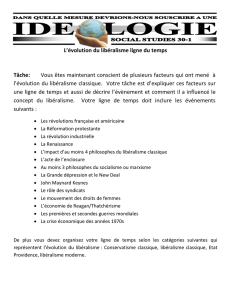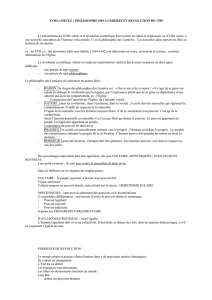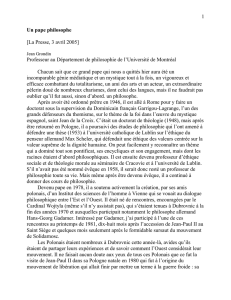Jaume La pensee en action pour une autre histoire des

Lucien JAUME
« La pensée en action : pour une autre Histoire des idées politiques ».
Un bilan personnel de recherche.
Avertissement - Ce texte (colloque de Naples, février 2003) a d’abord circulé comme papier
de travail, plusieurs fois remanié. Sous sa forme actuelle, citée à plusieurs reprises par des
participants du colloque de Paris (« Méthodes en histoire de la pensée politique », septembre
2005), il avait été publié en espagnol (Ayer, « Historia de los conceptos », 53/2004, 1,
Madrid). Il vient d’être édité dans les actes du colloque de Naples : Sui concetti politici e
giuridici della costituzione dell’Europa, sous dir. S. Chignola et G. Duso, Milan, Franco
Angeli, 2005. Je remercie Sandro Chignola et Giuseppe Duso pour leur aimable autorisation.
Il n’y a pas eu d’édition en français. Quelques rectifications purement conjoncturelles sont
introduites dans les notes.
Note supplémentaire, février 2007 – D’autres travaux ont été depuis réalisés, de façon à
redéfinir la notion d’idéologie, qui s’avère indispensable.
Introduction : un programme d’étude, les « idéopraxies »
La perspective d’une histoire des concepts fondamentaux du lexique européen pose
deux problèmes distincts : 1) Comment les concepts sont-ils produits, mais aussi retravaillés
et intégrés aux controverses qui scandent l’histoire politique ? 2) Comment l’analyste
construit-il une démarche distincte de la genèse historique, de façon à assigner un contenu
(unifié ou variable) aux concepts et à les insérer dans une histoire de la pensée dont lui seul
établit le rythme, les continuités et les ruptures ? Ce sont les deux questions que j’aimerais
poser à tous ceux qui pratiquent l’histoire des concepts : nous disposons déjà de beaucoup
d’éléments de réponse1, mais je ne puis ici les passer en revue et les soumettre à discussion ;
je voudrais partir d’ailleurs, ou, en quelque sorte, en deçà de la discipline que l’on appelle
histoire des concepts, c’est-à-dire du terrain même où s’élaborent et où se confrontent les
pensées politiques. Il me semble profitable pour le débat d’exposer une recherche menée
depuis une vingtaine d’années2, d’en présenter un bilan, ou du moins l’esquisse d’un bilan et
de réfléchir sur la méthode qui, à travers elle, s’est progressivement constituée.
Cette méthode croise inévitablement l’histoire des concepts (notamment sous la forme
de la Begriffsgeschichte), mais elle suppose une différence première, et majeure, entre les
concepts philosophiques, d’une part, les concepts politiques, d’autre part, tels qu’ils sont
mobilisés dans la controverse et la polémique. Les concepts philosophiques (et, en fait, toute
la pensée philosophique dans sa démarche et son contenu) ont une fécondité spécifique qui
assure leur privilège d’autonomie : cette capacité, en quelque sorte atemporelle, leur permet
1 Je voudrais dire ma reconnaissance à Melvin Richter pour l’effort qu’il a déployé, depuis de nombreuses
années pour comparer et faire dialoguer les approches entre école allemande et perspectives anglosaxonnes sur
l’histoire des idées, l’histoire des concepts, l’histoire de la pensée politique. Son ouvrage de 1995, The history of
political and social concepts. A critical introduction, Oxford University Press, ajoute encore à cet effort qui m’a
été, personnellement, d’un grand profit, et, je crois, à toute la communauté des historiens de la pensée.
2 Etude du discours jacobin (1789-1794), puis du discours libéral français au XIXe siècle. Voir les ouvrages
suivants : Le discours jacobin et la démocratie, Paris, Fayard, 1989, Echec au libéralisme. Les Jacobins et l’Etat,
Paris, Kimé, 1990, (éd. révisée, complétée et trad. it. Scacco al liberalismo, Naples, Editoriale Scientifica, 2003),
L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français (Fayard, 1997), La liberté et la loi. Les origines
philosophiques du libéralisme (Fayard, 2000).

Lucien Jaume « La pensée en action : pour une autre Histoire des idées politiques ».
2
de se dégager du cadre historique de formation et de laisser à l’arrière-plan, pour qui entre
dans le mouvement du penser philosophique, l’état de société où ils sont apparus3. Au
contraire, il me semble que les concepts politiques ne peuvent être l’objet d’une
compréhension pleine et entière si l’on ne passe d’abord par le moment de l’historicité et,
souvent, de la particularité. Que ce soit, par exemple, l’opinion publique, la liberté
d’association, la société civile ou même la représentation, ces catégories majeures portent
avec elles un impact polémique et historique qu’elles avaient précisément pour fonction de
faire ressentir4. Cette différence étant faite, il me paraît utile d’exposer la méthode que j’ai dû
développer en la matière, qui présuppose directement une conception du politique et une
conception du langage du politique -, tant il est vrai que les débats de méthode reposent, en
dernière analyse, sur des choix philosophiques. Mon propos, comme on le voit, n’est pas
d’écarter la philosophie de ces réflexions, mais de réagir à certaines confusions. Chemin
faisant, il sera possible de relever des éléments de comparaison avec les écoles de Gadamer,
de Koselleck ou de Skinner.
Comment qualifier la méthode utilisée ? En premier lieu, elle privilégie les textes du
débat politique, comme son champ d’investigation, et elle vise à poser la question « Quels
sont les effets proprement politiques des textes où se marque l’intervention d’un acteur
politique ? » De plus, pour souligner le lien qu’il ne faut pas briser entre pensée et action, je
dirais : la première étape réside dans une analyse des textes d’intervention politique5
considérés comme lieux d’incarnation des « idéopraxies »-, par opposition au terme
idéologies ; par le néologisme idéopraxie entendons la mise en œuvre d’une pensée politique
qu’il ne faut pas séparer de ses conditions concrètes de formulation, si l’on veut l’appréhender
et la comprendre.
Mais adopter cette perspective sur la pensée politique - qui ne s’attache donc plus de
façon prioritaire aux « grands auteurs » -, c’est se situer en dehors des catégories polaires
considérées comme structurantes : par exemple, les doctrines opposées aux textes de
circonstance, ou la théorie opposée à la pratique, le général opposé au particulier, ou encore
l’intemporalité du concept opposée au caractère éphémère de l’opinion. En effet, les textes
dont il s’agit portent la trace d’une action, écrite ou orale, qui vise à exposer, convaincre,
discuter, polémiquer, légitimer6 - et ce en fonction de trois choses : 1) un certain public,
lecteur ou auditeur, présent réellement ou virtuellement, 2) un certain enjeu, ou plusieurs
3 Il faut ajouter que le propre de ce que les philosophes appellent concept est de bannir l’équivoque, de le vérifier
dans les développements, les interrogations et les confrontations avec la réalité dont le concept philosophique
doit sortir victorieux. Quand R. Koselleck écrit « Un mot peut - par l’usage qu’on en fait - devenir univoque. Un
concept, par contre, doit rester équivoque », cela ne peut être admis dans le domaine philosophique. C’est là un
point important de divergence avec l’entreprise du Geschichtliche Grundbegriffe (éd. par O. Brunner, W. Conze
et R. Koselleck, 6 vol .). La citation provient de : R. Koselleck, Le futur passé, Paris, Editions de l’EHESS, trad.
J. Hoock et M.-C. Hook, 1990, p. 109. En revanche, on peut montrer qu’un concept philosophique est non pas
équivoque mais générateur d’apories (comme chez Kant) : ce que j’ai essayé de faire dans l’étude sur la
souveraineté du peuple chez Rousseau, citée à la note suivante (n° 4).
4 Il faudrait examiner le programme de recherche de l’école de Padoue, dirigée et animée par Giuseppe Duso, ce
que je ne puis faire ici. Le projet est de conduire l’analyse critique des concepts de philosophie politique
moderne, de façon à exhiber les limites de leur généralité et de leur universalité. Comme l’a bien montré Sandro
Chignola, il s’agit là d’une radicalisation des thèses de Koselleck dans le domaine de la pensée philosophique :
S. Chignola, « History of political thought and the history of political concepts : Koselleck’s proposal and Italian
research », History of Political Thought, XXIII, n° 3, automne 2002. J’ai moi-même donné une étude critique du
concept de la souveraineté du peuple chez Rousseau (ses liens avec la vision absolutiste, ses apories internes)
dans le volume dirigé par G. Duso, Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, Rome, Carocci, 1999.
J’ai repris les développements essentiels dans L. Jaume, La liberté et la loi. Les origines philosophiques du
libéralisme, éd. cit., dans l’appendice : « Rousseau : la liberté aux conditions de la souveraineté ».
5 Ces textes peuvent être et sont souvent des discours tenus par un orateur envers un auditoire déterminé.
6 On verra plus loin que la logique fondamentale est la suivante : inciter à… Cela implique une conception du
politique, assez proche de Hannah Arendt.

Lucien Jaume « La pensée en action : pour une autre Histoire des idées politiques ».
3
enjeux, que le texte institue explicitement ou dont il tient compte implicitement, 3) une
culture politique, acceptée ou contestée, qui fait lien (crée un espace de la communication)
entre l’intervenant et les destinataires.
Prendre pour ressources théoriques de tels textes, et élaborer ensuite un idéaltype, un
concept ou un modèle général - qu’est-ce que l’association et la libre association pour la
culture politique française ? Qu'est-ce que le(s) jacobinisme(s) ? Qu’est-ce que le(s)
libéralisme(s) ? -, c’est, bien entendu, adopter des prémisses théoriques, mais aussi
méthodologiques :
a) sur la nature du politique moderne ;
b) sur le rôle du langage comme lieu d’expression d’une « pensée de la
société »7 ;
c) sur la spécificité du texte « d’intervention politique », qui ne relève
ni du domaine de la philosophie ni de l’ordre de la doctrine ;
d) sur la façon de construire une historicité de la pensée : historicité
qui n’est pas de l’ordre empirique (res gestae), ni donnée dans et
par l’expérience des acteurs, mais relève de l’interprète, de la
construction par voie théorique d’une temporalité historique. Cette
historicité « idéelle » est à bien distinguer de l’histoire empirique ;
elle peut être la substance d’une histoire des concepts,
éventuellement, mais surtout de l’histoire d’un courant considéré
dans ses transformations, par exemple, le libéralisme.
Il me faut donc développer ces prémisses théoriques et méthodologiques, sortes de
thèses métathéoriques, certes controversables, assumées comme telles, et qui, en dernière
analyse, engagent des choix philosophiques. Mais on doit auparavant signaler que le cœur de
la démarche, bien qu’il découle de ces prémisses, ne s’y réduit pas. Le cœur de la démarche
consiste en effet à déterminer par voie d’interprétation8 l’ « effet de sens » du texte
d’intervention politique. Et c’est dans la prise en compte de cet effet de sens que l’on se
trouve amené à réfuter les catégories dichotomiques évoquées plus haut (du type :
doctrine/texte de circonstance), car ce qui fait sens c’est ce par quoi le locuteur, agissant sur
son public, tente de réinstituer la communauté (et souvent y parvient). C’est, bien entendu,
une communauté subjective, celle qu’il espère, qu’il imagine et dont il désire être entendu.
Dans cette parole de l’intervenant on trouvera conjointement teneur théorique et incitation à
l’action, la réunion de ce que l’on répartit souvent entre le pôle de la pensée et celui de
l’action, mais aussi une reprise de la culture politique présente pour cette communauté et, en
même temps, une réorganisation originale9. L’effet de sens du texte d’intervention politique
7 Est acceptée la perspective présente chez Gadamer et chez Koselleck (venue en fait de Heidegger) du langage
comme expérience du monde, que l’on ne peut traiter en « instrument » de communication. La souveraineté du
sujet sur le langage est un présupposé (mais parfois aussi un choix philosophique en relation avec Wittgenstein)
qui, à mon avis, interdit de comprendre la nature du politique comme espace de controverse (et aussi, selon
l’expression de Koselleck, lieu d’un « combat sémantique »).
8 A peu près au sens de Gadamer, Vérité et méthode ( dont il faut préférer, à mon avis, la première traduction en
français, toute incomplète qu’elle soit, Le Seuil, 1976, nettement plus claire que celle de 1996). Ce qui, en
revanche, me paraît non recevable, est la notion de « fusion des horizons » qui permet à Gadamer de surmonter
de façon intégrale la distance temporelle. Par cette notion, Gadamer peut rendre compte de la pensée
philosophique, mais non de l’histoire des idées et de l’histoire du politique : ici la distance de l’interprète avec la
pensée des acteurs reste indépassée et explicitée comme telle. Il n’est pas question, par exemple, de traiter
l’opinion publique chez Necker comme un noyau de sens dont nous serions directement des coparticipants. Voir
notre étude : « L’opinion publique chez Necker : entre concept et idée-force », dans L’avènement de l’opinion
publique, sous dir. Javier F. Sebastián et Joëlle Chassin, Paris, L’Harmattan, 2004.
9 Comme signalé précédemment, c’est Arendt qui, dans sa théorie de l’agir (Condition de l’homme moderne,
chap. V), a le plus approché cette conception du politique. Elle écrit notamment : « Le faiseur d’actes n’est

Lucien Jaume « La pensée en action : pour une autre Histoire des idées politiques ».
4
signe la praxis de l’agent politique dans son rapport aux destinataires et dans la contribution
qu’il apporte à la pensée de la société. De ce point de vue, l’étude du concept, pris de façon
isolée, ne saurait suffire, car c’est l’ensemble et le mouvement de l’agir politique (de tel ou tel
agent à un certain moment) qui doit être pris en compte.
Peut-être, la question globale qui pourrait résumer la perspective adoptée sur la
politique comme pensée et comme action, et donc comme lieu des « idéopraxies », serait la
suivante : « Comment disent-ils ce qu’ils font ? ». Cette question n’implique pas que les
acteurs font bien ce qu’ils disent (c’est là un autre problème)10 -, mais qu’ils font quelque
chose en disant cela 11. Ce faisant, et ce disant, ils expriment une pensée qu’ils tentent de faire
partager (sur l’Etat, sur le pouvoir, sur l’homme, sur la citoyenneté, sur le juste et le bien,
etc.) ; le dialogue entre les pensées est le véritable milieu de vie (Lebenswelt) des concepts
majeurs présents dans la culture politique, elle-même mise en commun entre les adversaires
comme entre les alliés.
Il est très important de remarquer que la question « Comment disent-ils ce qu’ils
font ? » conduit à mettre entre parenthèses la perspective de la vérité - à la différence de
l’interprétation philosophique en histoire de la philosophie12. On ne cherche pas si ce que dit
l’acteur politique - ce qu’il dit à des destinataires dont il faut toujours mesurer l’indice de
présence - est vrai ou non ; car l’interprète ne se situe pas dans un registre de connaissance et
d’enquête sur la société, comme en sociologie, par exemple, mais dans une écoute de ce que
la société est pour une praxis politique en train de s’exercer : pour une certaine pensée, en
fonction de certains enjeux, pour un public envisagé13, en relation avec une culture politique
hégémonique (mais pas nécessairement cohérente et unifiée).
La légitimité de cette démarche ne peut que se renforcer si l’on veut bien considérer
l’incapacité de l’Histoire tout court (par différence avec l’historien de la pensée politique), ou
de la philosophie en tant que telle14, ou de l’historien des doctrines à pénétrer dans la façon
dont « pense la société »15.
possible que s’il est en même temps diseur de paroles » (Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy,
1983, p. 201).
10 Grossièrement parlant, quand Le Chapelier propose en septembre 1791 (cf. fin de cette introduction) de
renforcer le régime représentatif, ou quand Guizot, en mai 1819, propose de fonder la « liberté » des journaux
sur le cautionnement financier, on peut contester cette justification. C’est d’ailleurs ce que font, à ce moment,
Robespierre ou Benjamin Constant : l’un y voit la destruction d’un régime de participation du peuple, l’autre un
refus du pluralisme des opinions.
11Idée qui nous mène à la nature du politique à l’âge moderne, point qui sera traité ultérieurement. Il est plus
simple de restreindre aux modernes ; en fait, la logique médiévale ou la logique de l’absolutisme n’exclut pas
l’existence de « textes d’intervention politique », mais c’est le rapport à la communauté, le statut de l’autorité,
etc., qui changent.
12 Point lumineusement développé par Yves Zarka : « Que nous importe l’histoire de la philosophie ? », dans Y.
C. Zarka dir., Comment écrire l’histoire de la philosophie ?, Paris, PUF, 2001. De son côté, Arendt avait bien
noté, à propos du politique, la différence entre l’ « intérêt pour la signification » et l’ « intérêt pour la vérité » (si
je résume son propos dans La vie de l’esprit, Paris, PUF, 3ème éd. 1992, t. 1, p. 75). On remarque aussi la
différence avec la perspective de Koselleck, pour laquelle est indispensable une appréciation de la vérité des
concepts : le point est très bien souligné par José Luis Villacañas et Faustino Oncina, dans leur introduction à
Reinhart Koselleck, Hans-Georg Gadamer, Historia y hermenéutica, Barcelone, Paidos, 1997, pp. 34-43.
13 On peut dire que, dans le texte d’intervention politique, le discours porte en lui son destinataire ; il s’agit donc
d’un interlocuteur, ou d’une cible, par imagination.
14 Mais il y a un « usage philosophique », un atelier philosophique d’élaboration de la démarche, qui est de
première importance. J’ai commencé à expliciter cette idée d’un « usage philosophique », du point de vue de
l’élaboration des outils, dans l’étude : « Philosophie en science politique », Le Débat, n° 72, nov.-décembre
1992, pp. 134-145. C’était un premier bilan entre la recherche sur le jacobinisme et celle que j’avais commencée
sur le libéralisme. Voir également la discussion menée dans Le Banquet, n° 17, mai 2002 : « De la philosophie
politique et de son usage dans l’Histoire des idées politiques » (texte d’abord paru dans le Giornale di storia
costituzionale, Universita di Macerata, 2/2001, sous le titre « Riflessioni sulla filosofia politica e sul suo uso
nella storia delle idee politiche »). Aujourd’hui, j’insisterai davantage sur les choix philosophiques et la

Lucien Jaume « La pensée en action : pour une autre Histoire des idées politiques ».
5
Soyons plus précis pour ce qui concerne la dernière catégorie de travaux, c’est-à-dire
les historiens des doctrines : on ne doit pas conclure de telle philosophie (celle de Locke, par
exemple, dans ses deux Traités du gouvernement) ou de telle doctrine (par exemple, chez
Benjamin Constant, les Principes de politique de 1815) à la réalité sociale et politique du
libéralisme. Car une chose est le théoricien et autre chose le combat politique, aussi « nourri »
de théorie soit-il, et parfois chez le même homme (Constant, Tocqueville, etc.). Pour
appréhender le libéralisme comme pensée vivante et agissante (ce qui a été d’ailleurs sa
première forme historique de manifestation), il faut restituer les divers enjeux (institutionnels,
culturels, idéologiques) autour desquels il prend forme - et, éventuellement, sur lesquels il se
divise. Par exemple, toute étude du libéralisme en France qui ne se pencherait pas sur la
longue controverse concernant le Conseil d’Etat, ne traitera pas de la réalité historique qu’a
revêtue le dit libéralisme : le libéralisme est une pensée « présente à la société » (si on peut
l’exprimer ainsi) lorsque cette dernière sort, avec peine, et du conflit révolutionnaire et de la
domination impériale, le tout sous le joug des puissances alliées de 1814-1815. Or cette
pensée se divise : il y a des libéralismes en présence16. C’est seulement après cette analyse
que l’on peut légitimement, à mon avis, mener la comparaison avec les liberales espagnols
(Constitution de Cadix notamment) et avec les whigs anglais : là aussi un certain
comparatisme terme à terme ou question par question peut être illusoire car l’expérience
historique, la vie du sens (en deçà des significations exprimées) risque d’échapper à
l’historien.
Dans le sens premier du terme17, c’est pratiquer une mé-prise que de « prendre »
Rousseau pour les Jacobins (ou tel courant du jacobinisme), que de « prendre » Montesquieu
ou Locke, mais aussi tel traité de Constant ou telle œuvre de Tocqueville, pour « le
libéralisme ». Car le libéralisme, comme le jacobinisme, ne sont pas des entités : ce ne sont
pas des êtres théoriques, conceptuellement articulés, qui habiteraient a priori dans la pensée
de tel grand auteur (philosophe, doctrinaire, publiciste) et qui, ensuite, descendraient dans la
société pour des « applications » plus ou moins fidèles et réussies. Cette histoire fantastique
(là aussi au sens originaire du terme) est, malheureusement, souvent mise en scène dans
l’Histoire des idées politiques et souvent enseignée dans les facultés de droit.
On parlera alors de « l’influence » d’un auteur sur tel moment ou telle action de la vie
politique ; mais à cette influence supposée, il n’y a ni preuve ni réfutation qui puisse être
apportée, car le raisonnement développe une pétition de principe : puisque Montesquieu est
libéral de pensée, ou puisque Constant est un contemporain libéral, je dois, et je peux, trouver
une « influence » de leur pensée dans les discours et dans les actes de cette période (le
premier XIXème siècle). Ainsi engagée, l’investigation va rencontrer sans beaucoup de frais
des éléments qu’elle pourra tenir pour des « confirmations ». De même que le croyant voit
Dieu partout (attitude légitime dans le cadre de la foi), le rousseauiste verra Rousseau dans
chaque pas des Jacobins. Pourtant, dira-t-on, si les Jacobins citent Rousseau ou si un membre
proximité avec Arendt qui sont à la base de cette démarche : conception du langage comme assujettissement du
sujet, conception du politique comme réseau d’incitations à agir…
15 Une société interprétée par ses élites, certes. Car on attend ici l’objection de certain social scientists : vous ne
parlez pas des couches populaires. Je suis prêt à concéder : « la façon dont pense la société officielle ».
16 Je tente de montrer dans L’individu effacé la controverse entre trois grandes écoles, l’enjeu majeur étant ce que
j’ai appelé « le droit de juger de son droit » : ce concept n’est pas donné de façon explicite dans le discours des
acteurs (sauf cas très rare, une fois chez Lamartine), pas plus que le partage invisible qu’il institue entre les
idéopraxies en présence ; il est ce que l’interprète construit, à partir de l’examen des échantillons qu’il tient pour
« représentatifs ». Ajoutons que ce concept peut être emprunté ailleurs (en l’occurrence à Locke et à Kant), et
possède dès lors le statut de modèle. Une grande différence avec l’école de la Begriffsgeschichte est que, à mes
yeux, le problème majeur en matière de concepts n’est pas de retracer leur usage (synchronique et diachronique)
chez les acteurs, mais d’exhiber les conditions de possibilité chez l’interprète des concepts que, lui, élabore.
17 Imagé par Platon, dans le Théétète, selon l’analogie avec le colombier : on croit saisir tel oiseau et l’on prend
autre chose.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%