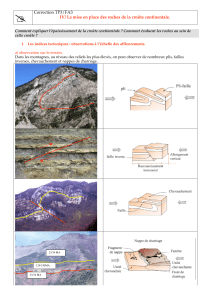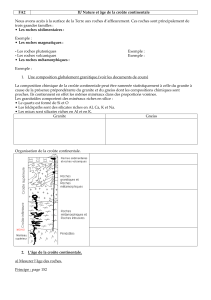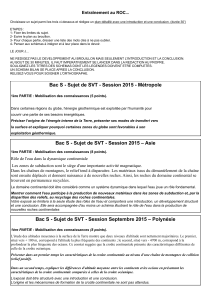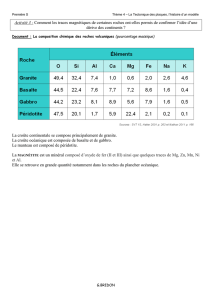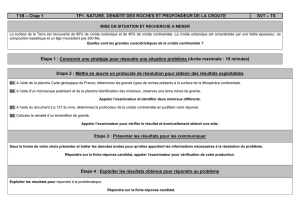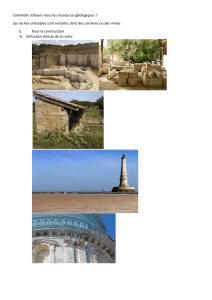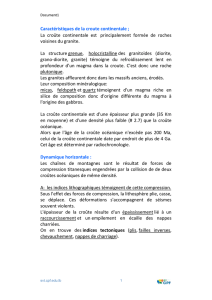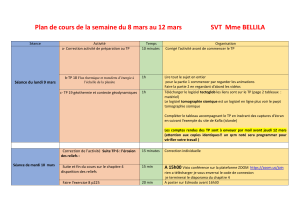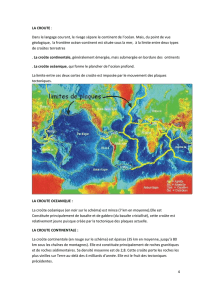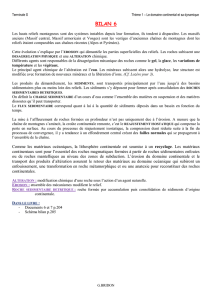Descriptif des UE

Descriptif des UE
Mécanique de la lithosphère
Responsable : J-P Brun – O. Dauteuil
Autour de deux thèmes géodynamiques, différents d’une année à l’autre, on réalisera une approche
quantitative des processus mécaniques mis en jeu et de leurs conséquences géologiques et
géophysiques
Chaque année seront étudiés deux processus géodynamiques choisis dans la liste suivante :
• Rifting (rifts continentaux, marges passives, rifts océaniques)
• Subduction (océan-océan et océan-continent)
• Collision continentale
• Grandes zones transformantes
Chaque processus sera abordé à partir d’une synthèse des données significatives (géologiques,
géochimiques et géophysiques) nécessaires pour définir la mécanique du système considéré. Nous
examinerons ensuite, de manière critique, les modèles mécaniques disponibles (numériques et
analogiques) et leur potentialité pour l’explication et la quantification des phénomènes géologiques
associés. Des sujets d’étude bibliographique personnelle seront proposés à chaque étudiant devant
aboutir à un document de synthèse et un exposé public. Ces sujets traiteront de modélisation d’un
processus géodynamique ou d’un cas exemplaire actif de ce processus.
Roches et fluides métamorphiques
Responsable : Pavel PITRA ; Intervenants : Ph. Boulvais, P. Pitra
Objectifs : Comprendre et maîtriser les bases des techniques modernes
d'analyse pétrologique et géochimique des roches métamorphiques et
des interactions fluide-roche.
Contenu du cours :
1 - Equilibres de phases dans les roches et thermodynamique des
solides. Equilibres univariants et multivariants; calcul de leurs
positions dans les espaces P-T et P/T-X. Solutions solides, activités
et relations a-x. Pseudosections P-T, P/T-X. Applications -
trajectoires PT(X) (P. Pitra: 12h)
2 - Thermodynamique des fluides. Méthodes de caractérisation directes
et indirectes (inclusions fluides et isotopes stables). Mécanismes de
circulation des fluides et conséquences structurales, pétrologiques
et géochimiques. (P. Boulvais: 12h)
UE Géodynamique chimique
Responsable : Philippe Boulvais,
Intervenant : A.C. Pierson-Wickmann
Trois objectifs dans ce module :
1) Présenter la formation et l’évolution des réservoirs chimiques de la terre solide (noyau, manteau,
croûte)
2) Envisager les granitoïdes comme marqueurs géodynamiques
3) Recyclage de la croûte continentale
Le premier objectif de cet enseignement est de présenter les grandes lignes relatives à la
composition géochimique des réservoirs terrestres (noyau, manteau, croûte), et aux moyens qui ont
permis d’établir ces compositions. Cette présentation en termes de réservoirs permet d’élaborer, par
bilans de masses, un modèle global de différenciation terrestre.

Le deuxième aspect du module focalise sur les granitoïdes, objet crustal par excellence. La
grande variété géochimique de ces roches est liée à la grande diversité des contextes
géodynamiques dans lesquels ils prennent naissance. A ce titre, les granitoïdes sont des marqueurs
géodynamiques potentiels, assertion dont il faut cependant mesurer les limites.
Le dernier aspect concerne l’évolution de la croûte continentale. En particulier, les aspects
bilan d'érosion et recyclage via les zones de subduction seront abordés quantitativement.
Intervenants :
- évolution de la terre silicatée : 12 h P. Boulvais
- granitoïdes : 6 h : P. Boulvais
- recyclage de la croûte continentale : 6 h. : A.-C. Pierson-Wickmann
UE Transferts sédimentaires : sédimentation
Responsable : Cécile Robin
Intervenants : Sylvie Bourquin, Olivier Dauteuil, François Guillocheau, Thierry Nalpas, Jean-Noel
Proust et Cécile Robin.
Les bassins sédimentaires, de part leur position privilégiée à l’interface lithosphère /
atmosphère – hydrosphère, sont les meilleures archives géologiques des processus climatiques
(géodynamique externe) et tectoniques (géodynamique interne).
L’objectif de ce module est de présenter les outils de caractérisation, de quantification et de
modélisation du remplissage d’un bassin sédimentaire afin d’en extraire ces traits caractéristiques de
l’histoire de la Terre.
Après un rappel des principes de la stratigraphie séquentielle, ces méthodes seront
présentées au travers d’études variées de bassins à contextes géodynamiques divers : bassin
intracratonique (le bassin de Paris), marge passive (marge ouest-africaine), marge active (Nouvelle-
Zélande, Sud-Pyrénéen)…
UE Imagerie géophysique
Responsable : D. Gibert
Intervenant : F. Nicollin
Le module est basé sur des études de cas réels permettant de passer en revue les principales
méthodes d'imagerie géophysique (gravimétrie, magnétisme, sismique, électrique, radar, imagerie de
puits,...) et d'en rappeler les principes, les performances et les limites d'application. Les exemples
traités concernent la tectonique, l'hydrologie, le génie civil et la sédimentologie.
UE Structure Interne de la Terre et des Planètes Telluriques
Responsable : Frédérique Moreau, Annick Chauvin
Contenu des enseignements :
L'objectif de ce cours est de donner les principaux éléments de notre connaissance de la
structure et de la dynamique de la Terre profonde et de les comparer avec les autres planètes
telluriques. Les outils menant à cette connaissance sont principalement la géophysique et la
modélisation numérique, mais on ne rentrera pas dans le détail de l'utilisation de ces outils, l'objectif
étant réellement d'avoir une image de l'intérieur de la Terre.
On s'intéressera à:
–
l'apport des outils géophysiques dans la connaissance de la structure interne (rotation
de la Terre et champ de gravité, sismologie, modèles de convection thermique)
–
la structure radiale de la Terre (grands ensembles chimiques et rhéologiques, bilan
thermique)
–
la structure et la dynamique tri-dimensionnelle de la Terre profonde (mouvements
induits par la tectonique des plaques, profils thermiques issus des modèles
convectifs, apport de la tomographie sismique)
–
l'interface manteau supérieur/manteau inférieur (signature sismologique, modalité de
la convection)
–
les zones centrales de la Terre (interface noyau-manteau, histoire thermique du
noyau, principe de la dynamo et l'observation du champ magnétique des planètes)
–
la comparaison avec les autres planètes telluriques

UE Aimantation des roches et des minéraux
Responsables : Annick Chauvin et Pierre Gautier
Le cours a pour objectifs de présenter les différents domaines d’application, en Sciences de la Terre, de
l’étude de l’aimantation des matériaux géologiques.
Seront successivement présentées:
1- les théories de l'aimantation des minéraux et des roches et les modes d'acquisition et de traitement
des données paléomagnétiques.
2- des applications concrètes,
à la fois classiques : quantification des déplacements de plaques lithosphériques,
magnétostratigraphie
ou plus “modernes” : rotations de blocs, paléoclimat, mise en place des magmas,
environnement,
On insistera particulièrement sur le potentiel de la méthode et ses limites, vis à vis de la question
géologique posée.
UE Géomagnétisme
Responsable : Annick Chauvin
Le cours concerne l'étude du champ magnétique terrestre, seule manifestation en surface de la
dynamique du noyau terrestre.
On s’intéressera plus particulièrement aux variations spatiales et temporelles des champs internes,
externes et d’anomalie.
Contenu des enseignements:
Les éléments du champ magnétique terrestre et le potentiel magnétique
Les variations temporelles du champ principal (de l’année au Milliard d’années) et les changements de
polarité
La géodynamo et l'origine du champ principal – Dynamique et histoire du noyau terrestre
Structure et origine du champ d'origine externe (cycle solaire et magnétosphère)
Le champ d'anomalie : Transformations et traitement des cartes d’anomalies magnétiques
UE Modélisation en Sciences de la Terre
Responsable : Frédéric GUEYDAN
Intervenants : Frédéric Gueydan, Jean Braun, Thierry Nalpas, Philippe Davy et Alain CraveÒ
Le but est de donner aux étudiants une culture de base en modélisation numérique et
analogique. Ainsi, à la fin de ce module, ils doivent avoir acquis une certaine expertise dans l’analyse
des résultats issus de modélisation : avoir un œil critique sur les résultats de modèles de plus en plus
sophistiqués et de moins en moins expliqués.
Cette vision critique sera « testée » et développée par la lecture et l’analyse d’articles
scientifiques (travail personnel, 10h). Une partie du cours sera ainsi intégralement effectuée par les
étudiants grâce à l’analyse critique des articles.
¾ Modélisation : Principes et Méthodes (3heures)
¾ Extension de la lithosphère continentale : rifting et marges passives (4 heures)
¾ Compression de la lithosphère continentale : chaînes de montagnes (5 heures)
¾ Erosion (6 heures)
¾ Interaction tectonique et sédimentation (3 heures)
¾ Visite laboratoire analogique- Exposés de doctorants- Conclusions (3 heures)
UE Transferts sédimentaires: Erosion
Responsable : S. Bonnet
Intervenants : S. Bonnet, A. Crave, P. Davy, D. Lague, C. Pierson-Wickman

Ce module s’intéresse à l’érosion et à la dynamique des reliefs et des flux de matière à toutes les
échelles de temps et d’espace. L’accent est mis sur les lois physiques d’érosion et sur leurs
conséquences en terme de dynamique des reliefs à long-terme (temps géologique), à partir de l’étude
de systèmes naturels et de la modélisation numérique et expérimentale. Est également abordé
l’influence de la tectonique et des variations du climat sur ces dynamiques.
Les cours concerneront les points suivants :
- Processus et lois d’érosion
- Organisation géométrique des reliefs et méthodes d’analyse (MNT).
- Etats dynamiques des reliefs : modèles théoriques et données issues des modélisations numériques
et expérimentales (« analogiques »)
- Dynamique de l’érosion et des reliefs vis-à-vis des contrôles tectoniques et climatiques
- Les flux d’érosion actuels et passés
1
/
4
100%