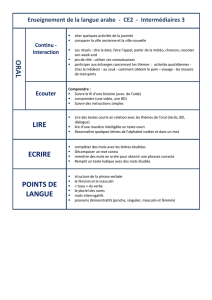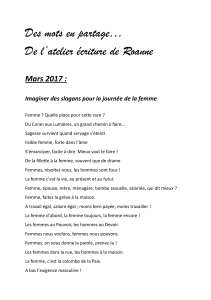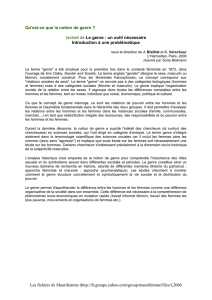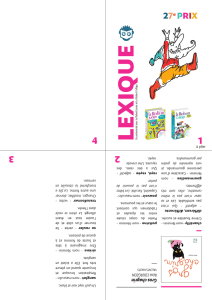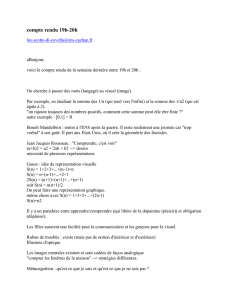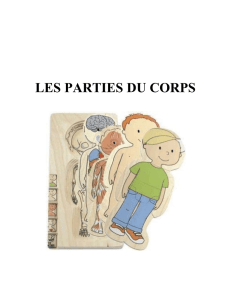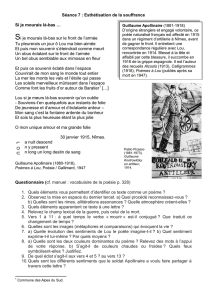Le féminin et l`écriture De Nietzsche à Derrida et au-delà

Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie
« Philosophies allemande et française dans l’espace européen »
MEMOIRE DE MASTER
Année 2012/2013
Présenté et soutenu par
Jasmina Jovanovic
Le féminin et l’écriture
De Nietzsche à Derrida et au-delà
DIRECTEUR : Arnaud François (Université de Toulouse II – Le Mirail)
CODIRECTEUR : Jean-Christophe Goddard (Université de Toulouse II – Le Mirail)

2
*
Vu que le texte présent est une couronne, mise sur la période de deux années - 2011/12 et
2012/13 - du programme Master EuroPhilosophie, je pourrais le consacrer simplement à
mon položajnik pour l’année 2012 et à mon položajnik pour l’année 2013.
Je pourrais également le consacrer à L’Année-même de 2013. D’autant plus que c’est l’année
du Serpent d’Eau. D’autant plus féminine. D’autant plus sacrée. D’autant plus jouissante.
Dessiner un serpent autour de ce titre me semble comme une belle idée. En suit, écrire tout
au long de son corps « D’où proviennent vraiment le poisson et le remède ? ». Je pourrais
ajouter encore deux boules de Soleil : « D’où l’Angoisse ? » et « D’où la Jouissance ? ». Et sur
la langue qui sort, j’écrirais, par exemple : « Tournez-vous vers ceux qui me voient
différemment afin de comprendre en quoi la vue diffère de l’œil ».
Mais c’est à une Main que je dédie tout ce travail. A une main qui m’a sorti de moi-même et
qui m’a serré si fort que j’ai dû arrêter de trembler. C’est cette main magique, cette main
plein d’amour, cette triple main, cette main en trois qui m’a guidé tout au long de cette
écriture. En plein confiance.
A Godovie, Gwenova et Janka, avec tous mes remerciements voixantes.

3
Aleksadra Petkovic, L’Origine, 2013

4
INTRODUCTION
« Je suis douce, mais ma manière d’être est féroce »
1
De même que nous nous approcherons de Lou Andreas Salomé à travers son livre Nietzsche
à travers ses œuvres, nous chercherons les réflexions de Derrida lui-même, concernant la
question du féminin, dans son livre Eperons - les styles de Nietzche.
Insister sur l’enjeu biographique dans l’approche d’une œuvre philosophique ne devrait pas
être réduit à une tâche psychanalytique, en ce qui concerne l’auteur, ni à une analyse
scientifique illustrée sporadiquement par des données personnelles, concernant l’œuvre. La
généalogie nietzschéenne rejoint la déconstruction derridienne exactement dans cet espace
qui s’ouvre par les décalages diversifiés entre la vie et l’œuvre et réclame un retour en arrière
– à des origines de l’acte, à des racines de la pensée. Les gestes qui oscillent entre les deux –
entre les actes et les pensées –battements du cœur dans les abîmes approfondis, non moins
par l’audace que par la peur, cheminent les passages par où nous voyons le style d’écriture se
développant. En réalité, ce n’est que la pensée qui se développe à travers l’écriture, et la vie-
même, enveloppée dans une tenue de belles lettres, se trouve toujours en quête et en
inquiète de ce qui la nourrit ou la rejette, de ce qui la pense de l’intérieur ou la réfute de
l’extérieur. Oui, la vie coule, le style se développe, la vie saigne, l’écriture l’enveloppe. Les
styles de la vie d’un auteur et la vie des styles d’une œuvre nous amènent ainsi à soumettre
l’idée selon laquelle Nietzsche à travers ses œuvre est une autre manière de dire « Les œuvres
de Nietzsche dans sa vie », et Eperons-Les styles de Nietzche une opportunité de plus pour
chercher la pensée de Derrida parmi les éperons de sa propre écriture. La notion de « propre »
peut poser beaucoup de problèmes sous le spectre de l’origine de l’acte et de la racine de la
pensée, mais de même elle peut nous éviter certains des travers propres aux exégètes en
histoire de la philosophie, notamment le peu d’intérêt, voire le désintérêt, que ces derniers
1
Clarice Lispector, Passion selon G.H., Des Femmes Antoinette Fouque, Paris, 1998, page 150

5
ont pu témoigner, ça et là, à l’égard de l’affinité entre la manière de vivre et la méthode de
penser. Le propre d’un style serait ce qui fait qu’un auteur soit reconnu dès les premières
lignes, non moins à partir des motifs y figurant que du rythme de l’affection, de la dynamique
des manières de s’approcher de ce qu’il traite comme le problème, de ce qui s’en voit et de
ce qui s’en vit comme le défi. Pour les défis défilant dans l’armée de pensées, le style vient
comme un soutien musical, comme un repère pour la synchronisation des pas, comme un
guide depuis l’ombre. Et c’est cette musique qui reste dans les oreilles après la fête, où les
pensées prenaient la parole dans l’écriture et, parfois, la mélodie la plus aiguë ne nous quitte
même plus quand on s’endort. Sans doute est-ce de cette ombre que Derrida parle sans la
nommer quand il nous explique son expérience de l’écriture dans un entretien de l’année
2002, où il témoigne :
« C’est chaque fois quand j’écris quelque chose dont j’ai un sentiment que ça crée un nouvel
espace, que j’avance là où je ne me mettais pas à avancer et ce que très souvent implique des
gestes qui peuvent sembler agressifs à l’égard d’autres penseurs, d’autres collègues, ça m’est
arrivé… Je ne veux pas polémiquer, mais il est vrai que les gestes de type déconstructif ont
souvent l’apparence de gestes qui vont déstabiliser ou inquiéter ou angoisser les autres ou
blesser même quelque fois. Alors chaque fois quand j’ai fait ce geste-là, il y a eu des moments
de peur, en effet. Pas au moment quand j’écrivais. Quand j’écris, il y a une espèce de nécessité
ou de force plus forte que moi qui fait que ce que je dois écrire j’écris quelle que soient des
conséquences. Je n’ai jamais renoncé à écrire quoi que ça soit parce que quelques
conséquences me faisaient peur. Donc, rien ne m’intimide quand j’écris. Je dis ce que je pense,
ce qu’il doit être dit. »
Le temps et l’espace, tels qui sont décrits ici, ont lieu dans le processus par lequel l’écriture
engendre les pensées défilantes. Et c’est la fête des sons dans les lettres, des paroles dans les
mots où une musique spécifique, tant affectivement colorée qu’exagérée, tant subie que
muette, tant propre qu’influencée, reste à la tête. Mais après une telle fête, les doutes
surgissent, les « mais » nous hantent dont Derrida parle à l’occasion du même entretien :
« Quand je n’écris pas, quand ne suis pas en train d’écrire, et au moment très particulier qui
est le moment où je m’endors, à ce moment-là dans un demi-sommeil, tout d’un coup, je suis
effrayé par ce que je suis en train de faire, et je me dis : « Mais tu es fou ! Tu es fou d’écrire
ça ! Tu es fou de t’attaquer à ça ! Tu es fou de critiquer telles ou telles personnes ! Tu es fou
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
1
/
94
100%