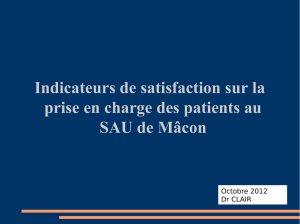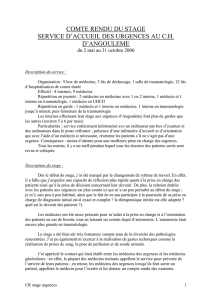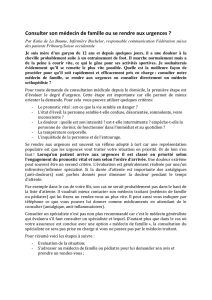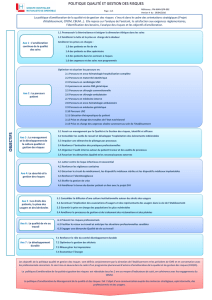Pour une refonte des "Urgences"

Pour une refonte des "Urgences"

Pour une refonte des "Urgences"
Altao
2
Altao
Introduction
Les principes d’organisation des urgences sont souvent le résultat de leur
professionnalisation, autour des SAMU dans les années 60. Cette professionnalisation a eu un
impact tout a fait positif sur la prise en charge des pathologies réellement urgentes.
Mais ce sas d’entrée de l’hôpital s’est trouvé depuis cette date progressivement embolisé par
des demandes qui ont peu à voir avec l’urgence. La modification de pratique de la médecine
générale qui n’accueille plus les demandes imprévues ou tardives a provoqué un afflux de
demandes de consultations et d’admissions impromptues à l’hôpital. Cet afflux inopiné est
devenu le corps de l’activité réelle des services nommés "urgences".
Notons au passage, que le fait d’accueillir dans un service conçu pour les urgences vitales, les
consultations ou demandes d’admission non programmées relève d’une curieuse notion de la bonne
organisation. L’hôpital n’étant pas organisé pour recevoir ce flux impromptu l’a relégué près de la porte
d’entrée. Il a continué à répondre à des demandes de consultations de type généraliste avec des moyens
et des méthodes prévues pour la grande détresse vitale. A chaque analyse systématique des admissions
aux urgences hospitalières sur plusieurs semaines, nous mesurons chez Altao que la part des urgences
réelles ne dépasse pas 5% des admissions. Incidemment, continuer à nommer "urgences" une activité
qui est autre chose pour 95 % relève d’une erreur plus que sémantique. Ce sont les paradigmes et les
fondements de l’organisation qui sont inadaptés.
Notre propos n’est pas de faire une analyse, une critique ou un panégyrique du fonctionnement des
"services d’urgences". Nous souhaitons modestement apporter la contribution d’une expérience déjà
longue à la modernisation du concept, en s’appuyant particulièrement sur la progression de l’hôpital vers
la prise en charge de plus en plus fréquemment ambulatoire. Nos propositions reprennent pour partie les
expériences variées qui ont vu le jour un peu partout en France. Nous illustrerons notre propos avec
l’activité d’un service qui accueille 60 000 passages par an. Pour une meilleure compréhension nous
ferons une rapide description globale de la structure pour zoomer ensuite sur la question majeure du
secteur médecine qui concentre les difficultés.
Nous proposerons un changement du paradigme actuel basé surtout sur l’équation : un patient = un lit
en se recentrant plus sur l’organisation d’un parcours de soin adapté au patient avec ou non besoin d’un
lit.

Pour une refonte des "Urgences"
Altao
3
3
La situation la plus fréquente
Comme dit en préambule notre but n’est pas de décrire en détail la situation actuelle d’un SAU, qui a déjà
fait l’objet d’innombrables publications. L’affirmation habituelle est que les moyens sont de toute façon
insuffisants. Nous voulons proposer une organisation fondamentalement différente, plus efficiente
construisant un parcours de prise en charge répondant au mieux à la nature de la plainte qui aura motivé
le recours au SAU. L’actuelle névrose obsessionnelle de la recherche d’un lit, ne devient qu’un élément du
parcours. Cette névrose disparaît si notre objectif est atteint.
Les grandes lignes du fonctionnement d’un service d’urgence restent les mêmes. A savoir trois secteurs
plus ou moins distincts.
Le déchoquage ou SAUV : Equipé pour accueillir les urgences vitales
Le secteur traumatologie : Comme son nom l’indique, essentiellement dédié à la traumatologie
dont la très grande majorité est simple et nécessite peu de ressources.
Le secteur médecine : Tout le reste ! qui va rassembler de l’AVC à l’alcoolisme aigu , en passant
par la douleur abdominale, l’infarctus du myocarde, la gène respiratoire, le malaise, le clochard
qui se gratte, le préservatif qui s’est déchiré, le déprimé qui n’arrive pas à dormir, la personne
âgée qui ne peux plus rester chez elle (tout particulièrement le vendredi à partir de 17h) la
colique néphrétique, la tentative de suicide, la fièvre qui dure depuis 15 jours, et on pourrait
continuer à l’infini cet inventaire à la Prévert…
Ce secteur est assez universellement appelé "la cour des miracles", en référence à ces quartiers de "non
droit" du Paris d’avant Haussmann ou s’entassait toute la misère sociale, hors de porté des soldats du
guet qui n’osaient pas s’y aventurer. La métaphore est éloquente !
Pour s’occuper de ce secteur on trouve des médecins urgentistes, le plus souvent, d’expérience et de
formation inégale, du "très plus" au "plus ou moins" qui se débattent comme ils le peuvent au milieu de
ce flot de patients multiples et variés en essayant de hiérarchiser de trier d’orienter, s’appuyant sur
examens complémentaires et avis de spécialistes. Ils sont assistés de paramédicaux qui naviguent
comme ils peuvent entre brancards qui envahissent toutes les surfaces horizontales disponibles, patients
qui déambulent, familles qui réclament. Pas facile, parce qu’on attend beaucoup aux urgences, et qu’à
force d’attendre (patients, familles, ambulanciers, policiers, pompiers) on en devient désagréable, et on
s’en prend au personnel qui fait pourtant ce qu’il peut. Et puis il y a le téléphone. On passe énormément
de temps au téléphone dans ce secteur. D’ailleurs un observateur extérieur aurait l’impression que c’est
l’activité dominante pour le personnel tant médical que soignant. L’objectif très dominant de ces appels
vise la recherche d’un avis spécialisé et … d’un lit !!

Pour une refonte des "Urgences"
Altao
4
Altao
Un peu d’arithmétique !
Un SAU de bonne activité accueille en moyenne 50 à 70000 patients par an, CHU ou CH. On appuiera nos
calculs sur un SAU ayant une activité de 60 000 patients.
Les chiffres que nous donnons sont des ordres de grandeur retrouvés dans la littérature et issus de notre
expérience d’audit de plus de 200 établissements sur 20 ans.
L’activité est extraordinairement régulière, d’un jour à l’autre, d’une année à l’autre. On peut prédire
avec une excellente fiabilité le nombre de patients qui passeront la porte des urgences pour chaque
tranche horaire. C’est tout simplement du à la loi des grands nombres. Si tous sont imprévus, l’ensemble
ne l’est pas. N’ayant pas souvent appris ces "lois des grands nombres" à l’université, bien des praticiens
pensent que l’urgence n’est pas programmable. S’il est vrai pour chacun d’entre nous, que notre urgence
n’est pas prévisible, le besoin d’urgence d’un groupe important est lui parfaitement prévisible et donc
organisable. Tous les commerces du monde n’ont que des clients imprévus qui pourtant viennent avec un
rythme et une fréquence tout à fait prévisible, ce qui permet de dimensionner les surfaces, les caisses et
d’organiser le planning du personnel en fonction de l’afflux prévu. Ces lois humaines s’appliquent aussi à
l’hôpital…
60 000/an, c’est 165 /Jour à peu de choses près
55 à 60 % de "Petite" traumatologie, c’est 90/jour
Restent 70 patients pour "la cour des miracles"
On peut les segmenter de la façon suivante :
30 ne relèvent que d’une consultation de médecine générale, arrivés là par facilité, hasard, ou
par la démission de la médecine générale traditionnelle. Ils devraient d’une façon ou d’une autre
retourner à la médecine générale et ne pas être admis en tant que patient des "urgences
hospitalières ". Il leur faudra parfois une radio ou un examen biologique.
15 relèvent d’un "circuit court spécialiste" facilement et immédiatement repérable. Ex : Douleurs
thoracique, Hémiplégie, coma, hémorragie digestive… Leur prise en charge est le plus souvent
bien codifiée et bien rodée. On retiendra comme exemple la prise en charge de l’angioplastie
dans l’infarctus du myocarde, et de la fibrinolyse dans l’AVC ischémique. Ces patients relèvent
d’une prise en charge médico-technique immédiate et d’une hospitalisation en "lits chauds" (Réa,
USC, USIC, USIN, SIPO…)
Restent 25 : Ce sont les patients, dont la plainte, relève d’une pathologie non évidente, (si
pathologie somatique il ya) et qui vont nécessiter une investigation approfondie qui conduira à un
diagnostic plus ou moins clair, un séjour long en salle d’urgence et une orientation, souvent
synonyme d’hospitalisation. Parmi ces patients, on trouve une forte proportion de personnes
âgées à très âgées.

Pour une refonte des "Urgences"
Altao
5
5
Pourquoi une nouvelle organisation ?
On le comprend aisément, l’objectif premier est de mettre en place une filière distincte et structurée
pour la traumatologie hors urgence vitale. Cela permet de ne pas "entasser" ces patients dans la
"cour des miracles".
L’objectif suivant, tout aussi essentiel, est donc d’éviter que les 70 patients non "traumatologiques"
ne viennent s’entasser dans les urgences. Actuellement, pour ces patients, le temps moyen du
séjour en salle d’urgence est de 7h (Potel) et que 60 de ces patients sont admis entre 8h et 22h au
rythme de 4/heure (Mission urgences ).
La simple logique arithmétique nous indique qu’à 15 heures, soit 7 heures après le début du flux, 25 à 30
patients seront présents en permanence dans la structure "médecine" avant que les premiers ne partent.
De plus le reflux étant lent, voir interrompu (plus de lits ou d’avis spécialiste disponibles) la stagnation
persiste toute la nuit, donnant une fausse impression de poursuite d’une activité aiguë, alors que les
entrées se sont taries depuis 22h. Cela ne peut que donner un sentiment de pagaille incroyable, de ne
plus savoir où on en est de se sentir complètement dépassé et de donner une irrépressible envie de fuir.
Ca permet de mieux faire comprendre le parallèle avec la "cour des miracles" dont on a parlé plus haut.
On comprend également les accidents qui peuvent survenir, dans cette "foire aux malades".
L’organisation actuelle, issue de l’accueil indiscriminé des patients urgents dans les années 60 n’a pas
segmenté l’organisation en fonction des besoins des patients. Elle les empile dans une seule filière dont
on a vu qu’elle s’engorge très rapidement, et tous les jours. C’est dangereux et intenable. Il faut donc
changer de paradigme et s’adapter tant au flux plus important qu’à la nature du besoin qui a beaucoup
évolué.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%