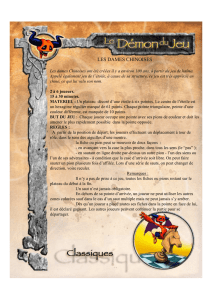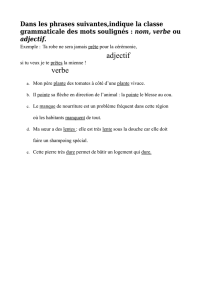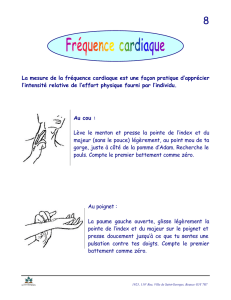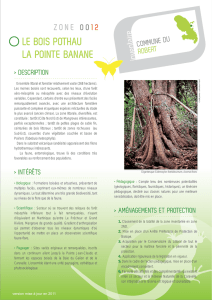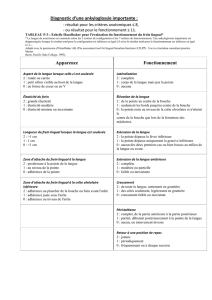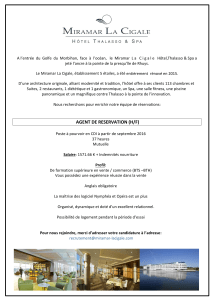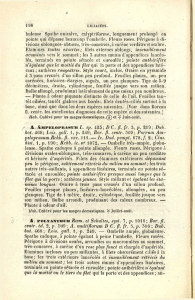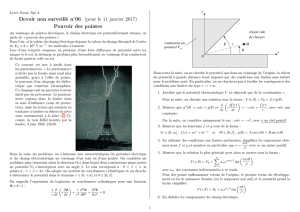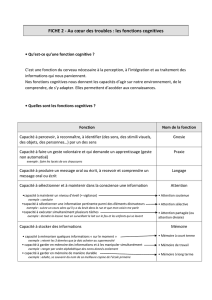Télécharger le document

1 | P a g e
Un mécanisme de capacité pour le système électrique français
La loi NOME prévoit la mise en place d’un mécanisme de
capacité en 2015 pour compléter le marché électrique
français. Cette décision fait suite au rapport Poignant-
Sido1 qui mettait en avant la croissance inquiétante de la
pointe de consommation électrique en France et les
risques qu’elle fait peser sur l’équilibre à long terme
entre la production et la consommation d’électricité.
Le marché électrique ne semble pas rémunérer suffi-
samment les investissements dans les capacités de
pointe permettant cet équilibre, i.e. la production de
pointe et les interruptions volontaires de consommation
aussi appelées effacements. Les caractéristiques tech-
niques de l’électricité induisent plusieurs imperfections
dans le marché électrique engendrant le problème dit de
"missing money". Le marché ne rémunérant que l'éner-
gie produite, les capacités de production et d’effacement
ne sont pas en mesure de couvrir la totalité des coûts
d’investissement, ce qui peut conduire à des volumes
insuffisants de capacité susceptibles d'être mobilisés
pour répondre à la demande de pointe. En cas de
manque de capacité, il est nécessaire de procéder à des
délestages forcés de consommateurs (i.e., sans leur
accord et sans rémunération contrairement aux efface-
ments) pour éviter l'effondrement du réseau électrique
(blackout) et maintenir l’équilibre technique entre la
production et la consommation d’électricité.
Cet article rappelle tout d’abord la façon dont sont ré-
munérés les investissements en production dans un
marché électrique parfait. Nous détaillons ensuite les
principales imperfections de marché qui privent les
unités de pointe d'une rémunération suffisante. Nous
expliquons enfin comment un mécanisme de capacité,
tel que celui qui est actuellement débattu en France,
pourrait permettre d'assurer la sécurité du système, en
complétant la rémunération des capacités de pointe. Il
s’agit en fait de créer un produit supplémentaire, la
capacité, et un marché des mégawatts afin de pallier les
défaillances du marché de l'énergie (celui des mégawa-
theures) et d’assurer une rémunération suffisante des
investisseurs.
1 Rapport de Messieurs Serge POIGNANT, député de Loire-Atlantique et
Bruno SIDO, sénateur de la Haute-Marne, intitulé "Groupe de travail sur
la Maîtrise de la pointe électrique" et remis au ministre de l'Écologie, de
l'Énergie, du Développement durable, et de la Mer en avril 2010.
L’investissement dans un marché élec-
trique parfait
De façon générale, les marchés électriques libéralisés
rémunèrent uniquement l'énergie produite ("energy
only"). En théorie, ces marchés pourraient générer les
signaux-prix efficaces incitant les acteurs à investir de
façon optimale dans les différentes technologies (base,
semi-base, pointe, effacement)2 et assurant ainsi la
sécurité du système et l’équilibre à long terme entre la
production et la consommation.
En situation de concurrence parfaite, la courbe d'offre
des producteurs est construite à partir de leur coût de
fonctionnement (i.e., leur coût marginal de court terme
qui correspond grosso modo au coût du combustible
utilisé pour produire). Le prix de l’électricité est alors fixé
à l’intersection entre la courbe de coût marginal de
fonctionnement de la centrale la moins chère permet-
tant de fournir la consommation et la courbe de de-
mande (figure 1).
Figure 1. Merit-order et prix d'équilibre
Coût
marginal, Prix
Quantité
Coût marginal
des unités de
base
Coût marginal
des unités de
pointe
Demande
de base
Demande
de pointe
Demande
d’extrême
pointe
Le principe de couverture des coûts d’investissement
dans un marché parfait est alors le suivant.
2 Les technologies dites de base sont des moyens de production supposés
fonctionner plus de 80 % du temps par an (e.g., les centrales nucléaires).
Les technologies dites de pointe sont des moyens de production suppo-
sés fonctionner seulement quelques centaines d’heures par an, lorsque
la consommation électrique est haut plus haut (e.g., les centrales ther-
miques à flamme au fioul ou au gaz). Les technologies dites de semi-base
sont des moyens de production supposés fonctionner plus de la moitié
de l’année (e.g., les centrales thermiques à vapeur au gaz ou au char-
bon).
Energy Focus
Mars 2012

2 | P a g e
Durant la période de base, les moyens de production de
base ne sont rémunérés qu'à hauteur de leur coût de
fonctionnement, car le prix est fixé à leur coût marginal.
Durant les périodes de pointe, le prix est fixé au coût
marginal des unités de pointe. Les moyens de production
de pointe fonctionnent, mais ne perçoivent aucune
rente. En revanche, les unités de base engrangent une
rente dite inframarginale : elles perçoivent une rémuné-
ration à hauteur du coût marginal des moyens de pointe,
plus élevée que leur propre coût marginal. Cette rente
leur permet de couvrir la majeure partie de leur coût
d’investissement.
En théorie, les unités de pointe (production et efface-
ment) ne couvrent leur coût fixe d’investissement que
lors de la période d’extrême pointe, lorsque le prix est
déterminé par l’élasticité de la demande (i.e., par
l’activation d’effacements lorsque des consommateurs
préfèrent être payés pour interrompre leur consomma-
tion). Durant cette période, les producteurs (de base
comme de pointe) et les effacements perçoivent une
rente dite de rareté : le prix s’élève au-dessus du coût
marginal de pointe, car la production électrique devient
alors rare (figure 2).
Figure 2. Rentes inframarginale et de rareté3
Rente de rareté des unités de base pendant les
périodes d’extrême pointe
Rente inframarginale des unités de base
pendant les périodes de pointe
Coût
marginal, Prix
Quantité
Coût marginal
des unités de
base
Coût marginal
des unités de
pointe
Rente de
rareté des
unités de
pointe
pendant
l’extrême
pointe
A long terme, il existe un équilibre théorique assurant à
chaque capacité (base, pointe et effacement) une rému-
nération couvrant exactement ses coûts fixes d'investis-
sement. Autrement dit, à l'équilibre du système, les
rentes inframarginales et de rareté rémunèrent l'inves-
tissement dans les capacités de production et
d’effacement.
L'équilibre à long terme d'un marché électrique parfait
diffère ainsi significativement des équilibres classiques,
car il fait coexister des unités de production ayant des
coûts marginaux très différents. L'explication réside dans
les fortes variations de la demande d'électricité et l'im-
possibilité de stocker aisément cette énergie. Satisfaire
la demande de pointe en recourant uniquement à des
centrales de base (comme les centrales nucléaires ou
certaines centrales hydrauliques au fil de l’eau) ne serait
3 Ce graphique n’intègre pas la notion de durée des périodes de pointe et
d’extrême pointe pendant lesquelles les capacités perçoivent les rentes.
pas économiquement rationnel. En effet, leurs coûts
d’investissement sont trop élevés pour que les quelques
centaines d’heures par an durant lesquelles elles sont
appelées suffisent à les financer.
La minimisation du coût total de production conduit
donc à la combinaison de différentes unités : d'une part
des capacités de production de base dont les coûts
marginaux sont faibles mais les coûts d'investissement
élevés, d'autre part des capacités de pointe (production
et effacement) dont le coût d’investissement est relati-
vement modéré mais dont les coûts marginaux sont
beaucoup plus élevés (coût du gaz ou du fioul pour la
production, coût d’opportunité de ne pas consommer
pour l’effacement de consommation).
Les imperfections de marché et le pro-
blème de "missing money"
En pratique, les prix de marché s’élèvent difficilement
au-dessus du coût marginal des unités de pointe. Le
fonctionnement des marchés électriques se heurte à un
certain nombre d'imperfections susceptibles de com-
promettre les investissements dans les capacités de
production ou d'effacement permettant de satisfaire la
demande de pointe.
Ces imperfections peuvent se résumer à un problème de
"missing money" : les prix de marché n'assurent pas le
financement des capacités de pointe (production et
effacement) appelées un très petit nombre d'heures
dans l'année en raison de diverses imperfections. Le
problème de "missing money" est fondamentalement lié
à l’existence de plafonds de prix (implicites ou explicites)
sur le marché de l’énergie4 (figure 3). Par exemple, le
régulateur peut fixer un plafond de prix (price cap) pour
s’assurer que les acteurs n’abusent pas de leur pouvoir
de marché en proposant des prix trop élevés, ou pour
éviter des augmentations de prix qui ne seraient pas
socialement acceptables.
Figure 3. Effet d'un plafond de prix
Rente de rareté des unités de base pendant les
périodes d’extrême pointe
Rente inframarginale des unités de base
pendant les périodes de pointe
Coût
marginal, Prix
Quantité
Coût marginal
des unités de
base
Coût marginal
des unités de
pointe
Rente de
rareté des
unités de
pointe
pendant
l’extrême
pointe
Plafond
de prix
Rente de rareté qui ne peut être générée à cause du plafond
de prix = "missing money" pour les producteurs
4 Voir par exemple Joskow, P. (2008). Capacity payments in imperfect
electricity markets: Need and design, Utilities Policy 16:159-170.

3 | P a g e
En outre, pour assurer la sécurité d’approvisionnement
du système électrique, le Gestionnaire du Réseau de
Transport (GRT) est obligé de réaliser certaines actions
"hors marché" lors des situations critiques d’exploitation
du réseau et du système (par exemple, l’utilisation de
réserves, le changement de topologie du réseau, la
diminution du niveau de plan de tension, les délestages
partiels préventifs, etc.). Les effets de ces actions, qui
permettent de surmonter les situations critiques du
système, ne sont pas intégrés dans le prix de l’électricité.
Un plafond de prix est introduit de façon implicite par les
actions du GRT. Le prix du marché ne représente donc
pas correctement la valeur associée à la mise à disposi-
tion de l’énergie dans les moments critiques.
Ainsi, en général, la vente de leur production sur les
marchés energy only ne procure pas aux capacités de
pointe une rémunération suffisante. Cela conduit à un
sous-investissement qui, à long terme, met en péril la
sécurité du système électrique.
Le principe d’un mécanisme de capacité
et le débat de son design en France
Plusieurs mécanismes ont été proposés pour résoudre le
problème du missing money. La plupart d'entre eux
repose sur l'introduction d’un revenu complémentaire
rémunérant la disponibilité d’une capacité de production
ou d’effacement5. Autrement dit, ces mécanismes assu-
rent que la capacité installée sera suffisante pour couvrir
la consommation de pointe.
Le mécanisme de capacité est la solution réputée la plus
efficace pour favoriser le développement de capacités
de pointe. Ainsi, outre la mise en place de l’ARENH
(l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), l’article
6 de la loi NOME introduit également un mécanisme de
capacité pour favoriser le développement des capacités
susceptibles de répondre à la demande de pointe. L’idée
est de compléter le marché de l’énergie en créant un
nouveau bien, la capacité, afin d’assurer un développe-
ment suffisant des moyens de production et
d’effacement6. Les fournisseurs ont l’obligation de dis-
poser d’une capacité (de production ou d’effacement)
assurant une marge de sécurité à leurs clients (en plus
de l’énergie consommée), afin de maintenir l’équilibre
physique du système.
L’effectivité (assurance de la sécurité du système et
développement d’une capacité suffisante) et l’efficacité
(minimisation du coût) d’un mécanisme de capacité
dépendent de son design précis. A la suite de la loi
NOME, le design du mécanisme de capacité a ainsi été
largement débattu en France dans le cadre des travaux
5 Pour une comparaison des propriétés des différents mécanismes
possibles voir par exemple : Finon, D., Pignon V. (2008). Electricity and
long-term capacity adequacy: The quest for regulatory mechanism
compatible with electricity market, Utilities Policy 16:143-158.
6 Il s'agit d'un mécanisme qui appartient à la famille des marchés de
certificats négociables (permis d'émission SO2 et CO2, certificats verts,
certificats blancs, etc.).
préparatoires visant à le concevoir et à définir ses règles
de fonctionnement, tout d'abord lors de la concertation
relative à la rédaction du rapport de RTE (gestionnaire
du réseau de transport d’électricité en France) jusqu’en
octobre 2011, puis lors des discussions entre les acteurs
du système électrique et la Direction Générale Energie
Climat (DGEC) du Ministère de l’Energie. Deux options de
design7 ont été principalement débattues : l’Obligation
Décentralisée de Capacité et le mécanisme de bouclage.
Option n°1 : l’Obligation Décentralisée de Capacité
Le design le plus simple est l’Obligation Décentralisée de
Capacité. Dans son rapport au ministre de l’Energie, RTE
défendait ce design8. Il reprend le principe de base des
marchés de certificats. L’institution d’obligations indivi-
duelles et d’un mécanisme adéquat de contrôle et de
pénalité pour non-exécution suffisent à créer un marché
de capacités négociables. Les fournisseurs peuvent
recourir à leurs propres capacités (de production ou
d’effacement) pour répondre à leurs obligations ou
acquérir des certificats auprès d’autres acteurs (produc-
teurs, agrégateurs d’effacements ou fournisseurs ayant
précédemment acquis des certificats de capacité). Les
certificats de capacité peuvent être échangés de gré à
gré ou sur un marché organisé. L'équilibre entre l'offre
et la demande de certificats sur le marché organisé fait
émerger un prix du certificat. Ce prix dépend de la con-
trainte globale de capacité et des coûts
(d’investissement) des offreurs. Les fournisseurs peuvent
satisfaire leurs obligations de capacité jusqu’à une
échéance de court terme vis-à-vis de leurs livraisons. Ce
mécanisme introduit une pénalité croissante avec le
déséquilibre global du système.
Les partisans de cette option de design avancent l'argu-
ment suivant9 : elle ferait peser sur les consommateurs
un surcoût modéré. Selon eux, la loi NOME inciterait les
fournisseurs à une forte concurrence aval afin d’accéder
à l’ARENH, l’énergie nucléaire régulée à bas coût, car
leur droit de tirage sur l’ARENH dépend de leur part de
marché aval. Les fournisseurs seraient ainsi prêts à ne
facturer aux consommateurs que le coût moyen de la
capacité et non sa valeur marginale (e.g., le prix de la
capacité). Ce point semble très discutable tant il va à
l’encontre de la représentation classique de la concur-
rence en économie consistant à facturer la valeur margi-
nale des biens, et non le coût moyen10.
Par ailleurs, dans le cas d'un mécanisme de capacité,
deux spécificités ont un impact déterminant sur les
performances du dispositif en termes d’effectivité (assu-
7 D’autres éléments du design ont été également discutés (e.g.,
l’intégration des capacités d’interconnexion et de production hors de
France dans le mécanisme).
8 RTE (2011). Rapport au Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de
l’Economie numérique sur la mise en place du mécanisme d’obligation de
capacité prévu par la loi NOME, 5 juillet 2011.
9 Finon D. (2011). L’obligation décentralisée de capacité, le meilleur
mécanisme de capacité dans le contexte du régime de la NOME, Revue
de l’Énergie, n° 604, novembre-décembre 2011.
10 Si tant est qu’une concurrence en coût moyen puisse effectivement
être mise en œuvre, elle ne distinguerait pas les deux options de design.

4 | P a g e
rance de la sécurité du système et développement d’une
capacité suffisante) et d’efficacité (minimisation du
coût). D'une part, le respect strict de la contrainte glo-
bale de capacité est crucial pour assurer la sécurité du
système et ne pas exposer l'ensemble des acteurs à une
défaillance du système. D'autre part, les cycles d'inves-
tissement dans de nouvelles capacités sont pluri-
annuels, ce qui limite considérablement les marges
d'ajustement à court terme.
Ces particularités doivent être prises en compte dans le
design d'un mécanisme de capacité, car elles affectent à
la fois son fonctionnement concret et ses performances.
Les retours d'expérience des dispositifs mis en œuvre
aux Etats-Unis sont, de ce point de vue, riches d'ensei-
gnements, car les premiers dispositifs de capacité y ont
été lancés il y a plus d'une dizaine d'années. Les pre-
miers mécanismes de capacité, auxquels l’ODC est com-
parable, n’intégraient ni la longueur des cycles
d’investissement en capacité ni le caractère critique de
l’équilibre de long terme entre la production et la con-
sommation d’électricité. En conséquence, ils n'ont pas
produit l'effet escompté d'apporter un complément de
rémunération significatif aux détenteurs de capacités et
de les inciter à développer des capacités suffisantes11.
Option de design n°2 : le mécanisme de bouclage12
On pourrait penser qu’augmenter les échéances de
livraison de la capacité pourrait rendre compatible l’ODC
avec la durée des cycles d’investissement. Cela n’est
pourtant pas possible à double titre. Tout d’abord, si les
fournisseurs devaient eux-mêmes couvrir leur besoin de
capacité à l’avance, la somme de leurs prévisions de part
de marché n’atteindrait pas nécessairement 100 %. La
contrainte globale de capacité ne serait alors pas respec-
tée, ce qui compromettrait la sécurité du système. En-
suite, à cause de l’incertitude sur leur part de marché
dans un marché de détail ouvert, les fournisseurs n’ont
pas d’incitation à contractualiser leurs obligations de
capacité à long terme. En effet, leurs clients peuvent
décider de changer de fournisseurs et ils n’ont aucune
assurance sur le prix auquel ils pourraient revendre leur
capacité excédentaire.
Ces deux problèmes justifient de compléter les échanges
(de gré à gré ou sur un marché organisé) avec un bou-
clage du mécanisme de capacité. L'introduction d'un
mécanisme de bouclage implique qu'un tiers (par
exemple, le gestionnaire de réseau) se charge d'assurer,
à une certaine échéance (par exemple 4 ans à l’avance)
l'acquisition de la capacité restant encore à couvrir pour
respecter la contrainte globale de capacité totale. L'ob-
jectif est de s'assurer, suffisamment longtemps à
l'avance, que la sécurité d’alimentation sera bien respec-
tée.
11 Voir par exemple The Brattle Group (2010c). Midwest ISO’s Resource
Adequacy Construct. An Evaluation of Market Design Elements.
12 Cette option est détaillée dans l’article : Lévêque et al. (2011), Justifi-
cations économiques de l'utilité d'un mécanisme de bouclage dans le
fonctionnement d'un dispositif d'obligation de capacité. Revue de
l’énergie, n°603, septembre-octobre 2011.
Concrètement, l'introduction d'un mécanisme de bou-
clage consiste à organiser une enchère à laquelle tous les
détenteurs de capacités doivent participer et permettant
au gestionnaire du réseau d'acheter la capacité addi-
tionnelle nécessaire à la couverture des besoins, compte
tenu des actions individuelles de couverture déjà entre-
prises par les fournisseurs.
Les fournisseurs peuvent, s'ils le souhaitent, couvrir tout
ou partie de leurs obligations par des moyens propres ou
par des contrats bilatéraux. Les capacités ainsi réservées
doivent être présentées à un prix nul lors de l'enchère. Si
elles ne suffisent pas à couvrir l'objectif global, le ges-
tionnaire de réseau sélectionne les offres de capacité, en
commençant par les moins chères, jusqu'à ce qu'il ob-
tienne la capacité résiduelle nécessaire. L'issue de l'en-
chère définit ainsi un prix d'équilibre de la capacité, qui
sera ensuite répercuté sur les fournisseurs en fonction
de leur consommation de pointe, pour la part de leur
obligation qui n'aurait pas été couverte par leur propre
capacité ou par des contrats bilatéraux. Puisque le prix
de la capacité est finalement répercuté sur les fournis-
seurs et les consommateurs, les incitations à maîtriser la
consommation à la pointe sont maintenues.
Le mécanisme de bouclage mis en œuvre dans le Nord
des Etats-Unis depuis 2007 a montré son aptitude à
inciter les investisseurs à développer de nouvelles capa-
cités (40 GW pour le système de PJM dont la pointe
avoisine 130 GW de consommation), en particulier les
actions de réduction de la demande (gestion active de la
demande entre autres) qui représentent 30 % des nou-
velles capacités.
Conclusion
Le mécanisme de capacité qui doit être mis en place en
France à partir de 2015 complètera le marché de
l’énergie. Il apportera une rémunération additionnelle
aux capacités de production et d’effacement permettant
de répondre aux pics de consommation. Son design
précis est déterminant quant à son aptitude à inciter au
développement de nouvelles capacités au moindre coût.
La question centrale reste de savoir si l’assurance que le
système électrique dispose d’une capacité suffisante
peut être laissée aux seuls fournisseurs et aux forces de
marché, ou si un mécanisme supplémentaire nécessitant
l’intervention du gestionnaire de réseau doit permettre,
en dernier recours, l’équilibre de long terme entre la
production et la consommation.
Vincent Rious
©Microe conomix, ma rs 2012
L'auteur a contribué aux travaux économiques de
l'équipe d'économistes qui a conseil lé EDF sur ces
sujets. Il s'exprime ici à titre strictement pers onnel
et n'engage en rien la pos iti on de s clients de M i-
croeconomix.
1
/
4
100%