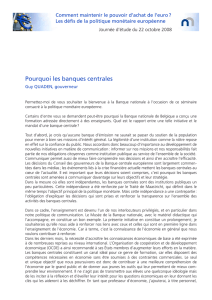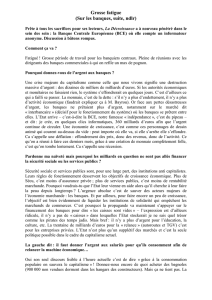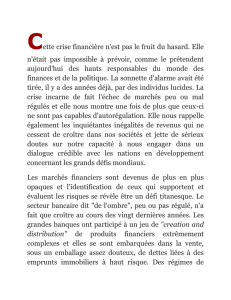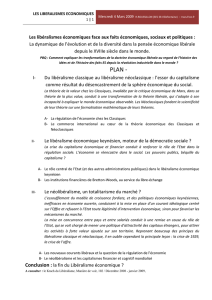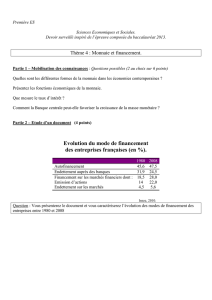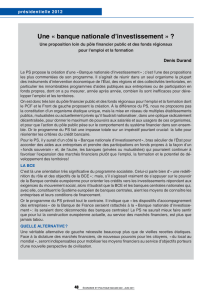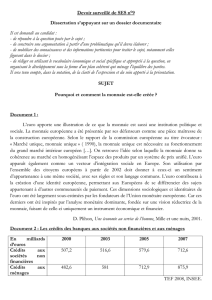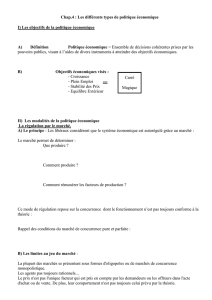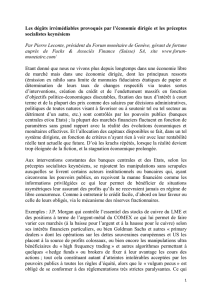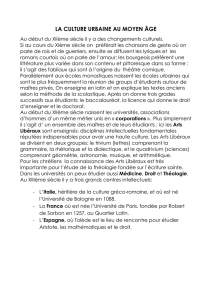La crise du capitalisme est-elle une crise du libéralisme

La crise du capitalisme est-elle une crise du libéralisme ?
Contribution au colloque
« Les Etats face à la crise »
organisé le 13 novembre 2009 par l’IRJS- André Tunc et l’ENA.
La crise amorcée en 2007 est généralement présentée comme une mise en échec du système
capitaliste et de la pensée économique libérale. Laissés trop libres, sans réglementation, les marchés
financiers se sont progressivement déréglés. Le secours des Etats prouve que l’autorégulation de
l’économie ne fonctionne pas ; la force publique a bien un rôle économique et monétaire à jouer. Le
libéralisme, qui explique et défend le capitalisme depuis son émergence, serait ainsi récusé par les
faits. Cette interprétation, largement dominante, semble de bon sens, tant l’économie mondiale paraît
être organisée selon les préceptes du libéralisme. Elle est portée par les gouvernements qui justifient
ainsi leur réaction mais aussi par la majorité des économistes ou des faiseurs d’opinion. Sans doute
correspond-elle aussi, dans le paysage français, à une culture politique où dominent antilibéralisme et
antiaméricanisme, prête à accueillir un phénomène qui la conforte si évidemment
1
.
Dans un tel contexte, il est étonnant que les libéraux, dont on aurait pu attendre qu’ils fassent
profil bas, contre-attaquent en présentant la crise comme prouvant le bienfondé de leurs idées. Après
une période de flottement, on trouve maintenant des analyses assez précises de la crise, stigmatisant
des erreurs publiques attestant qu’une fois de plus ce sont des interventions étatiques qui ont déréglées
le système capitaliste. A rebours du schéma dominant elles ne pointent pas une crise de la
déréglementation mais de la réglementation, et d’une réglementation d’obédience non libérale. Il
s’agirait d’une crise de l’interventionnisme ; non du marché économique mais du marché politique,
non de la responsabilité des acteurs privés mais de celle des autorités publiques. Autrement dit, elles
proposent de distinguer crise du capitalisme et crise du libéralisme, la réalité du système économique
pouvant s’éloigner de sa conceptualisation. Ce point est fondamental : le capitalisme n’est pas
nécessairement libéral, il peut aussi fonctionner comme un mélange d’initiatives privées et de
réglementations publiques – il en a d’ailleurs toujours été ainsi, les libéraux ayant toujours eu à
défendre une forme plus libre de l’économie de marché que celle existant. Aussi, ils invitent face à
cette nouvelle crise, à démêler l’écheveau des responsabilités entre l’Etat et les acteurs privés, entre le
marché et les institutions publiques, de façon à identifier ce qui correspond réellement aux principes
libéraux. La leçon de la crise est pour eux qu’il faut revenir à un capitalisme réellement apuré de toute
influence politique
2
.
Cette lecture est portée par des économistes qui se réclament du libéralisme dans son
acception la plus classique, défavorables au degré d’intervention publique des Etats-providence. On ne
prendra donc pas en compte les analyses des Liberals au sens anglo-saxon pour se concentrer sur les
partisans d’une économie vraiment libre, dégagée de toute influence politique. Ceux-ci se partagent
entre les « Autrichiens », disciples F. Hayek et L. von Mises, et les néo-classiques disciples de Milton
Friedman. S’ils s’accordent pour dénoncer une crise de l’action publique, ils divergent cependant
quant à la nature exacte de l’erreur commise. On observe ainsi un clivage important qui appellent des
solutions assez différentes.
1
Cf. P. Roger, L’ennemi américain, Paris, Seuil, 2002.
2
Cf. le récent ouvrage de P. Salin, Revenir au capitalisme pour éviter les crises, Paris, O. Jacob, 2010.

L’essentiel de notre contribution est une explication de l’analyse libérale, qui fait
généralement défaut à un éclairage complet de la crise alors qu’elle élargit considérablement la gamme
des facteurs explicatifs. Elle permet en outre de dégager des lignes de fracture en sein d’une pensée
qu’on aurait tord de croire homogène. Aussi, après l’analyse de la crise par le libéralisme, on tentera
une analyse du libéralisme par la crise – d’une façon qu’on peut espérer plus exacte que la
dénonciation sommaire que certains se réjouissent un peu rapidement de pouvoir faire.
I) L’analyse libérale de la crise
L’unanimité pour dénoncer un certain nombre de décisions des autorités publiques n’efface
pas les clivages qui divisent les économistes libéraux, en particulier dans le domaine de la monnaie.
En filigrane de toutes les interprétations, on retrouve l’opposition entre partisans du central banking
(une banque centrale régule l’activité des banques commerciales pour contrôler la masse monétaire) et
du free banking (absence de banque centrale), opposition qui correspond aux positions des néo-
classiques et des « Autrichiens ». La leçon de la crise ne sera pas la même : les premiers insistent sur
la nécessité de revenir à une « bonne » politique monétaire de la part des banques centrales, quand les
seconds demandent la suppression de toute politique des banques centrales. Ces divergences
n’interviennent que dans un second temps, après la dénonciation de la perturbation du système
financier par des facteurs exogènes. On observe un consensus pour dire que ce sont des interventions
extérieures à une pure logique économique qui ont déréglées le système. Si des acteurs privés ont
failli, c’est parce qu’on a corrompu le cadre de l’action rationnelle. On a détruit la boussole qui doit
permettre aux acteurs de s’orienter – la boussole étant le système des prix, donc du crédit (donc le taux
d’intérêt). La crise, dans son mécanisme, est d’abord d’ordre monétaire : l’économie a été submergée
par une surabondance de liquidités – ce qui a permis la bulle immobilière. Cette abondance a conduit
banquiers et financiers à prendre des risques insensés, jusqu’à ce que la bulle éclate, et que la structure
financière s’effondre. Reste à comprendre les raisons de cette bulle. Pour les libéraux, elle n’est pas
liée à l’instabilité « naturelle » des marchés ou à la réglementation de la finance engagée dans les
années 1980, elle ne saurait s’analyser comme le seul effet de la cupidité des banquiers. Elle s’est peu
à peu constituée parce que l’on a voulu orienter le marché vers des objectifs politiques et sociaux
(plutôt qu’économiques) dans un cadre réglementaire perverti et par une politique monétaire
désastreuse.
Les objectifs imposés aux acteurs économiques et financiers sont bien connus mais le plus
souvent minorés. Pour les libéraux, ils sont la cause de tout. L’origine profonde de la crise, de nature
politique, est la volonté de faire accéder à la propriété immobilière des classes sociales que l’on juge
« discriminées ». Seule cette volonté explique la politique du crédit menée par les autorités
américaines, qui s’est appuyée, d’une part sur une batterie d’outils réglementaires, d’autre part sur une
politique monétaire. Les effets nocifs de cette politique ont été renforcés par un contexte règlementaire
de la finance, d’origine publique, incapable de réellement garantir la sécurité des échanges. L’action
publique aurait donc corrompu l’information qui permet aux acteurs, en l’occurrence les banques,
d’avoir un comportement efficace et vertueux. La crise aurait été produite par l’idéologie
réglementaire et les perversions de l’économie mixte. Trois facteurs de la crise sont principalement
mis en avant : la politique du logement à l’origine des subprimes, la réglementation financière, la
politique monétaire.
A) L’origine des subprimes.
Dans l’analyse libérale, elles ne sont pas le produit de l’irrationalité du marché ou de la
démesure des traders, mais une création du marché politique, par le biais des deux établissements de

mobilisation hypothécaires, Fanny Mae et Freddy Mac. Ces deux organismes ont été créés, le premier
par Roosevelt, pour l’accession au crédit immobilier des classes moyennes et populaires. Ils vont être
l’instrument d’une incitation de plus en plus forte des pouvoirs publics à agir au service d’objectifs
sociaux. On peut présenter ainsi les différentes étapes de leur influence
3
:
- 1977 : une directive fédérale, au nom de la lutte contre les inégalités économiques et sociales,
incite les établissements financiers à développer leurs activités dans les quartiers défavorisés –
peu d’effets du RCA-Reinvestment Community Act.
- 1989 : un amendement du congrès contraint les banques à fournir des statistiques à propos de
leur clientèle. Moment important puisque cela va permettre de critiquer les pratiques
discriminatoires de ces banques, notamment parce que la distribution du crédit au logement
n’est pas socialement égalitaire.
- Début des années 1990 : le RCA est amendé : les associations peuvent dénoncer les banques
qui ne feraient pas d’effort pour les clients les moins solvables.
- 1995 : Fanny Mae et Freddy Mac voient leur statut modifié : en contre partie d’un engagement
au profit de l’accès au logement des populations pauvres, l’Etat leur confère des privilèges
concurrentiels [notamment l’exemption des règles pour le calcul des ratios prudentiels ;
l’octroi du statut de Government sponsored entreprises (« Entreprise dont l’Etat se porte
garant ») qui donne une garantie implicite du gouvernement fédéral].
Fannie Mae, d’inspiration rooseveltienne, a été privatisée en 1968, mais est sous tutelle
publique et avec un rôle social qui fait qu’implicitement il bénéficiait d’une garantie du Trésor
public. Comme Freddie mac, créé en 1970.
En résumé, le RCA est devenu un instrument de pression sur les banques pour les contraindre
à toujours alléger leurs conditions d’attributions des crédits, jusqu’aux ménages dont les garanties de
remboursement sont nulles. Il a soutenu un lobbying pour le logement populaire suffisamment
puissant pour que les établissements de crédit suivent le mouvement. Ceci sous l’influence
complémentaire du ministère du logement (HUD – Department of Housing and Urban Development),
qui a exigé que les prêteurs aillent de plus en plus loin : il a imposé aux 2F de respecter des quotas de
plus en plus élever de prêts Subprimes (ex : en 1996, 45 % des prêts accordés devaient concernés des
ménages en dessous du revenu médian, 50% en 2000, 52% en 2005). Les deux F prenaient alors des
risques considérables, dénoncés dans la presse, mais leur garantie d’Etat couvrait ces risques. Des élus
du Sénat ont d’ailleurs demandé une commission d’enquête en 2004, bloqués par les défenseurs de
cette politique du logement. A partir de cette date, comme en remerciement, les deux F vont faire du
zèle et produire des subprimes en quantité industrielle (40% de leurs crédits en 2006-2007).
Catastrophe, fin 2006, le contexte qui permettait ces pratiques se retourne : l’immobilier américain
s’effondre (suite à la remontée des taux d’intérêts du Federal Reserve System (Fed)). Une baisse de 1,5
du prix des maisons augmente de 50% les défaillances. Celles-ci se multiplient et avec elles la faillite
3
On pourra consulter en particulier les analyses très précises de H. Lepage, « Crise financière : l’autre histoire »,
Politique internationale, N°122, hiver 2009 ; Charles Gave, Libéral mais pas coupable, Paris, Bourin, 2009 ;

des établissements de crédits qui, à l’appel des pouvoirs publics et sous la pression des associations
militantes, s’étaient spécialisées dans le prêt social. On connaît la suite
4
.
Pour les libéraux, les subprimes n’auraient jamais vu le jour sans l’intervention des pouvoirs
publics. Il n’y aurait donc pas eu de crise si l’on était resté dans le seul cadre de la logique
économique. Le marché du crédit hypothécaire a été perverti par un choix politique que la rationalité
économique écartait. « C’est donc l’Etat qui a poussé à l’irresponsabilité les acteurs de la chaîne du
crédit », conclue Vincent Bénard, le directeur de l’Institut Hayek
5
.
B) Un contexte réglementaire qui aggrave la politique du crédit.
Contrairement à une idée reçue, la finance est une activité très réglementée, aux Etats-Unis
mais aussi à l’échelle internationale. Non seulement la force publique n’y est pas absente mais elle y
joue un rôle important, susceptible de pervertir l’activité qu’elle devrait se contenter de sécuriser. On
ne peut ici passer en revue toutes les réglementations rejetées par les libéraux ; aussi a-t-on retenu les
plus significatives dans la crise de 2007. Elles ne sont pas toutes de même nature mais concourent à
fragiliser l’activité économique et bancaire. Ainsi pointe-t-on par exemple le fait que les zones où la
réglementation foncière est la plus importante sont aussi celles où, les prix ayant augmenté, les
subprimes se sont le plus développées
6
.
Le plus important concerne directement la finance. Quatre règles sont particulièrement
dénoncées : La garantie d’Etat accordées aux deux F, très nocives puisqu’amenant les établissements
du monde entier à accepter leurs obligations et leurs produits titrisés, risqués mais garantis. Cette
couverture artificielle a permis la diffusion de créances à risques élevés et autres produits corrompus à
presque tout le système. Vient ensuite la critique des accords de Bâle de 1988, qui obligent les
Banques à conserver un montant minimal de 8% du total de leurs engagements, et les contraints à
réduire leurs prêts (ou augmenter leurs capitaux propres). Cela expliquerait le développement de la
titrisation : plutôt que de se rémunérer sur des prêts, les banques ont émis des emprunts dont elles se
servaient ensuite comme matière première pour la revente de produits financiers de plus en plus
complexes. Ce serait cette nouvelle réglementation qui, au lieu d’assainir l’activité des banques, aurait
produit une gestion capitaliste de plus en plus débridée et agressive. La règle du Mark to Market est
également dénoncée comme extrêmement nocive : en obligeant les banques à tenir compte de la valeur
boursière des actifs au jour le jour, elle amplifie artificiellement les risques de crise
7
. Enfin, la situation
de quasi monopole accordée à la SEC (Stock exchange commission) aux agences de notation
expliquerait qu’elles aient pu tranquillement accorder un triple AAA à des banques saturées de
subprimes et titrisations. Le fait que trois entreprises seulement sont habilitées par la SEC à noter les
obligations détenues par les institutions financières aggrave le conflit d’intérêt qui oppose les agences
aux entreprises qu’elles auditent mais auxquelles elles apportent aussi de plus en plus de conseils
rémunérés. Charles Gave considère qu’elles sont comme des guides de restaurant financés par les
restaurateurs ; elles ne sont pas payées par les acheteurs mais par les émetteurs de la dette
8
. En
4
Sur les 2F, cf. Franck Shostak, « Are fanny and Freddie too big to fail ?, Mises Institute, Mises Daily Article,
17 septembre 2008 ; P. A. Cleveland, « Freedie Mac : A mercantilist enterprise », Mises Institute, Mises Daily
Article, 14 mars 2005. Pour une analyse bine antérieure à la crise : S. Holmes, « Fanny Mae eases credit to aid
mortgage lending », New York Time, 30 septembre 1999, .
5
Vincent Bénard, « Subprime : marché accusé, Etat coupable », Le Figaro, 9 septembre 2008.
6
Cf. Wendell Cox, “Pourquoi les legislations anti-étalement urbain sont les principales responsables de la crise
des subprimes”, interview sur le http://www.crisepublique.fr/2008/04/interview-de-we.html.
7
Cf. Salin, op. cit., p. 51
8
Ch. Gave, op. cit., p. 84 et s.

définitive, elles sont tellement intégrées au système par les Etats qu’elles sont comme en situation de
monopole.
Toutes les pratiques des acteurs privés ne sont pas défendues ou légitimées par les libéraux.
Banquiers et financiers ne sont pas exonérés de toute responsabilité. La crise s’appuie évidemment sur
une série de comportement qu’ils ont librement adopté. C’est à leur initiative qu’en 1999 a disparu la
distinction entre banque de dépôt et banques d’affaires
9
, permettant aux premières de se comporter
comme les secondes, mais en prenant des risques sur le dos des déposants (et non des associés). C’est
l’un des nombreux exemples d’oubli des règles prudentielles qui régissaient le métier de banquier
depuis des décennies. Avec la titrisation, ils ont cédé à la tentation irrésistible de faire fortune
rapidement (la titrisation permet d’enregistrer des profits l’année de l’opération). Pour cela des
banquiers ont fait des montages truqués à seule fin de cacher les risques de leur bilan. Ils ont pu tricher
grâce à la complicité des agences de notation, qui elles aussi, même avec leur statut particulier, étaient
quand même censée être mues par la confusion entre vertu et intérêt professionnels que défend un
certain libéralisme. Ces comportements ne sauraient être complètement expliqués par les
approximations de la réglementation. Ce sont bien des fautes privées qui ont participées au
dérèglement du système. Cela n’exonère pas pour autant l’Etat qui aurait du jouer son rôle de
gendarme de la finance. Cette fonction n’est pas récusée par les libéraux qui pointent au contraire
l’inertie des autorités de police de la finance
10
. C’est donc une autre faillite de l’Etat que de ne pas
avoir su joué son rôle de gardien du marché, qui renforce l’idée d’une crise de la réglementation. N’est
pas en cause le vice des hommes mais les règles pour le contrôler et l’encadrer. On peut ainsi
remarquer que toutes les institutions qui ont sauté étaient réglementées. A l’inverse, les Hedge
Fund (fonds spéculatifs), mis au banc des accusés, ne sont à l’origine d’aucun risque systémique.
« Les acteurs non réglementés ne sont à l’origine d’aucun des problèmes actuels. Par contre, tous ceux
qui ont sauté en menaçant l’économie mondiale étaient lourdement réglementés », conclue Ch. Gave
11
.
Enfin, l’idée de gouvernement mondial, qu’aucun libéral n’a jamais soutenu, a mondialisé
concomitamment les réglementations perverses et les erreurs qu’elles engendrent.
C) Une politique monétaire désastreuse.
Cela constitue sans doute le point fondamental, pour plusieurs raisons : d’abord parce que la
politique de la FED est présentée comme le facteur déterminant de la crise; ensuite parce que les
banques centrales sont un rouage essentiel du système capitalisme et que l’analyse de leur implication
est essentielle pour définir le degré d’implication de la pensée libérale ; enfin parce que les libéraux se
divisent sur cette question, les monétaristes interprétant la crise comme un écart vis-à-vis des règles
fixées par Friedman en matière de taux d’intérêt, les autrichiens comme la preuve par les faits des
limites du monétarisme, dont il faudrait s’éloigner en supprimant tout simplement les banques
centrales. Ce désaccord n’intervient que dans un second temps. Il y a d’abord consensus pour dénoncer
la politique de la FED, en particulier l'extraordinaire variabilité de la politique monétaire américaine
au cours des années récentes – les taux d'intérêt passant de 6,5 % en 2000 à 1 % en 2003, pour
lentement remonter à partir de 2004 jusqu'à 4,5 % en 2006. La FED n’est pas seule accusée ; les
banques centrales asiatiques auraient également instrumentalisé les taux de change et d’intérêt,
déréglant ainsi les marchés financiers ; la BCE et le système instauré avec l’Euro, dont on ne sait pas à
quel point les libéraux le rejettent, auraient également une responsabilité dans l’extension de la crise.
Chaque point de l’analyse permet de pointer la responsabilité des autorités publiques davantage que
9
Permettant de confondre activités de bureau de poste et de casinos, note Ch. Gave.
10
A laquelle s’ajoute l’incompétence des autorités internationales, un rapport du FMI d’avril 2007 ne signalant
aucun risque lié aux subprimes.
11
Op. cit., p. 94.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%