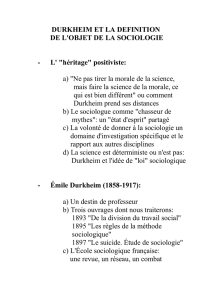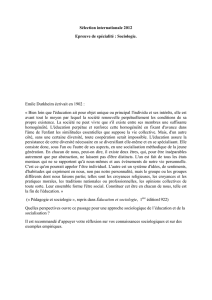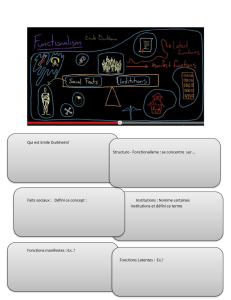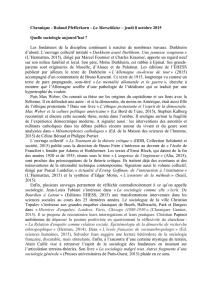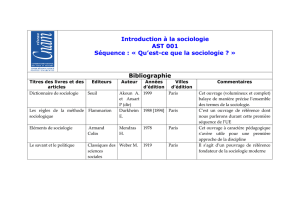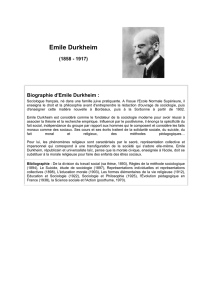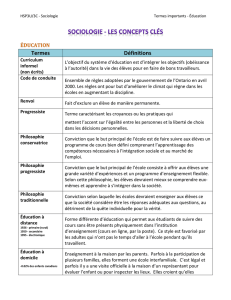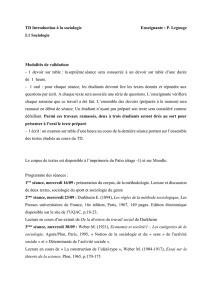L`interprétation Quelques problématiques : La vie a-t

Quelques problématiques :
La vie a-t-elle un sens ?
Y a-t-il de l’incompréhensible ?
Qu’est-ce qui rend l’objectivité difficile dans les sciences humaines ?
Est-il sensé de chercher un sens à tout ?
« Ça n’a pas de sens ! » (Raymond Devos)
Outre la démarche rationnelle des sciences, il convient de considérer d’autres tentatives de l’esprit,
lesquelles visent à découvrir le sens ou la signification. La philosophie est fondamentalement quête du
sens de ce qui, du moins en apparence, semble n’en comporter aucun. La philosophie se définit
d’abord comme « interrogation sur le sens » parce qu’elle est recherche du rationnel, ie de ce qui est
vrai et sensé.
La philosophie contemporaine souligne que c’est la conscience humaine qui confère un sens aux
choses. Notre perception, notre manière d’être au monde, découpe en celui-ci des unités qui n’en sont
pas du point de vue d’une matière indifférente : le sens nous est proprement humain.
L'interprétation a pour fonction d'élucider le sens d'un texte ou d'un acte. Il y a interprétation à
chaque fois que le sens n'est pas clair. La nécessité de l'interprétation tient en effet à ce qu'il n'y a pas
de réception immédiate du sens : le sens des choses ne va pas de soi. Il est rare que la signification
d'un propos ou d'une conduite soit immédiatement perceptible.
I – La notion de sens
Sous toutes les acceptions du mot «sens» (signification, orientation, direction), nous
retrouvons la notion d’un sujet humain donateur de ce sens. C’est le sujet qui éclaire la
signification, l’orientation, la direction : le sujet se pro-jette dans le monde, ainsi que l’affirme
l’existentialisme, et y introduit un sens, une signification interne. En lui-même, l’être est
neutre et vide de toute signification. Parler du sens, c’est toujours parler d’une conscience et
d’un projet.
Comme le montre Husserl, il n’y a pas d’un côté une conscience vide, comme en
attente d’être «remplie», et d’un autre côté, des objets de conscience potentiels ; la conscience
est, par essence, «conscience de quelque chose».
C’est donc la conscience elle-même qui est intentionnelle. Et il y a «recouvrement mutuel» du sens et
de l’acte conscient qui à la fois vise et «produit» le sens. (Ricœur, Du texte à l’action)
II - La recherche du sens
A - L’optimisme leibnizien

C’est un souci d’ordre apologétique qui fonde chez Leibniz la détermination du sens.
Si de chaque chose on doit pouvoir dire pourquoi elle est ainsi et non autrement, c’est parce
qu’elle fait partie d’une série d’étants qui est nécessairement la meilleure possible.
Ainsi, si telle chose nous paraît mauvaise, et, partant, dénuée de sens, la considération
de cette vérité que Dieu n’aurait pu mieux faire nous rappellera qu’elle constitue un élément
concourant à l’harmonie de cette «machine très admirable» qu’est le monde.
Ce que les hommes appellent le mal se voit ainsi conféré un sens par l’optimisme leibnizien, ie une
raison qui le relie à la fin visée par le Créateur, au dessein global qui a présidé à son œuvre.
B – Hegel
Les philosophies modernes, et celle de Hegel tout particulièrement, ont présenté le mal
comme un moment nécessaire à la réalisation du bien. Guerres, inimitiés et autres conflits
sont en vue de l’avènement final de la Raison.
Il existe, affirme Hegel, une logique des événements historiques : l’histoire humaine
réalise une fin générale, un dessein, qui dépasse largement les projets de l’individu égoïste
ainsi que ceux des peuples particuliers. L’histoire a donc un sens en tant qu’elle est orientée
tout entière vers une fin, en tant qu’on doit la penser de façon téléologique.
Peuples et individus, tout en poursuivant leurs fins propres, produisent de surcroît des effets qu’ils ne
désiraient pas : «inconsciemment», ils font advenir des institutions, des révolutions, etc. qui vont dans
le sens de l’histoire.
Ainsi que le montre Ricœur, dans La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, le sens
latent à déchiffrer se trouve dans la fin vers laquelle la conscience s’achemine :
«La Phénoménologie de l’Esprit nous propose un mouvement selon lequel chaque figure trouve son
sens non dans celle qui précède, mais dans celle qui suit ; la conscience est ainsi tirée hors de soi, en
avant de soi, vers un sens en marche, dont chaque étape est abolie et retenue dans la suivante.»
(Ricœur, Le conflit des interprétations)
III - Les herméneutiques
A - Notion
Le sens est par nature toujours «à donner», à «chercher», toujours le terme d’une
interprétation. L’herméneutique (du grec herméneus : interprète) est d’abord l’interprétation
des textes bibliques : pendant des siècles, lorsque les religions et leurs livres présidaient aux
actions humaines, le déchiffrement des passages obscurs ou contradictoires de ces livres a en
effet constitué une tâche essentielle pour les penseurs de chaque époque.
L’exégèse, science de l’interprétation des textes sacrés, a permis de mettre en évidence
les règles qui commandent le travestissement du sens «caché».
«L’interprétation est le travail de pensée qui consiste à déchiffrer le sens caché dans le sens apparent,
à déployer les niveaux de signification impliqués dans la signification apparente.» (Ricœur, De
l’Interprétation)
Par extension, on parle d’herméneutique pour toute restitution ou dévoilement du sens
d’un texte, voire de réalités d’un autre ordre (œuvres d’art, types de société, modes de
comportements, etc.). Son noyau est l’interprétation.
B - Sens littéral et sens caché

Est-il possible, dans la plupart des domaines où se posent des problèmes
d’interprétation, d’élaborer une sorte de «science de l’interprétation» ? Marx, Nietzsche et
Freud ont ceci de commun qu’ils ont fondé une herméneutique.
Selon ces trois philosophes, la représentation donnée dans la conscience est toujours
déjà susceptible de ne constituer qu’une illusion.
Tous trois comparent les objets de leur étude à des hiéroglyphes ; et tous trois
affirment la nécessité d’un déchiffrage : des idéologies et des institutions sociales (Marx) ; du
contenu du rêve ou des symptômes névrotiques (Freud) ; de tel type humain ou de tel idéal
moral (Nietzsche). (Souvenez-vous de leur interprétation de la religion)
Loin d’admettre que la conscience puisse être crue sur parole, les philosophies de
l’« ère du soupçon » proposent des techniques d’interprétation destinées à dévoiler le sens de
ses productions.
C - L’interprétation psychanalytique
Freud fut un des maîtres de l’interprétation : on se souvient que pour Freud, la plupart
des rêves sont la satisfaction d’un désir refoulé à l’état de veille.
L’interprétation psychanalytique des rêves chez le névrosé et chez le sujet normal, tout comme celle
des actes manqués (lapsus, oublis...) et des névroses, conduit ainsi à distinguer d’une part un désir
inavouable à la conscience morale, et d’autre part les forces psychiques (censure) qui ont présidé à son
travestissement.
Le rêve constitue donc, selon Freud, le substitut d’un désir qui reste latent : il exprime
ce désir tout en le dissimulant ; il le fait apparaître tout en le masquant.
«Il est facile de voir, écrit Freud, que l’interprétation des rêves, quand elle n’est pas rendue trop
pénible par les résistances du malade, conduit à découvrir les désirs cachés et refoulés, ainsi que les
complexes qu’ils entretiennent.»
Le sens du rêve est donc atteint par une investigation de type herméneutique : il faut
interpréter le film aux images insensées que constitue le rêve manifeste pour retrouver au-delà
de l’écran formé par les résistances, les intentions qui ont présidé au montage d’un scénario
apparemment indéchiffrable et que le psychanalyste va exhumer.
D’une façon générale, l’herméneutique freudienne conduit à introduire une distinction entre le sens
manifeste du rêve, ce que le rêve nous raconte et, d’un autre côté, le sens latent, véritable et caché du
rêve. Il en est de même pour toutes les conduites humaines, dont le sens apparent est inséparable d’un
sens caché lié à l’inconscient infantile.
D – L’interprétation est-elle irréfutable ?
Toute herméneutique suppose que le sens d’un discours ou d’un comportement
humain n’apparaisse jamais d’emblée à la conscience de l’individu qui agit ou qui parle.
Chercher le sens d’un processus psychique, c’est donc tenter de débusquer l’intention qui fait
en sorte que la conscience ne parle en nous qu’à demi-mot.
Cependant, dans les sciences interprétatives, la possibilité d’une réfutation
expérimentale fait défaut... Ce qui rend donc possible une interprétation marxiste irréfutable
de l’histoire, ou une interprétation psychanalytique de tous les faits cliniques : «Le marxisme
et la psychanalyse sont hors de la science précisément en ce que et parce que, par la structure
même de leurs théories, ils sont irréfutables.» (Monod).

L’interprétation demeure une signification proposée, certes très convaincante parfois, mais arbitraire
toujours.
IV – Faut-il toujours chercher un sens ?
A - La recherche du sens est recherche de vérité
Seul l'insensé s'arrête à l'apparence des choses. L'homme de bon sens cherche à
comprendre, à rendre clair ce qui est obscur, à rendre cohérent ce qui est confus. Il n'y a pas de
honte à ignorer le sens des choses, mais on n'a pas le droit de renoncer à donner du sens à ce
qui est.
Avant les recherches de Freud, il semblait insensé de chercher un sens aux rêves, aux
lapsus, aux actes manqués. Cependant, l'analyse de l'inconscient a permis de donner un sens à
ce qui semblait n'en avoir aucun. Nous ne sommes donc pas autorisés à rejeter hors des
frontières de l'humain ce que nous ne comprenons pas encore.
Le sens d'une chose (d'un geste, d'un mot, d'un objet, d'une œuvre...) est ce que cette
chose nous fait connaître au-delà de sa matérialité. Ce sens peut être unique, simple, ou
multiple et complexe. Cela va du sens d'un geste jusqu'aux diverses interprétations d'une
œuvre d'art.
C’est parce qu'il y a du sens que les mouvements de l'homme sont des gestes et non de simples
gesticulations. Mais refuser le sens par crainte d'interprétations fantaisistes n'est pas une solution
raisonnable. «N’importe quel sens vaut mieux que pas de sens du tout.» (Nietzsche, Généalogie de la
morale)
B - Chercher un sens n’a cependant pas toujours de sens
Selon Wittgenstein, seules les propositions vérifiables ont un sens, et il n'y a du sens
que lorsque le discours est intelligible. «Une proposition n'est douée de sens que si elle se
prête (...) à la vérification.» (Tractatus logico-philosophicus)
S'interroger sur le sens, c'est postuler que la réalité n'est compréhensible que rapportée
à autre chose qu'elle-même, quelque intention directrice (Dieu, la Raison ou la Nature...). S'il
n'y a pas d'intention directrice, il est insensé de chercher un sens. Faut-il chercher un sens aux
tsunamis dévastateurs fin 2004 en Asie ? Le rhume de Raphaël en Juillet 2006 a-t-il un sens
profond ? Il ne s'agit là que d'une vaine recherche.
Nous voulons à tout prix découvrir un sens à tout parce que nous voulons que
l'existence ait un sens, qu'elle tende vers une certaine fin. Cependant, selon Nietzsche, «nous
avons inventé l’idée de but : dans la réalité, le but manque.» (Généalogie de la morale).
Le réel est parfois désordonné, mais rien ne nous oblige à conférer de l'ordre à ce qui n'en a pas. La
recherche du sens est illusoire.
C – L’inévitabilité de la recherche du sens
Pour qui se contente de «prendre acte» des existences, il est des ordres de la réalité ou
de l'action auxquels on peut choisir de donner un sens ou non. Mais pour quiconque conçoit
son existence individuelle et l'évolution de l'humanité autrement que comme une simple
succession de faits bruts, la vie et l'histoire prennent, elles aussi, un sens.
Il est facile de comprendre un signe algébrique, plus difficile de saisir le sens d'une
conduite. Mais la tâche de la philosophie est claire : il s'agit, tout à la fois, de limiter les
prétentions dogmatiques de la raison et d'assigner à l'irrationnel sa juste place. Car

l'irrationnel n'est absurde que pour la raison comptable; il est, au contraire, plein de sens pour
la personne qui existe en tant que réalité spirituelle, organique et sociale.
D - L’avenir du sens ?
Le «système» l’emporte sur le sens, chez les structuralistes. (cf. le cours sur
l’existence) Un système est un ensemble de relations qui se maintiennent et se transforment
indépendamment des choses qu’elles relient.
Lévi-Strauss, déchiffrant les relations de parenté, ne retrouve guère ni la subjectivité ni
le sens, mais un système, un ensemble organisé. De même, la psychanalyse de Jacques Lacan
montre l’homme manipulé par des relations et non point donateur de sens. Ainsi se volatilise
l’homme, sujet universel, libre et donateur de sens.
«Le point de rupture s’est situé le jour où Lévi-Strauss pour les sociétés et Lacan pour l’inconscient
nous ont montré que le « sens » n’était probablement qu’une sorte d’effet de surface, un miroitement,
une écume et que ce qui nous traversait profondément, ce qui était avant nous, ce qui nous soutenait
dans le temps et l’espace, c’était le système. » (Michel Foucault).
Exemple de sciences interprétatives : les sciences humaines
Quelques problématiques :
• L'homme est-il objet de science ?
• Peut-on, sans se contredire, parler de « science de l'homme » ?
• Peut-on constituer une science de l'homme sans nier la liberté humaine ?
Les sciences humaines sont des sciences ayant pour objet d'étude l'homme et la société dans les
domaines où ceux-ci ne peuvent être appréhendés par les sciences exactes. Les principales sciences
humaines sont : l'histoire, l'économie, la démographie, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse,
l'ethnologie, la linguistique.
Le problème des sciences humaines est qu'elles tendent à un savoir positif comparable à celui des
sciences exactes, alors que l'homme, de par sa nature, ne se laisse pas réduire à des lois physiques
constantes et universelles.
I - L'homme et les sciences humaines
A - La médecine propose une approche scientifique de
l'homme
L'homme est un être vivant, il peut donc être étudié comme n'importe quel être vivant.
C'est parce que l'homme est un objet scientifique que la médecine est possible comme science et
efficace comme pratique.
La technique réparatrice du chirurgien s'appuie sur la conception d'un homme objectivé
par la science, de la même manière que la psychanalyse comme thérapeutique «fonde sur
l'hypothèse de l’inconscient une pratique efficace » (Freud).
B - Les sciences humaines sont
légitimes
Les sciences humaines étudient l'activité humaine comme un fait indépendant de la
conscience individuelle dans les phénomènes psychologiques, historiques et sociaux.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%