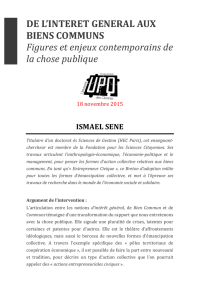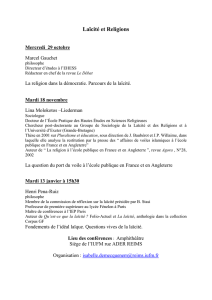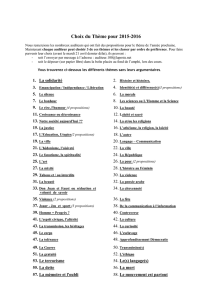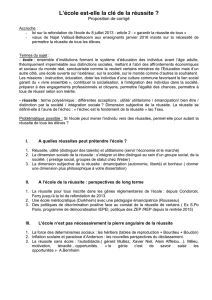Republicanisme scolaire et emancipation

1
Republicanisme scolaire et emancipation
Identité des auteurs
Nom : Foray
Prénom : Philippe
Appartenance institutionnelle : Université de St-Étienne, EAM 4571 Éducation,
cultures, politiques
Courriel : philippe.fo[email protected]
Nom : Mole
Prénom : Frédéric
Appartenance institutionnelle : Université de St-Étienne, EAM 4571 Éducation,
cultures, politiques
Courriel : [email protected]
Nom : Monjo
Prénom : Roger
Appartenance institutionnelle : Université Montpellier III, EA 3749, LIRDEF
Courriel : [email protected]
Nom : Müller
Prénom : Walter
Appartenance institutionnelle : Université de Würzburg
Courriel : [email protected]
Nom : Zoïa
Prénom : Geneviève
Appartenance institutionnelle : IUFM-Université Montpellier II, EA 3749, LIRDEF
Courriel : [email protected]
Identité du coordonnateur
Nom : Mole
Prénom : Frédéric
Appartenance institutionnelle : Université de St-Étienne, EAM 4571 Éducation,
cultures, politiques
Courriel : [email protected]
Identité du réactant
Nom : Vergnioux (sous réserve)
Prénom : Alain
Appartenance institutionnelle : Université de Caen, CERSE
Courriel : [email protected]

2
Republicanisme scolaire et emancipation
Résumé : Dans ce symposium, on se propose d’interroger certaines composantes normatives de la
tradition républicaine en matière scolaire (méritocratie, obligation, culture commune...) du point de vue
du projet d’émancipation, individuelle et collective, dont cette tradition elle-même se réclame.
Abstract: In this symposium we are addressing a number of normative aspects of the republican
tradition concerning school education (meritocracy, obligation, common culture, etc.) insofar as this
tradition claims to be directly involved in the project of collective and individual emancipation.
Resumen: En este simposio se propone interrogar ciertas componantes normativas de la tradicion
republicana en terminos scolares (meritocracia, obligacion, cultura comun..) del punto de vista del
proyecto de emancipacion, individual y colectiva, de la cual la tradicion se reclama.
Mots-clés : Démocratie, émancipation, individu, méritocratie, républicanisme
Problématique générale
L’école est, selon l’expression bienvenue de l’historien anglais Théodore Zeldin, « une passion
française ». Au cours de son histoire, elle a fait l’objet d’un investissement politique fort et controversé.
Au cœur de cet investissement, on trouvera aisément les notions de « républicanisme » et
d’« émancipation ». Une affirmation comme « l’école républicaine est émancipatrice » apparaît
fréquemment dans les controverses passées et actuelles sur l’éducation publique. Émancipation des
citoyens de la République à l’égard des tutelles confessionnelles ; émancipation du peuple à l’égard
de ceux qui le dominent ; émancipation intellectuelle à l’égard du règne de l’opinion dans les sociétés
démocratiques, émancipation des appartenances identitaires, régionales, familiales, etc. Le lien entre
« républicanisme » et « émancipation » se décline de façon multiple, d’hier à aujourd’hui. C’est lui qui
tend à sacraliser le programme républicain.
Or, cette liaison elle-même ne laisse pas d’être problématique. Les difficultés apparaissent dès que le
point de vue s’élargit pour examiner d’autres dimensions de l’école. C’est précisément à cette mise à
l’épreuve de l’idéologie émancipatrice que les différentes communications de ce symposium
s’essaieront, à travers les questions suivantes :
L’école peut-elle être à la fois libératrice et obligatoire ? La logique de la sélection des élites et celle
de la promotion de tous sont-elles convergentes et à quelles conditions ? Jusqu’à quel point la
méritocratie est-elle compatible avec le projet émancipateur de l’école républicaine ? Quels problèmes
socio-politiques sont posés par les conséquences pratiques de la méritocratie (notations, examens et
certifications) ? Comment le projet émancipateur est-il conciliable avec le « respect des cultures » ?
À l’arrivée, on peut faire l’hypothèse que c’est la pluralité des fonctions de l’éducation publique qui est
en jeu. La dimension proprement politique de l’école républicaine – qui se fait jour dans sa
revendication d’émancipation – doit être confrontée, d’une part, avec les fonctions de sélection, de
contrôle et d’orientation qui caractérisent historiquement l’éducation publique ; et, d’autre part, avec
les attentes de la société démocratique en termes de prise en compte des individus, de
reconnaissance et de progrès social.

3
Les communications :
- L’école peut-elle être à la fois libératrice et obligatoire ? (Roger Monjo)
Une tendance à la pénalisation de l’obligation scolaire est à l’œuvre aujourd’hui sous la forme de
sanctions financières ou morales. Initialement, pourtant, cette obligation avait vocation à incarner un
droit universel, le droit à une éducation de base pour tous, en l’inscrivant explicitement dans une
perspective émancipatrice. Certes, une certaine violence a marqué l’instauration de cette obligation.
Mais cette violence elle-même trouvait sa légitimité dans la promesse d’intégration qui accompagnait
l’exercice de cette soumission initiale. Nécessairement provisoire, elle était malgré tout appelée à
s’effacer en raison du mouvement historique qui pousse, aux yeux d’un moderne, au rapprochement
croissant des deux principes d’obligation et d’autonomie que la philosophie du contrat avait théorisé
en posant que seule une volonté libre pouvait être obligée, en s’obligeant elle-même et que c’était, en
retour, dans cette capacité à s’obliger que s’exprimait, le plus nettement, cette liberté. Or, à l’inverse,
la tendance actuelle inscrit l’obligation scolaire dans l’horizon d’une hétéronomie maximale et le projet
politique d’intégration a cédé la place à des mesures policières, punitives et stigmatisantes.
Qu’en est-il donc aujourd’hui, plus précisément, de la triple exigence à laquelle l’obligation scolaire
avait initialement satisfait : protéger l’enfance, contribuer à la formation du citoyen mais aussi du
travailleur et, plus particulièrement, du travailleur salarié ? Que penser, alors, du revival républicain
actuel lorsque celui-ci se présente comme une alternative à la révolution néo-libérale en cours en
proposant, en particulier pour l’école, une refondation du « pacte républicain » ? D’autres options ne
sont-elles pas disponibles qui permettraient de renouer véritablement avec les dimensions
d’inconditionnalité et d’émancipation du projet moderne d’instruire ?
- L’émancipation par l’école unique : logique collective ou logique individuelle ?
(1re moitié du XXe siècle) (Frédéric Mole, Université de St-Étienne, EAM 4571
Éducation, cultures, politiques)
L’enseignement en France revendique à la fois une visée émancipatrice et une logique méritocratique,
qui se conjuguent ou entrent en tension. La méritocratie, en même temps qu’elle sélectionne des
élites pour l’intérêt collectif, offre aux individus sélectionnés la possibilité de se tracer un nouveau
destin social qui les distingue de tous ceux qui sont relégués aux tâches d’exécution. Or les courants
socialistes ont longtemps redouté une unification scolaire qui, subordonnant l’école primaire – école
du peuple – à la culture élitiste du secondaire, priverait le prolétariat de ses meilleurs éléments. Si
l’ascension sociale a pu paraître une forme d’émancipation individuelle (échapper à sa classe), elle a
été aussi regardée comme une mise en péril de tout processus d’émancipation collective. À la suite
des critiques syndicalistes des années 20 et 30, le mot d’ordre de Paul Langevin – promotion de tous
et sélection des meilleurs – tente ensuite d’opérer une synthèse. Cette approche historique vise à
mettre en perspective les débats actuels sur la démocratie par l’école : la logique de la « sélection des
élites » et celle de la « promotion de tous » sont-elles compatibles et à quelles conditions ?
- Républicanisme scolaire : émancipation et méritocratie (Philippe Foray,
Université de St-Étienne, EAM 4571 Éducation, cultures, politiques)
En France, le lien entre éducation et émancipation est aisé à relier au « républicanisme scolaire ». On
peut soutenir que « l’école républicaine française se veut un lieu d’émancipation », quelle que soient
les difficultés qui existent pour déterminer de façon précise le concept d’émancipation et le lien entre
scolarisation et émancipation. Mais l’idéologie républicaine fait aussi référence à la notion de
méritocratie, comme en témoigne l’expression d’« élitisme républicain » et la représentation intuitive
d’une promotion sociale des individus par l’école, sur la base de leurs seuls talents (et non de leurs
relations sociales ou de leurs richesses). La communication s’interrogera sur les liens existant entre
émancipation et méritocratie, sur les contradictions existant entre les logiques éducatives et sociales
qui sont sous-jacentes à l’emploi de ces notions et sur la possibilité de formuler une articulation
acceptable entre elles : jusqu’à quel point la logique méritocratique fait-elle obstacle ou est-elle

4
compatible avec la visée émancipatrice de l’école républicaine ? À quelles conditions cette
compatibilité est-elle pensable ?
- Trois thèses pour une critique pédagogique de l’évaluation du mérite au moyen
des notes (Walter Müller, Université de Würzburg)
La critique pédagogique de l’évaluation du mérite, au moyen de notes, d’examens et de certifications
a une longue tradition. Il y a 170 ans déjà, Carl Gottfried Scheibert se plaignait que « les élèves
n’apprennent que pour l’examen et quand il est passé, leur savoir n’a plus de valeur à leurs yeux ».
Cette critique s’est radicalisée au moment de la réforme pédagogique, au tournant des 19e et 20e
siècles. « Finissons-en avec les notes, finissons-en avec les examens », telle était souvent la devise.
Qu’est-ce que les sciences de l’éducation doivent retenir de cette critique ? Est-ce que ces doutes
pédagogiques ne sont valables que pour l’école du passé ou ont-ils encore une valeur aujourd’hui, au
moins en partie ? Cette question sera traitée au moyen de trois thèses. Thèse 1 : Les raisons qui ont
conduit au système moderne de l’évaluation du rendement scolaire (des élèves) n’étaient pas
pédagogiques, mais socio-politiques. Cela pose problème jusqu’à aujourd’hui. Thèse 2 : Le principe
central de légitimation des notes, des examens et des certifications est l’affirmation suivante : « nous
vivons dans une société de performance ; pour cette raison, l’école doit être orientée par la notion de
performance ! ». Cette affirmation est douteuse. Thèse 3 : L’évaluation de la performance/mérite au
moyen de notes est très problématique, autant du point de vue théorique que pédagogique. Existe-t-il
des alternatives ?
- Laïcité, identités, culture (Geneviève Zoïa, IUFM-Université Montpellier II, EA
3749, LIRDEF)
La confrontation de différentes formes de socialisations et d’identités au sein de l’espace scolaire
pose le problème de la légitimité du modèle laïque, unique et supérieur et questionne la laïcité dans
ses possibilités de mise à jour, en référence au projet éducatif des Lumières. En effet, les expériences
scolaires, des publics et des professionnels, sont socialement clivées et les politiques publiques sont
loin d’être toujours le résultat de la mise en œuvre de valeurs universelles. De nombreux travaux ont
montré que discriminations, inégalités et injustices marquent les espaces éducatifs. Dans ce contexte,
la laïcité peut-elle encore être un projet ? Principe politique élaboré au 19e siècle, elle ne peut pas être
cette référence sacrée invoquée par certains responsables politiques, qu’il suffirait de consulter face
aux questions que soulèvent la coexistence et la confrontation socio-culturelles au sein d’une société
plurielle et démocratique. Les missions du projet humaniste – socialiser aux valeurs de la république,
construire des individus libres, distribuer une place sociale – peuvent-elles encore aujourd’hui
converger ? Cette communication questionnera les façons dont la laïcité à l’école peut être mobilisée
et interprétée soit comme un principe politique dynamique, soit comme une donnée identitaire
défensive.

5
L’école peut-elle être, à la fois, libératrice et obligatoire ?
Roger Monjo
(Université Montpellier III, EA 3749, LIRDEF)
Considérations préliminaires
À la différence de la laïcité et de l’égalité des chances, l’obligation scolaire n’est pas
aujourd’hui l’objet d’un “conflit d’interprétations“ particulièrement intense. Si la première est l’objet
d’une querelle récurrente quant au sens à lui donner et si la seconde est revendiquée, à la fois, par un
discours néo-libéral qui en assume sans frémir le pré-requis d’une représentation de la vie sociale (et
scolaire) comme un espace essentiellement compétitif et par un discours républicain qui cherche, en
revanche, à contenir les effets dévastateurs de cette représentation concurrentielle, la dernière
(l’obligation scolaire), par contre, est encore relativement épargnée par ce mouvement d’interrogation
et de déstabilisation généré par ces conflits herméneutiques. Et ce, même si des options alternatives
(prolongation à 18 ans versus réduction à 15 voire 14 ans) sont aujourd’hui avancées, mais qui ne la
remettent pas fondamentalement en question.
Pourtant, le principe même de cette obligation devrait, à terme, rejoindre, dans leur commune
fragilisation, les deux autres ingrédients normatifs de la tradition républicaine. En effet, l’obligation
scolaire a reposé, lors de sa promulgation, sur une sorte de promesse, qui a alimenté sa capacité à
susciter une adhésion massive, en particulier de la part des classes populaires qui en étaient le
principal destinataire : la promesse d’une insertion politique et, plus généralement, sociale (sinon
professionnelle, du moins pendant longtemps) réussie en échange de cette soumission initiale à
l’ordre scolaire, c’est-à-dire à une institution qui se fixait comme objectif de former, dans le temps de
cette période obligatoire, le « citoyen » mais aussi, plus globalement, l’être social, l’individu dans sa
capacité à intégrer le « vivre-ensemble ». Longtemps (jusque dans les années soixante, voire même
un peu au-delà) cette promesse a été, bon an mal an, tenue, le respect de cette "obligation scolaire"
se traduisant par une intégration à la communauté sociale et politique perçue comme relativement
satisfaisante. De facto, le terme fixé à cette obligation (13 ans à l’origine, 14 ans dans les années 30,
16 ans dans les années 60) a coïncidé, tout au long de ces décennies, avec des sorties suffisamment
massives du système scolaire, pour qu’obligation "légale" et obligation "réelle" (ce qu’on appelle
aujourd’hui, dans les enquêtes internationales, "l’espérance de vie scolaire moyenne" et qui
correspond à une durée suffisante de scolarisation pour que la promesse d’une intégration
satisfaisante soit tenue) se recouvrent.
C’est précisément ce recouvrement qui s’est défait, ensuite, et l’écart n’a cessé de grandir
entre l’âge qui marque légalement le terme de l’obligation scolaire (16 ans encore aujourd’hui) et l’âge
auquel il faut, en moyenne et en réalité, quitter l’école pour espérer une intégration sociale et politique
convenable. D’autant que la « promesse » de cette intégration réussie s’est, entre-temps, enrichie.
Au-delà de l’intégration sociale et politique, c’est l’insertion professionnelle qui est aujourd’hui visée,
de plus en plus exclusivement au point d’en faire dépendre les autres modalités. Or, il apparaît
aujourd’hui qu’un élève qui se "contente" de satisfaire strictement à l’obligation légale, c’est-à-dire qui
quitte l’école à 16 ans, est le plus souvent un élève en échec qui connaîtra des difficultés d’insertion
professionnelle et sociale et qui risque donc de se sentir exclu de la communauté politique. La loi
d’orientation pour l’école de 2005 a, au demeurant, clairement intégré cette question lorsqu’elle a, non
seulement reconduit l’objectif antérieurement fixé de conduire 80% d’une classe d’âge en Terminale,
mais aussi arrêté comme nouvel objectif pour l’école l’obtention par 50% d’un diplôme de
l’enseignement supérieur. Même s’il est vrai qu’elle a, par ailleurs et au risque d’une certaine
contradiction, conforté le principe d’une obligation scolaire fixée à 16 ans en formulant le projet d’un
socle commun de connaissances et de compétences à faire acquérir par tous les élèves à la fin du
collège. Car, comment échapper alors, si on prend au sérieux le projet de conduire la quasi-totalité
des élèves « au niveau du baccalauréat », à une interprétation de ce socle commun en terme de « kit
de survie », de viatique minimal, destiné à la minorité des élèves les plus faibles, ceux dont on
anticipe, en quelque sorte, l’échec et l’exclusion sociale qui risque d’en résulter, alors qu’il a,
théoriquement, vocation à identifier cette culture commune fondatrice d’un lien social et politique
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
1
/
41
100%